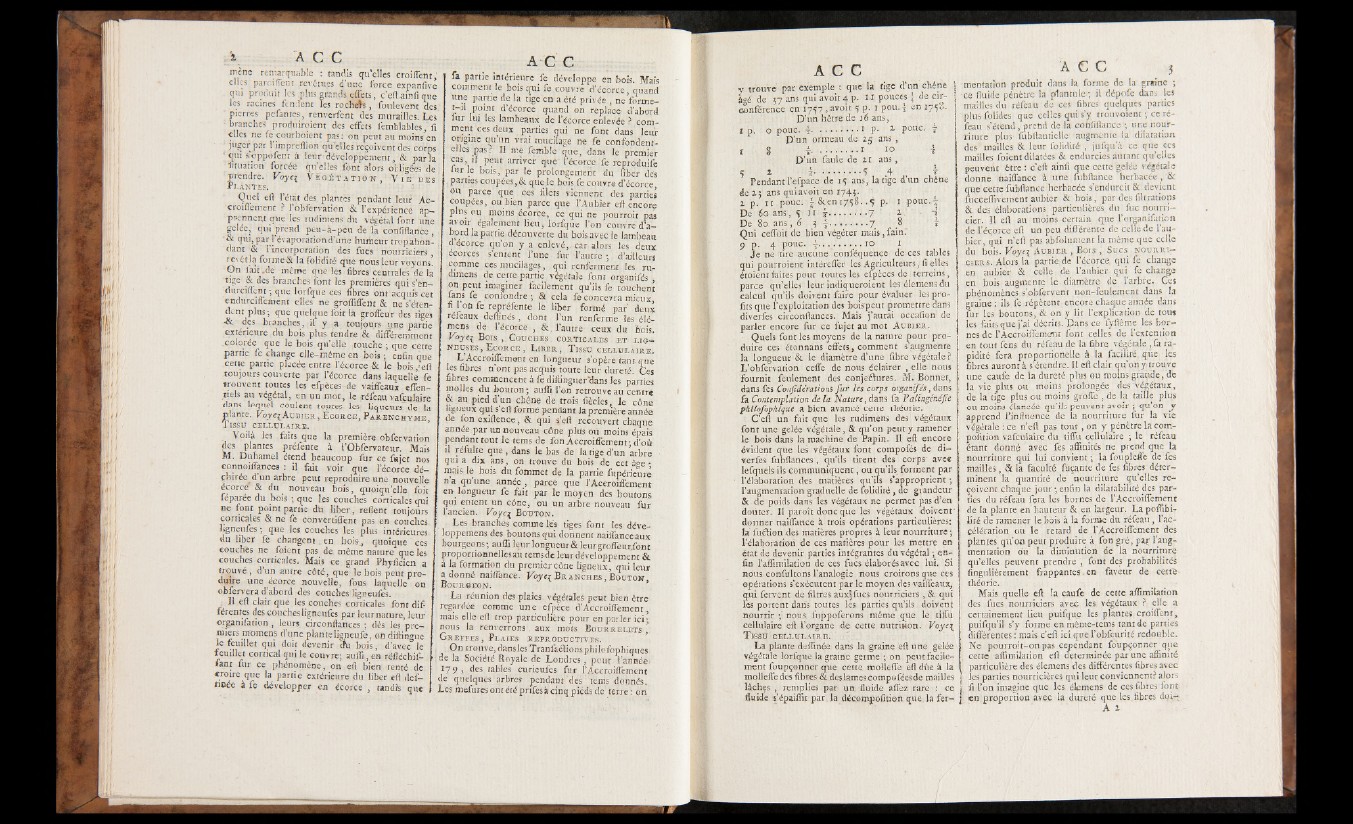
A. A C C mène remarquable : tandis qu’elles croiffent,
clics paradent revêtues d'une force expanfivè
qui produit les .plus grands effets, c’eftainfi que
les racines fendent les rochers, foulevent des
; pierres pefantcs, renverfent des murailles. Les
branches produirçient des effets lèmblables,' fi
elles ne fe courboient pas:-on-peut au moins’en
juger par t’impreflion qu’elles reçoivent des corps
' qui s’.oppoferu à leur développement, & parla
tituafion forcée qu’elles font alors obligées de
prendre. Voye^ \ é a ± t a t i o n , ' V I E b i s i
Plantes.
Qiiel eft l’état des. plantes pendant leur Ac-
croiflèment ? l’obfervation & l’expériénce apprennent
que les rudimens du végétal font une
gelée; qui prend peu-à-peu de la confîftarice , ■
'& qui, Pa't l’évaporation d’une humeur tropàbon-
dant & l’incorporation des fucs nourriciers
revêt la forme & la folidité que nous leur voyons!
On lait.de même que lés fibres centrales delà
tige & des branches font les premières qui s’en-
durciflent ; que lorfque ces fibres ont acquis cet
endurciffement elles ne grofiiffent & ne s’étendent
plus ; que quelque foin là groffeur des tiges ,
-& des branches, il y a toujours une partie '
extérieure .du bois plus fendre & différemment
.colosée que le bois qxx elle .touche ; que cette
partie fe change elle-même en bois ; enfin que ‘
cette partie placée entre l’écorce & le boisp cil
toujours couverte par l’écorce dans laquelle fe
trouvent toutes les efpèces-de vaiffeaux effen-
.tiels au végétal, en un mot, le réfean vafçulaire
dans lequel coulent toutes les liqueurs de la
plante. Poye^Au b ie r , É corce,P ar en ch ym e
T issu c ellulaire.
Voilà les faits que la première obfervation
des plantes préfente à l’Obfervateur. Mais
M. Duhamel étend beaucoup fur ce fsjet nos
eonnoiffance» : il fait voir que l’écorce d é -
çhirée^d’un arbre peut reproduire une nouvelle
écorce & du nouveau bois, quoiqu’elle foit
féparée du bois ; que les couches corticales qui
ne font point partie dti liber, relient toujours
corticales & n e fe convertiffent pas en couches,
ligneufes; que les couches les plus intérieures
du liber fe changent . en bois_, quoique ces
couch'es ne foient pas de même nature que les
couches corticales. Mais ce grand Phyficien a
trouvé, dun autre cêté, que le bois peut produire
une écorce nouvelle, fous laquelle on
obfervera d’abord des couches ligneufes.
j II eft clair que les couches corticales font différentes
des couches ligneufes par leurnatnre, leur
organifation , leurs circonftances ; dès les premiers
momens d’une planteligneufe, on diftingue
le feuillet qui doit devenir cta bois, d’avec le
feuillet cortical qui le couvre; auffr, en réfléchif-
fant fur ce phénomène, on eft bien tenté de
croire que la partie extérieure du liber eft def-
tmée à fe développer en écorce , tandis que
A C C
fa partie intérieure fe développe en bois. Mais
comment le bois qui fe couvre d’écorce, quand
une partie de la tige en a été privée , ne forme-
t-fi point d’écorce quand on replace d’abord
fur lui les lambeaux de l’écorce enlevée ? Comment
ces deux parties qui ne font dans leur
origine qu’un vrai mucilage ne fe confondent-
elles pas? Il nie femb!e: que, dans le premier
cas, il peut arriver que' l’écorçe fe reproduife
lur le bois, par lé prolongement du liber dés
parties coupées,& queje. hois.fe couvre d'écorce
ou parce que ces filets viennent des parties
coupées, ou bien parce que l’Aubier eft encore
pins ou moins écorce, ce qui ne pourroit pas
avoir' également lieu,.lorfque l’on couvre d'abord
la partie découverte du bois avec le lambeau
_d écorce qu’on y a enlevé,, car alors les deux
.ecorces s’entent l ’une fur l ’autre ; d’ailleurs
comme ces mucilages , qui renferment les ru-
.dimens de cette partie végétale font organifés ;•
on peut imaginer facilement qu’ils fe touchent
fans fe confondre; & cela fe concevra mieux,
fi l’on fe repréfente le liber formé par- deux
réfeaux defficés, dont l’un renferme les élé-
mens de l’écorce , &, l’autre ceux du bois.
V°y e? Bois , Couches, corticales et ligneuses
, Ecorce , L ib e r , Tissu c ellulaire!
L Accroiffemaru en longueur s’opère tant, que
les fibres n’ont pas acquis toute leur dureté. Ces
fibres commencent à fe diftinguerdans les parties
molles du bouton; aufli l’on retrouve au centre
& .au pied d’un chêne de trois fiècles, le cône
ligneux qui s’eft formé pendant Jâ première année
de fon exiftence, & qui s’eft recouvert chaque
année par un nouveau cône plus Ou moins épais
pendant tout le rems de fon Accroifiement; d’où
il réfolte que, dans le bas de la tige d’un arbre •
qui a dix ans, on trouve du bois de cet âge ;
mais le bois du fommet de la partie fupériciire
n’a qu’une année , parce que l’Aceroiffcment
en longueur fe fait par le moyen des boutons
qui entent un cône, on un arbre nouveau fur
l’ancien. Eoyqr B outon.
Lés branches comme les tiges font les déve-
loppemens des boutons qui donnent naiffance aux
bourgeons; aufli leur longueur St leurgroffeurfont
proportionnelles au temsde leur développement &
à la formation du premier cône ligneux, qui leur
adonné naiflànce. Voyei Branches , Bouton
Bourgeon;
La réunion des plaies, végétales peut bien être
regardée comme une efpèce d’Accroiffetnent,
mais elle eft trop particulière pour en parler ici;
nous la renverrons, aux mots Bou r r e le t s ,.
Gr e f f e s , Plaies reproductives,
. On trouve,danslesTranfaclionsphilofophiques.
de la Société Royale de Londres, pour l'année^
^ 7 9 > tes tables curicufes fur l’Accroiflement
de quelques arbres pendant dés ' terris donnés..
Les mefures ont été prifes à cinq pieds de.’ terre : on
A G G
e c 5 j mentatîun produit dans la forme de la graine ;
| ce fluide pénètre la plantule ; il dépofe dans Les
mailles du réfeau de ces fibres quelques parties
plus-foliées que celles qui s’y troiivoicnt y ce réfeau
y trouve par exemple ; que la tige d’un chêne j
t°é de 57 ans qui avoit 4 p. 1.1 pouces \ de cir- j
conférence en 17 5 7, avoit 5 p. 1 pou. a en 1758.
D’un hêtre de 16 ans,
I p. O pouc. 4 " • • 1 • * * I • r P- 1 Pouc' a'
D’un ormeau de 25 an s ,
1 § .1 10 \
D’un faule de 21 ans,
| Pendant l’efpace de 15 ans, la tige d’un chêne
de 2 5 ans qui av oit en 174 5.
2 p. I l pouc. A &en 1758. .5 p. 1 pouc.A:
De 60 ans , ç 11 f ......... .. L»7 ! 1 ■ *
De 80. ans, 6 5 . . . . . . . 7 8 ?
Qui ceffoit de bien végéter mais, fain."
9 p. 4 pouc. a . . . . . . . . . 1 o 1
Je ne tiré aucune conféquence de ces tables
qui pourroient intérefler les Agriculteurs, li elles .
étoient faites pour toutes les elpèces d e . terreins,
parce quelles leurindiqueroient les élemensdu
calcul qu’ils doivent faire pour évaluer les profits
que l’exploitation des boispeut promettre dans
diverfes circonftances. Mais j’aurai occafîon de -
parler encore fur ce fujet au mot A ubier.
Quels font les moyens de la nature pour produire
ces étonnam effets , comment s’augmenre
la longueur & le diamètre d’une fibre végétale ?
L ’obfervation ceffe de nous éclairer , elle nous
fournit feulement des conjeélures. M. Bonnet,
dans fes Confdérations fur les corps organifés, dans
fa Contemplation de la Nature, dans fa Palingénéfe
pkilofophique a bien avancé' cette théorie.
C’eft un fait que les rudimens des végétaux
font une gelée végétale, & qu’on peut y ramener
le bois dans la machine de Papin. Il eft encore
évident que les végétaux font compofés de diverfes
fubftances, qu’ils tirent des corps- avec
lefquels ils communiquent, ou qu’ils forment par
l’élaboration des matières qu’ils s’approprient -,
l’augmentation graduelle de folidité, de grandeur
& de poids dans les végétaux ne permet pas d’en
doiiter. Il paroît donc que les végétaux doivent'
donner naiffance à trois opérations particulières:
la foétion des matières propres à leur nourriture ;
Pélaborâtioii de ces matières pour les mettre en
état de devenir parties intégrantes du végétal ; enfin
l’affimilation de ces fucs-élaborés avec lui. Si
nous confultons l’analogie nous croirons que ces
opérations s’exécutent par le moyen des vaiflêaux,
qui fervent de filtres aux|fucs nourriciers , & qui
lés portent dans toutes les parties qu’ils . doivent
nourrir ; nous, fuppoferons même que le tiffu
cellulaire eft l’organe de cette nutrition. Voye1
Tl-SSÙ CELLULAIRE. îj
La plante deflinée dans la graine eft une gelée
végétale lorfque la graine germe ; on peut facilement
foupçonner que cette mollefle eft due à la
molleffedes fibres des lames compofées de mailles
lâches , : remplies par un. fluide affez rare : ce
fluide 5’épaiflii par la décompofltien que. la fera
s’étend, prend de la coiififtance y une nourriture
plus fubftantielle augmente la dilatation
des maillés & leur folidité , jufqu’à ce que ces
mailles foient dilatées & endurcies autant qu’elles
peuvent être : c’eft ainfi que cette gelée végétale
donne naiffance -à une fubftance herbacée , &
que cette fubftance herbacée s’endurcit & devient
fucceffivèment aubier & bois, par des filtrations
& des élaborations particulières du foc nourricier.
Il eft au moins certain que l’organifation
de l’écorce eft un peu différente de celle de l’aubier,
qui n’eft pas abfolument la. même que celle
du bois. Voyei A ubier , Bois , Sucs nourriciers.
Alors, la partie de l’écorce, qui fe change
en aubier & celle de l’aubier qui fe change
en bois augmente le diamètre de l’arbre. Ces
■ phénomènes s’obfervent non-feulement dans la
graine : ils fe répètent encore chaque année dans
for les boutons, & on y lit l’explication de tous
les faits que j’ai décrits. Dans ce fyftême Les bornes
de l’Accroiflement font celles de l’extention
en tout fens du réfeau de la fibre végétale, fa rapidité
fera proportipneiie à la facilité que les
fibres auront.à s’étendre. Il eft clair qu’on y trouve
une caufe de la dureté plus ou moins grande , .de
la vie plus ou moins prolongée des Végétaux,
de la tige plus ou moins groffe , de lu taille plus
ou moins élancée qu’ils peuvent avoir ; qu’on y
apprend l ’influence de la nourriture for la vie
végétale : ce n’eft pas to u t, on y pénètre la com-
pofition vafculaire du tiffu cellulaire ; le réfeau
, étant donné avec fes affinirés ne prend que la
: nourriture qui lui convient y la foupleile de fes
mailles, & la faculté foçante de fes fibres déterminent
la quantité de nourriture quelles reçoivent
chaque jour*, enfin la dilatabilité des parties
du réfeau fera les bornes de i’A.ccroiffement
de la plante en hauteur &.en largeur. Lapoflibi-
liré de ramener le bois à la forme du réfeau, l’accélération
ou le retard de l’Accroiffement des
plantes qu’on peut produire à fon gré, pajr l’augmentation
du la diminution de la nourriture
quelles peuvent prendre , font des probabilités
lingulièrement frappantes. en faveur de cettè
théorie.
Mais quelle eft la caufe de cette aflîmilation
i des .focs nourriciers avec les végétaux ? elle a
certainement lieu puifque les plantes, croiffent,
puifqu’il s’y forme en même-tems tant de parties
différentes : mais c’eft ici que robfcurité redouble.
Ne pourroit-onpas cependant foupçonner que
cette aflimilation eft déterminée par une affinité
particulière des élemens des différentes fibres avec
\ les parties nourricières qui leur conviennent? alors
û l’on imagine que les élemens de ces fibres font
en proportion avec la dureté que les. fibres doi-y
À 2