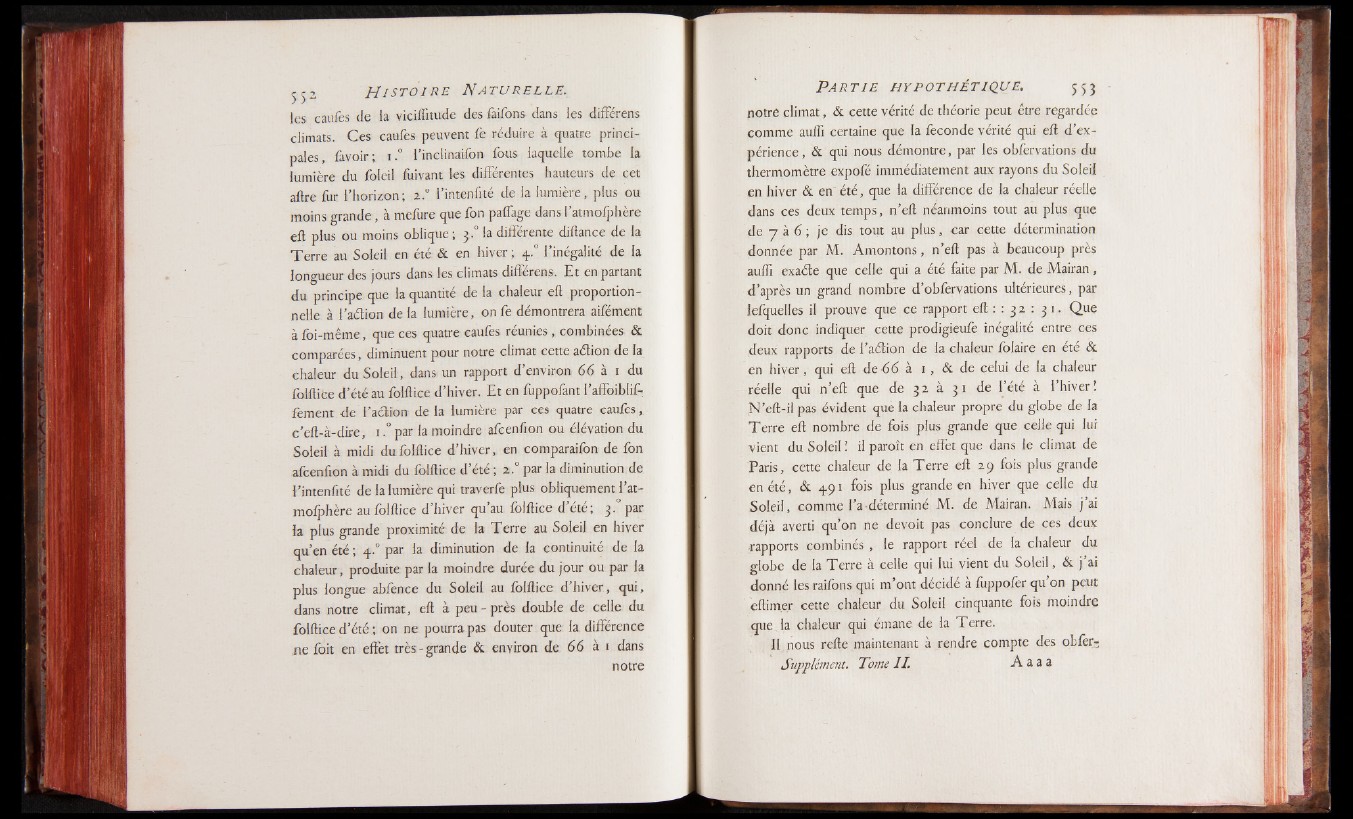
552 H i s to i r e N a tur e l l e .
les caufes de la viciffitude des faifons- dans les différens
climats. Ces caufes peuvent fe réduire à quatre principales,
favoir; i.° l’inciinaifon fous laquelle tombe la
lumière du foleil fùivant les différentes hauteurs de cet
aftre fur l’horizon; z.° l’intenfité de la lumière, plus ou
moins grande, à mefure que fon paffage dans f atmofphère
eft plus ou moins oblique ; 3,0 la différente diflance de la
Terre au Soleil en été & en hiver ; 4.0 l ’inégalité de la
longueur des jours dans les climats différens. Et en partant
du principe que la quantité de la chaleur eft proportionnelle
à l ’adion delà lumière, onfe démontrera aifément
à foi-même, que ces quatre caufes réunies, combinées, &
comparées, diminuent pour notre climat cette aéfion de la
chaleur du Soleil , dans un rapport d’environ 66 à 1 du
folftice d’été au folftice d’hiver. Et en fuppofant l’affoiblif-
fement de faction de la lumière par ces quatre caufes,
c ’eft-à-dire, 1 .° par la moindre afeenfion ou élévation du
Soleil à midi du folftice d’hiver, en comparaifon de fon
afeenfion à midi du folftice d’été ; 2,° par la diminution de
l ’intenfité de la lumière qui traverfe plus obliquement l’atmofphère
au folftice d’hiver qu’au folftice d’été; 3.° par
la plus grande proximité de la Terre au Soleil en hiver
qu’en été ; 4.0 par la diminution de la continuité de la
chaleur , produite par la moindre durée du jour ou par la
plus longue abfence du Soleil au folftice d’hiver, qui,
dans notre climat, eft à peu-près double de celle du
folftice d’été ; on ne pourra pas douter que la. différence
ne foit en effet très-grande & environ de 66 à 1 dans
notre
notre climat, & cette vérité de théorie peut être regardée
comme aufti certaine que la féconde vérité qui eft d’expérience,
& qui nous démontre, par les obfervations du
thermomètre expofé immédiatement aux rayons du Soleil
en hiver & en' été, que la différence de la chaleur réelle
dans ces deux temps, n’eft néanmoins tout au plus que
de y à 6 ; je dis tout au plus, car cette détermination
donnée par M. Amontons, n’eft pas à beaucoup près
aufti exacte que celle qui a été faite par M. de Mairan,
d ’après un grand nombre d’obfervations ultérieures, par
lefquelles il prouve que ce rapport eft : : 3 2 : 31. Que
doit donc indiquer cette prodigieufe inégalité entre ces
deux rapports de i’aétion de la chaleur fblaire en été &
en hiver, qui eft d e -66 à 1 , & de celui de la chaleur
réelle qui n’eft que de 32 à 31 de l’été à l’hiverî
N ’eft-il pas évident que la chaleur propre du globe de la
Terre eft nombre de fois plus grande que celle qui lui
vient du Soleil ! il paraît en effet que dans le climat de
Paris, cette chaleur de la Terre eft 29 fois plus grande
en été, & 491 fois plus grande en hiver que celle du
Soleil, comme fa-déterminé M. de Mairan. Mais j ’ai
déjà averti qu’on ne devoit pas conclure de ces deux
rapports combinés , le rapport réel de la chaleur du
globe de la Terre à celle qui lui vient du Soleil, & j’ ai
donné les raifons qui m’ont décidé à fuppofer qu’on peut
eftimer cette chaleur du Soleil cinquante fois moindre
que la chaleur qui émane de la T erre.
II nous refte maintenant à rendre compte des obfèr-
Supplément. Tome IL A a a a