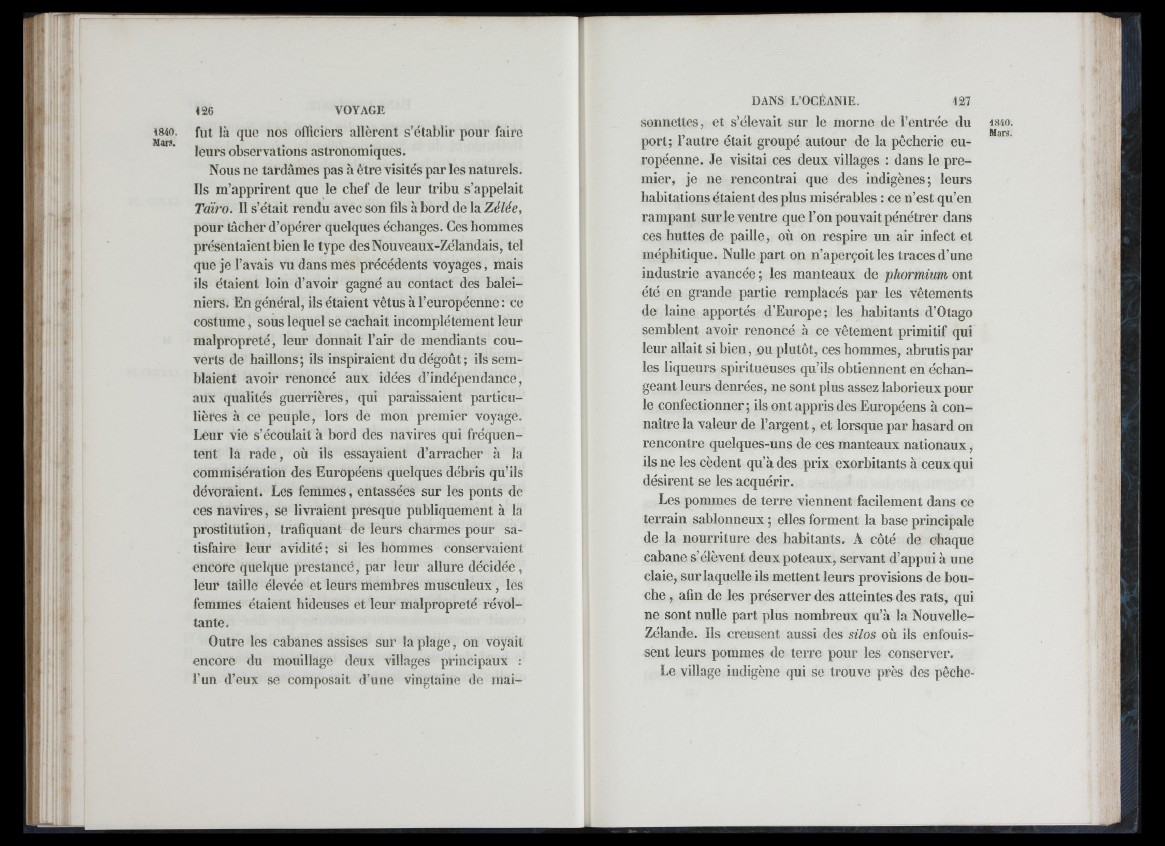
Ai l'i
1840.
Mars.
i
fui là que nos ofliciers allèrent s’établir pour faire
leurs observations astronomiques.
Nous ne tardâmes pas à être visités par les naturels.
Ils m’apprirent que le chef de leur tribu s’appelait
Tdiro. Il s’était rendu avec son fils à bord de la Zélée,
pour tâcher d’opérer quelques échanges. Ces hommes
présentaient bien le type desNouveaux-Zélandais, tel
que je l’avais vu dans mes précédents voyages, mais
ils étaient loin d’avoir gagné au contact des baleiniers.
En général, ils étaient vêtus à l ’européenne : ce
costume, sous lequel se cachait incomplètement leur
malpropreté, leur donnait l’air de mendiants couverts
de haillons; ils inspiraient du dégoût; ils semblaient
avoir renoncé aux idées d’indépendance,
aux qualités guerrières, qui paraissaient particulières
à ce peuple, lors de mon premier voyage.
Leur vie s’écoulait à bord des navires qui fréquentent
la rade, où ils essayaient d’arracher à îa
commisération des Européens quelques débris qu’ils
dévoraient. Les femmes, entassées sur les ponts de
ces navires, se livraient presque publiquement à la
prostitution, trafiquant de leurs charmes pour satisfaire
leur avidité; si les hommes conservaient
encore quelque prestaiicé, par leur allure décidée,
leur taille élevée et leurs membres musculeux, les
femmes étaient hideuses et leur malpropreté révoltante.
Outre les cabanes assises sur la plage, on voyait
encore du mouillage deux villages principaux :
i’un d’eux se composait d’une vingtaine de maisonnettes,
et s’élevait sur le morne de l’entrée du
port; l’autre était groupé autour de la pêcherie européenne.
Je visitai ces deux villages : dans le premier,
je ne rencontrai que des indigènes; leurs
habitations étaient des plus misérables : ce n’est qu’en
rampant sur le ventre que Ton pouvait pénétrer dans
ces huttes de paille, où on respire un air infect et
méphitique. Nulle part on n’aperçoit les traces d’une
industrie avancée ; les manteaux de phormium ont
été en grande partie remplacés par les vêtements
de laine apportés d’Europe; les habitants d’Otago
semblent avoir renoncé à ce vêtement primitif qui
leur allait si bien, ou plutôt, ces hommes, abrutis par
les liqueurs spiritueuses qu’ils obtiennent en échangeant
leurs denrées, ne sont plus assez laborieux pour
le confectionner; ils ont appris des Européens à connaître
la valeur de l’argent, et lorsque par hasard on
rencontre quelques-uns de ces manteaux nationaux,
ils ne les cèdent qu’à des prix exorbitants à ceux qui
désirent se les acquérir.
Les pommes de terre viennent facilement dans ce
terrain sablonneux ; elles forment la base principale
de la nourriture des habitants. A côté de chaque
cabane s’élèvent deux poteaux, servant d’appui à une
claie, sur laquelle ils mettent leurs provisions de bouche
, afin de les préserver des atteintes des rats, qui
ne sont nulle part plus nombreux qu’à la Nouvelle-
Zélande. ils creusent aussi des silos où ils enfouissent
leurs pommes de terre pour les conserver.
Le village indigène qui se trouve près des pêche