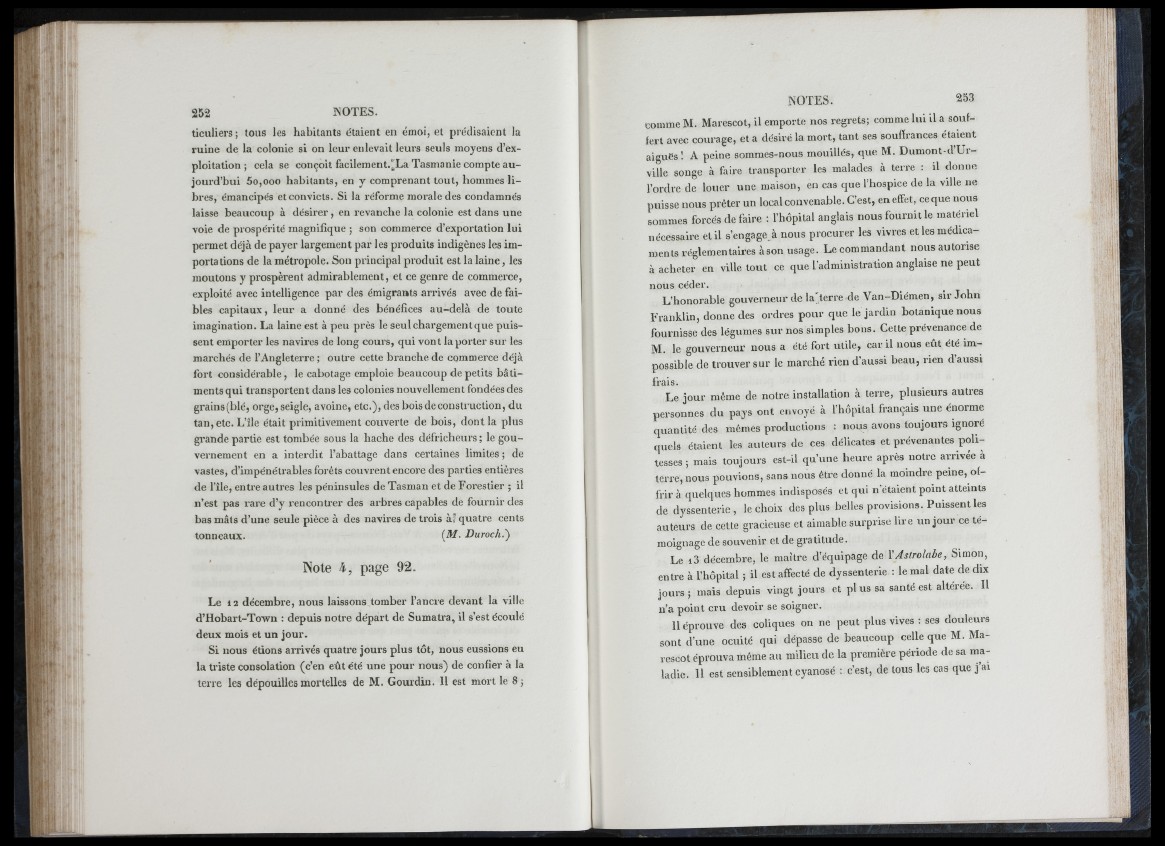
'i
;
'y
Iî. i . ‘ r-
\ î i
! ;
|>
|Gu,
I
I ‘ i
I' ’
ticulie rs; tous les habitants étaient en émoi, et prédisaient la
ru in e de la colonie si on leur enlevait leui’s seu ls moyens d’exploitation
; cela se conçoit facilement.¡La Tasmanie compte au jou
rd ’h u i 5o ,ooo habitants, en y comprenant tout, hommes l i bres,
émancipés et convicts. S i la réforme morale des condamnés
laisse beaucoup à d é s ir e r , en revanche la colonie est dans u ne
voie de prospérité magnifique ; son commerce d’exportation lu i
permet déjà de payer largement par les produits indigènes les importations
de la métropole. Son principal p roduit est la la in e , les
moutons y prospèrent admirablement, et ce genre de commei'ce,
exploité avec intelligence par des émigrants arrivés avec de faibles
cap itau x , leur a donné des bénéfices a u -d e là de toute
imagination. La laine est à peu près le seul chargement que p u issent
emporter les navires de long cours, q u i vont la porter sur les
marchés de l’Angleterre ; outre cette branche de commerce déjà
fort considérable , le cabotage emploie beaucoup de petits b â timents
q u i transportent dans les colonies nouvellement fondées des
grains (blé, orge, seigle, avoine, e tc .), des bois d e con stru c tion , du
tan, etc. L’île était primitivement couverte de b o is, dont la p lu s
grande partie est tombée sous la hache des défricheurs ; le g o u vernement
en a interdit l’abattage dans certaines lim ite s; de
vastes, d’impénétrables forêts couvrent encore des parties entières
de l’île , entre autres les péninsules de Tasman et de Forestier ; il
n ’est pas rare d’y rencontrer des arbres capables de fournir des
bas mâts d’une seule pièce à des navires de trois àf quatre cents
tonneaux. (M. Duroch.)
Note 4 , page 92.
Le 12 décembi’e, n ous laissons tomber l’ancre devant la ville
d ’H ob a r t-T ow n : depuis notre départ de Sumaü’a, il s’est écoulé
deu x mois et u n jou r .
S i nous étions arrivés quatre jours p lu s tôt, nous eussions eu
la triste consolation (c ’en eût été u ne pour n o u s ) de confier à la
terre les dépouilles mortelles de M. Gourdin. Il est m o i t i é 8 ;
comme M. Marescot, il emporte nos regrets; comme lu i il a souffert
avec courage, et a désiré la mort, tant ses souffrances étaient
a ig u é s l A peine sommes-nous m ou illé s, que M. D um o n t -d U r -
v ille songe à faire transporter les malades à terre ; il donne
l’ordre de louer u ne maison, en cas que l’hospice de la ville ne
p a isse nous prêter un local convenable. C’est, en effet, c eq u e nous
sommes forcés de faire : l’hôpital anglais nous fournit le matériel
nécessaire et il s’engage, à nous procurer les vivres et les médicaments
réglementaires à son usage. Le commandant n ous autorise
à acheter en ville tout ce que l'administration anglaise ne peut
n ou s céder.
L’honorable gouverneur de la terre de V a n -D iém en , sir J ohn
F ranklin, donne des ordres p ou r que le jardin botanique nous
fournisse des légumes sur nos simples b on s. Cette prévenance de
M. le gouverneur nous a été fort u tile , car il uous eut été im p
ossible de trouver su r le marché rien d’aussi beau, rien d’aussi
frais.
Le jour même de notre installation à terre, p lu sieu r s autres
personnes d u pays ont envoyé à l’hôpital français une enorme
quantité des mêmes productions : nous avons toujours ignoré
quels étaient les auteurs de ces délicates et prévenantes p o litesses
; mais toujours est-il qu’une heure après notre arrivée à
terre, nous pou v ion s, sans n ous être donné la moindre p e ine , o i-
frir à quelques hommes in disposé s et qui n ’étaient p oint atteints
de d y ssen te r ie , le choix des plu s b e l l e s provisions. P u issen t les
auteurs de cette gracieuse et aimable surprise lir e un jou r ce témoignage
de souvenir et de gratitude.
Le i3 décembre, le maître d’équipage à e X Astrolabe, Simon,
entre à l’hôpital ; il est affecté de dyssenterie : le mal date de dix
jo u r s ; mais depuis vingt jours et p lu s sa santé est altérée. Il
n ’a p o in t c ru devoir se soigner.
11 éprouve des coliques on ne peut p lu s vives : ses douleurs
sont d’u n e ocuité qui dépasse de beaucoup celle q u e M. Marescot
éprouva même au m ilieu de la première période de sa maladie.
11 est sensiblement cyanosé : c’est, de tous les cas que j’ai
î'