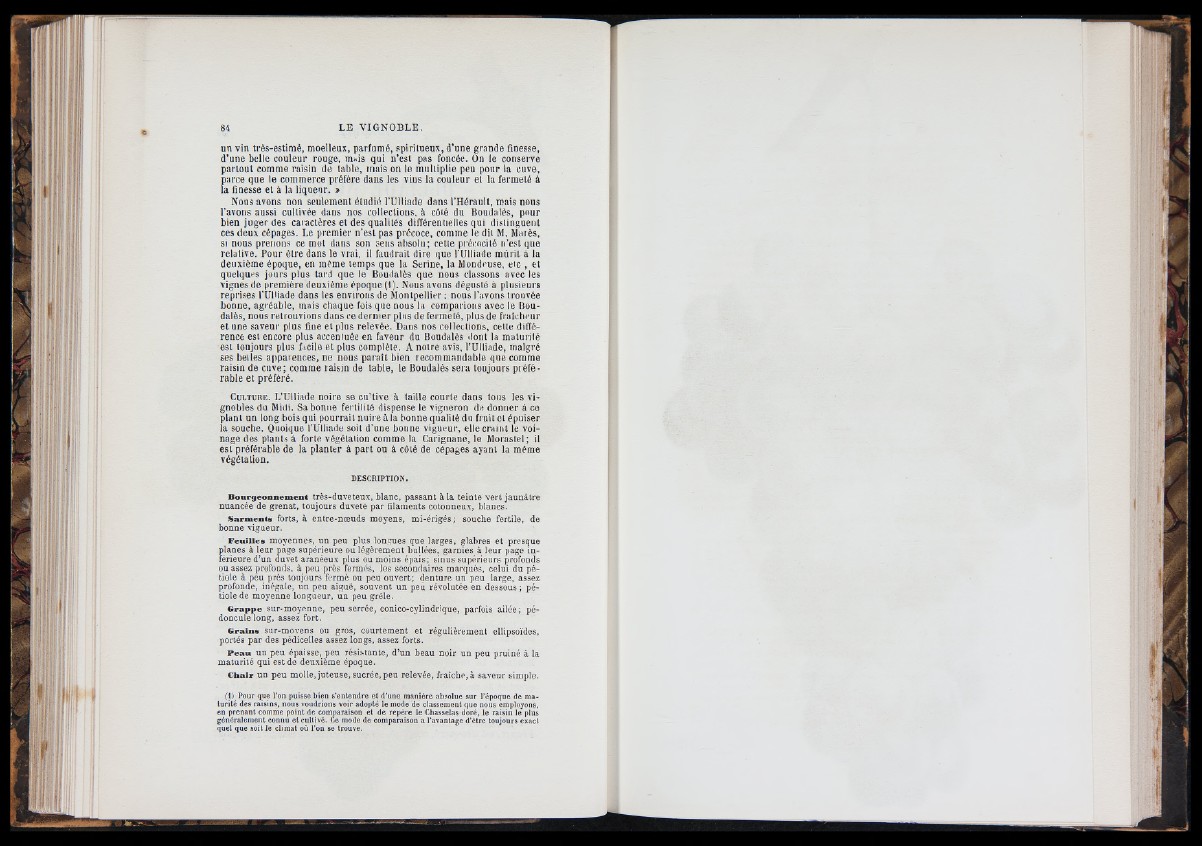
j:r
iLf M'lt!
i i
fit
'■
i i 'i *
un vin très-estimé, moelleux, parfumé, spirilueux, d'une grande finesse,
d ’une belle couleur rouge, mais qui n ’est pas foncée. On le conserve
partout comme raisin de table, rnais on le multiplie peu pour la cuve,
pai'ce que le commerce préfère dans les vins la couleur et la fermeté à
la finesse et à la liqueur. »
Nous avons non seulement étudié l'Ulliade dans l’Hérault, mais nous
l’avons aussi cultivée dans nos collections, à côié du Boudalès, pour
bien ju g e r des caractères et des qualités différeniielles qui disiingueiit
ces deux cépages. Le premier n'est pas pi-écoce, comme le dil M. Marès,
si nous pr-erions ce mot dans son sens absolu; celle pr-écncilé n’est que
relative. Pour être dans le vrai, il faudrait dire que f Ulliade mûrit à la
deuxième époque, en même temps que la Serine, la Mondeuse, eic , et
quelques jours plus lard que le Boudalès que nous classons avec les
vignes de première deuxième époque (1). Nous avons dégtrsié à plusieurs
reprises l’Ulliade dans les envrrons de Montpellier; nous l’avons Ir-oirvée
bonne, agréable, mais chaque fois que nous la comparions avec le Boudalès,
nous retrouvions daus ce d ernier plus de fermeté, plus de fraîcheur
et une saveur plus flue el plus relevée. Dans nos colleclions, celte différence
est encore plus acceniuée en faveur du Boudalès dont la malurilé
est toujours plus facile et plus complète. A notre avis, l’Ulliade, malgré
ses belles apparences, ne nous paraît bien recommandable qne comme
raisin de cuve; comme raisin de table, le Boudalès sera toujours p ré fé rable
et préféré.
C u l t u r e . L’Ulliade noire se cultive à taille courle dans tons les vignobles
du Midi. Sa bonne fertilité dispense le vigneron de donner â co
plant un long bois qui pourrait nuire à la bonne qiialiièdu fruit et épuiser
la souche. Quoique l'Ulliade soit d ’une bonne vigueur, elle craint le voi-
nage des plants à forte, végélaiion comme la Carignane, le Moraslel; il
e st préférable de la planter à p a rt ou à côté de cépages ayant la même
végélaiion.
D E S C R IP T IO N .
Bourgeonnement t rè s -d u v e te u x , b lan c , p a s s an t à la t e in t e v e r t ja u n â t r e
n u an c é e d e g ren a t, tou jo u r s d u v e té p a r filam en ts c o to n n eu x , b lan c s .
Sarments forts, à en t re -noe u d s m o y e n s , m i- é r ig é s ; so u ch e fe r tile , de
b o n n e v ig u e u r .
Fenilles m o y e n n e s , u n peu p lu s lo n g u e s q u e la r g e s , g la b re s e t p resq u e
p lan e s à le u r p a ge su p é r ie u re ou lé g è rem en t h u ilé e s , g a rn ie s à leu r p a ge in fé
r ieu re d ’un d u v e t a ran é e u x p lu s ou m o in s é p a is ; s in u s su p é r ie u r s profon ds
ou a s sez profon ds, à peu près fe rm é s , le s se co n d a ire s m a rq u é s , c e lu i du p é t
io le à peu près tou jou r s fe rm é ou peu o u v e r t ; d en tu re u n p eu la r g e , a s se z
pro fon d e , in é g a le , un peu a ig u ë , so u v en t un p eu ré v o lu té e en d e s so u s ; p é t
io le d e m o y e n n e lo n g u eu r , u n peu g r ê le .
Grappe S u r -m o y en n e , p eu s e r ré e , co n ico -c y lin d r iq u e , p a rfo is a ilé e ; p é d
o n cu le lon g , a s se z for t.
Grains su r -m o v en s ou g ro s , co u r tem en t e t r é g u liè rem e n t e llip so ïd e s ,
portés p a r d e s p éd ic e lle s a s s e z lon g s , a s se z forts.
Pean u n p eu ép a is s e , p eu ré s is tan te , d ’u n b e a u n o ir un p eu p ru in é à la
m a tu r ité q u i e s t de d e u x ièm e époque.
Chair u n p eu m o lle , ju te u s e , su c ré e , p eu r e le v é e , f ra îc h e , à s a v e u r s im p le .
(1) P o u r q u e l ’ o n p u is s e b ie n s’ e n t e n d r e e t d ’u n e m a n iè r e a b s o lu e s u r l ’ é p o q u e d e m a tu
r i t é d e s r a i s in s , n o u s v o u d r io n s v o i r a d o p t é le m o d e d e c la s s em e n t q u e n o u s em p lo y o n s ,
e n p r e n a n t c om m e p o in t d e c om p a r a is o n e t d e r e p è r e le C h a s s e la s d o r é , le r a i s in le p lu s
g é n é r a lem e n t c o n n u e l c u l t iv é . C e m o d e d e c om p a r a is o n a l ’a v a n ta g e d’ e t r e t o u jo u r s e x a c t
q u e l q u e s o it le c l im a t o ù l ’ o n s e t ro u v e .