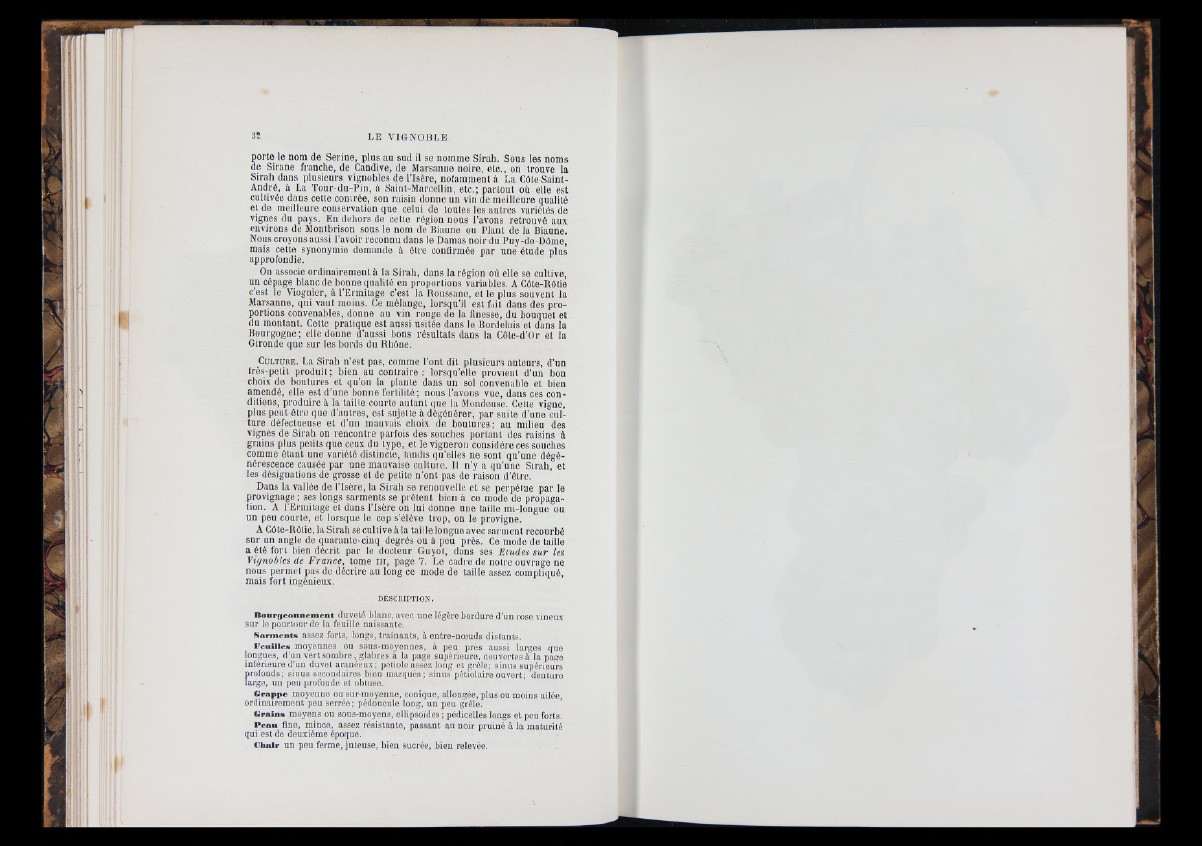
porte le nom de Serine, pins au sud il se nomme Sirah. Sous les noms
de Sirane franche, de Candive, de Marsanne noire, etc., on trouve la
Sirah dans plusieurs vignobles de l’Isère, notamment à La Côle-Saint-
André, à La ïo n r-d u -P in , à Saint-Marcellin, etc.; partout où elle est
cultivée dans celte comrée, son raisin donne un vin de meilleure qualité
et de meilleure conservation que celui de toutes les autres variétés de
vignes du pays. En dehors de cette région nous l’avons retrouvé aux
environs de Montbrison sous le nom de lüaune ou Plant de la Biaune.
Nous croyons aussi l’avoir reconnu dans le Damas noir du Puy-de-Dôme,
mais cette synonymie demande à être confirmée par une étude plus
approfondie.
On associe ordinairement à la Sirab, dans la région où elle se cultive,
un cépage blanc de bonne qualité en proportions variables. A Côte-Rôtie
c’est le Viognier, à l’Ermitage c’est la Roussane, et le plus souvent la
Marsanne, qui vaut moins. Ce mélange, lorsqu’il est fait dans des proportions
convenables, donne au vin rouge de la finesse, du bouquet el
du montant. Celle pratique est aussi usitée dans le Bordelais el dans la
Bourgogne ; elle donne d ’aussi bons résultats dans la Côte-d’Or et la
Gironde que sur les bords du Rhône.
CuLTUiiE. La Sirah n’est pas, comme l’ont dit plusieurs auteurs, d ’un
très-petit produit; bien au c o n tra ire : lorsqu’elle provient d’un bon
choix de boutures et qu ’on la plante dans un sol convenable et bien
amendé, elle est d ’une bonne fertilité; nous l’avons vue, dans ces conditions,
produire à la taille courle autant que la Mondeuse. Cetle vigne,
plus peut-être que d ’autres, est sujette à dégénérer, par suite d’une culture
défectueuse et d ’un mauvais choix de boutures; au milieu des
vignes de Sirah on rencontre parfois des souches porlant des raisins à
grains plus petits que ceux du type, el le vigneron considère ces souches
comme étant une variété distincte, tandis qu’elles ne sont qu'une dégénérescence
causée par une mauvaise culture. Il n ’y a qu ’une Sirah, et
les désignations de grosse et de petite n'ont pas de raison d ’être.
Dans la vallée de l’tsère, la Sirah se renouvelle et se perpétue par le
provignage; ses longs sarments se prêtent bien à ce mode de propagation.
A l’Ermitage et dans l’Isère on lui donne une taille mi-longue ou
un peu courle, et lorsque le cep s’élève trop, on le provigne.
A Côle-Rôtie,laSiralise cultive à la taille longue avec sarment recourbé
sur un angle de quarante-cinq degrés ou â peu près. Ce mode de taille
a été fort bien décr it par le docteur Guyot, dans ses Ettides su r les
Vignobles de France, tome n i, page 7. Le cadre de noire ouvrage ne
nous permet pas de décrire au long ce mode de taille assez compliqué,
mais fort ingénieux.
DESCRIPTION.
Boiiryconncmrnt duvctô lilanc, avec une légère bordure d ’un rose vineux
sur le pourtour de la feuille naissante.
Karmentffi. assez forts, longs, tra înants, à entre-noeuds distants.
Fcuillcai moyennes ou sous-moyennes, à peu près aussi larges quo
longues, d ’un vert sombro, glabres à la page supérieure, couvertes à la page
intérieure d ’un duvet aranéeux; pétiole assez long et grêle; sinus supérieurs
profonds; sinus seconilaires bien ma rqués; sinus pétiolaire ouvert; denture
large, un peu profonde et olituse.
Grappe moyenne ou sur-moyenne, conique, allongée, plus ou moins ailée,
ordinairement peu serrée; pédoncule long, un peu grélc.
Grains moyens ou sous-moycns, ellipsoïdes; pédicelles longs et peu forts.
Peau fine, mince, assez résistante, passant au noir pru in é à la maturité
qui est de deuxième époque.
Chair un peu ferme, juteuse, bien sucrée, bien relevée.