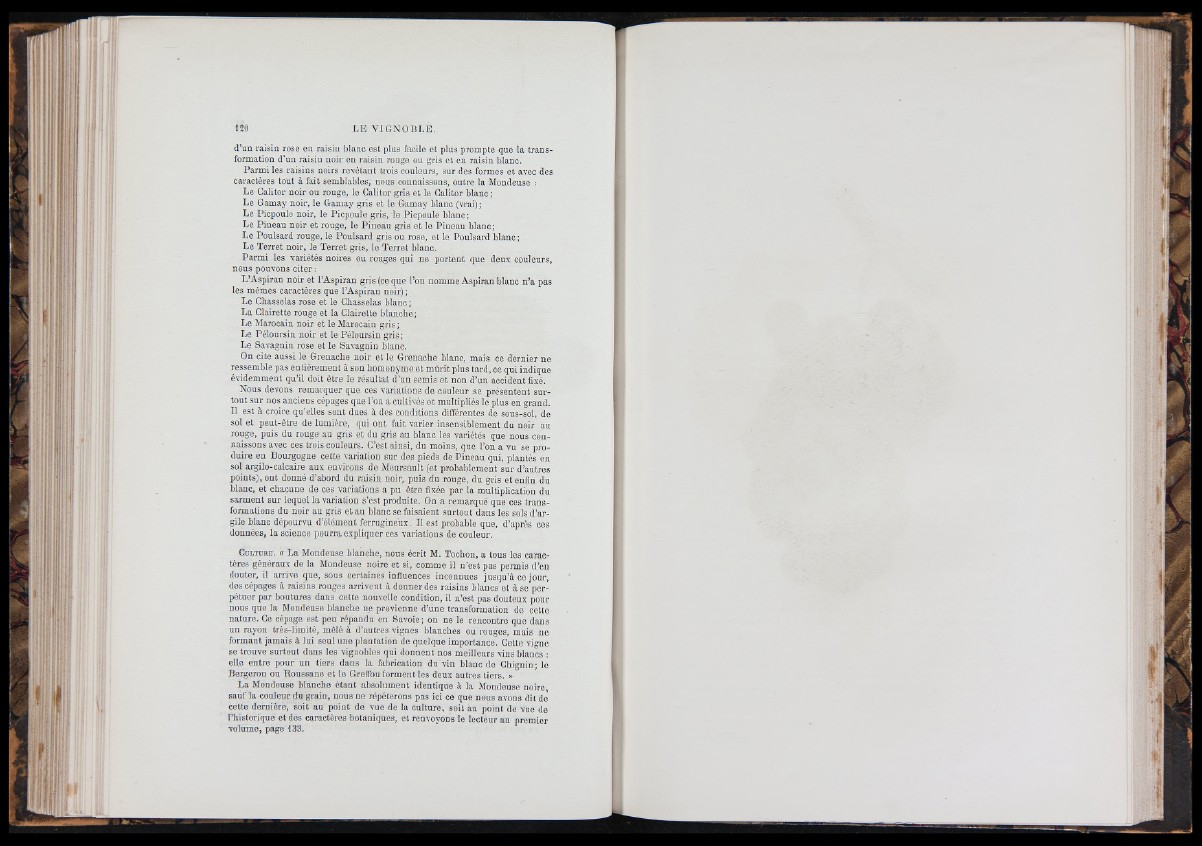
: i?
■ ! , M
ril' .;
'i- ■
ib :
■ i •
: i:
1 f U I
.: I-,
f11!'
d ’ua raisin i-oso en raisin blanc est plus facile et plus prompte que la tra n s formation
d’un raisin no ir en raisin rouge ou gris et en raisin blanc.
P a rm i les raisins noirs rev êtan t trois couleurs, su r des formes et avec des
caractères tout à fait semblables, nous connaissons, outre la Mondeuse :
Le Calitor noir ou rouge, le Calitor gris et le Calitor blanc;
L e Gamay noir, le Gamay gris et le Gamay blanc (vrai);
Lo Picpoule noir, le Picpoule gris, le Picpoule blanc;
Le P in e au no ir et rouge, le P in e au gris et le P in eau blanc;
Le Poulsard rouge, le Poulsard gris ou rose, et le Poulsard blanc;
L e Te rre t noir, le Te rre t gris, le Te rre t blanc.
P a rm i les variétés noires ou rouges qui ne p ortent que deux couleurs,
nous pouvons citer :
L ’Aspiran no ir et l ’Aspiran gris (ce que l’on nomme A spiran blanc n ’a pas
les mêmes caractères que l ’Aspiran noir) ;
Le Chasselas rose et le Chasselas blanc;
La Clairette rouge et la Clairette blanche;
Le Marocain noir e t le Marocain gris ;
Le Pélonrsin noir et le Péloursin gris;
Le Savagnin rose et le Savagnin blanc.
On cite aussi le Grenache noir et le Grenache blanc, mais ce dernier no
ressemble pas entièrement à son homonyme et m û rit plus tard, ce qui indique
évidemment qu ’il doit être le résu ltat d ’un semis et non d’un accident flxé.
Nous devons remarquer que ces variations de couleur se présen ten t surtout
su r nos anciens cépages que l’on a cultivés et multipliés le plus en grand.
Il est à croire qu ’elles sont dues à des conditions différentes de sous-sol, de
sol et p eu t-être de lumière, qui ont fait varier insensiblement du noir au
rouge, puis du rouge au gris et du gris au blanc les variétés qne nous connaissons
avec ces trois couleurs. C’est ainsi, du moins, que l ’on a vu se produire
en Bourgogne cette variation sur des pieds de P in eau qui, plantés en
sol argilo-calcaire aux environs de Meursauit (et probablement su r d ’autres
points), ont donné d ’abord du raisin noir, puis du rouge, du gris et enfin du
blanc, et chacune de ces variations a pu être fixée p a r la multiplication du
sarmen t sur lequel la variation s’est produite. On a remarqué que ces tra n s formations
du no ir au gris et au blanc se faisaient surtout dans les sols d ’a rgile
blanc dépourvu d’élément ferrugineux. Il est probable que, d ’après ces
données, la science pourra expliquer ces variations de couleur.
Cl-ltdbb. (t La Mondeuse blanche, nous écrit M. Tochon, a tous les caractères
généraux de la Mondeuse noire et si, comme il n ’est pas permis d ’en
douter, il arrive que, sous certaines influences inconnues ju sq u ’à co jour,
des cépages à raisins rouges arriven t à donner des raisins blancs et à so perp
étu er par boutures dans cette nouvelle condition, il n ’est pas douteux pour
nous que la Mondeuse blanche ne provienne d’une transformation do cette
nature. Ge cépage e st peu répandu en Savoie; on ne le rencontre quo dans
u n rayon très-limité, mêlé à d ’autres vignes blanches ou ronges, mais ne
formant jamais à lui seul une p lantation de quelque importance. Cette vigne
se trouve surtout dans les vignobles qui donnent nos meilleurs vins blancs ;
elle en tre pour un tiers dans la fabrication du vin blanc de Chignin; le
Bergeron ou Roussane et le Greffon forment les deux autres tiers. »
L a Mondeuse blanche é tan t absolument identique à la Móndense noire
sauf la couleur du grain, nous ne répéterons pas ici ce que nous avons dit de
cette dernière, soit au point de vue de la culture, soit au point de vue de
l ’historique et des caractères botaniques, e t renvoyons le lecteur au premier
volume, page 133. il