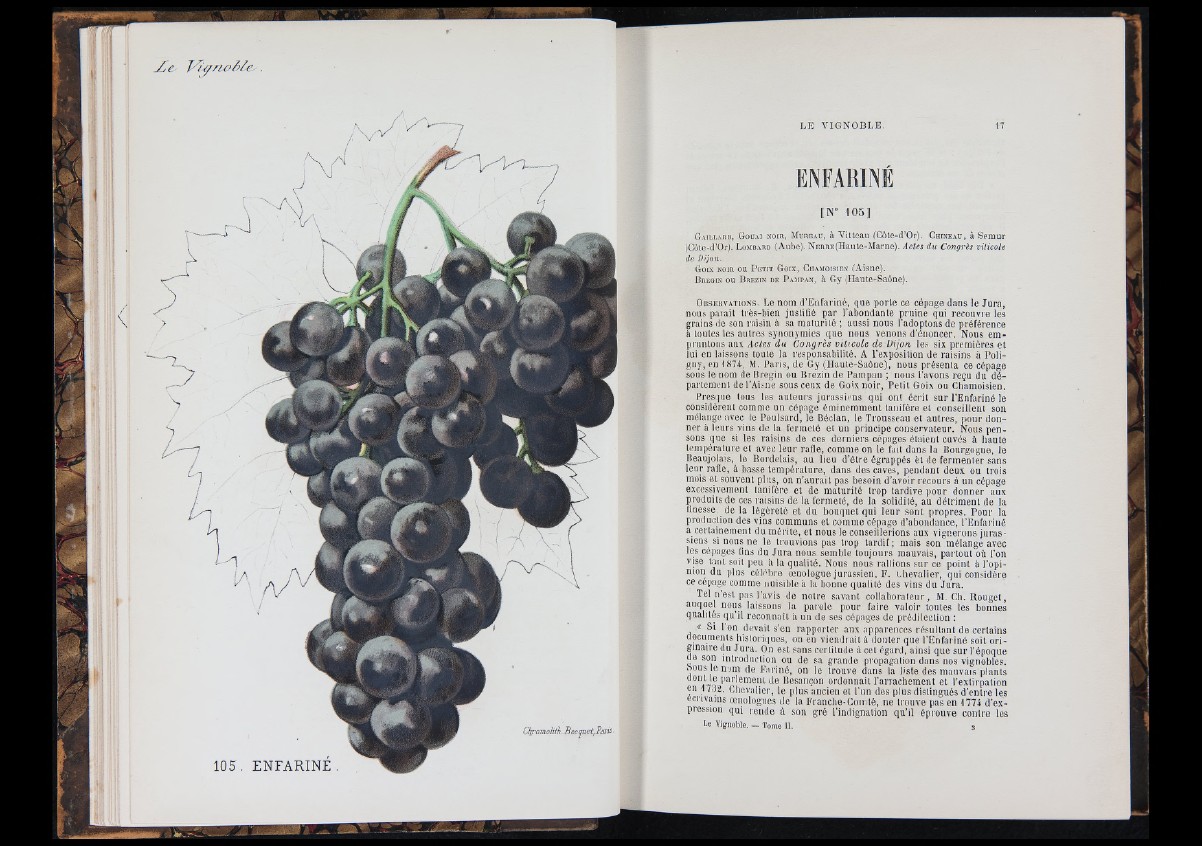
Z c
ENFARINÉ
[N» 1 0 5 ]
6 ,u l i . . v k d , G o ü .v i .Nom, M ü r e .v u , à ViUcau (Côte-d’Or). CHraE.4 0 , à Semur
(Côte-d’Or). L o m d a b d (Aube). N e r r e (Haute-Marne). Actes du Congrès viHcole
de Dijon.
Goi.x N om ou P e t i t G o i x , C h a m o i s i e .x (Aisne).
B r e g i .n o u B r e z in d e P a m p a n , à Gy (Ilaute-Saone).
O d s e r v a t io n s . Le nom il’Eufariné, que porte ce cépage dans le Jura,
nous païaît très-bien jusülié par l’abondante pruine qui recouvre les
grains de son raisin à sa maturité ; aussi nous l’adoptons de préférence
à toutes les aiitre.s synonymies que nous venons d'énoncer. Nous empruntons
aux Actes du Congrès viticule de Dijon les six premières et
lui en laissons toute la responsabilité. A l’exposition de raisins à Poligny,
en 1874, M. Pans, de Gy (Haule-Saône), nous présenta ce cépage
sous le nom de Bregin ou Brezin de Pampan ; nous l'avons reçu du département
de l'AiMie sous ceux de Goix noir, Pelit Goix ou Chamoisien.
Presque tous les auteurs jurassiens qui ont écrit sur l’Enfariné le
considèrent comme un cépage éminemment lanifère et conseillent son
mélange avec le Poulsard, le Béclan, le Trousseau et autres, pour donner
à leurs vins de la fermeté et un principe conservateur. Nous pensons
que si les raisins de ces derniers cépages étaient cuvés à haute
température et avec leur rafle, comme on le fait dans la Bourgogne, le
Beaujolais, le Bordelais, au lieu d ’être égroppés et de fermenter sans
leur rafle, à basse lempéi'alure, dans des caves, pendant deux ou trois
mois et souvent plus, on n ’aura it pas besoin d’avoir recours à un cépage
excessivement lanifère et de maturité trop tardive pour donner aux
produits de ces raisins de la fermeté, de la solidité, au détriment de la
linesse de la légèreté et du bouquet qui leu r sont propres. Pour la
production des vins communs et comme cépage d’abondance, l'Enfariiié
a certainement du mérite, et nous le conseillerions aux vignerons ju ra s siens
si nous ne te Irouvions pas trop tardif ; mais son mélange avec
les cépages fins du Ju ra nous semble toujours mauvais, partout où l'on
vise tant soit peu à la qualité. Nous nous rallions sur ce point à l'opinion
du plus céli'hre oenologue juras.sien, P. Lhevalier, qui considère
ce cépage comme nuisible à la bonne qualité des vins du Jura.
Tel n’est pas l’avis de notre savant collaborateur, M. Cli. Rouget,
auquel nous laissons la parole pour faire valoir toutes les bonnes
qualités qu'il reconnaît à un de ses cépages de prédilection :
« Si l'on devait s’en rapporler anx apparences résultant de ccriains
uocumenls lnslorii|uos, on en viendrait à douter que l’Erifai iné soit o riginaire
du Jura. On est sans certitude à cet égard, ainsi que su r l’époque
de son introduction ou de sa grande propagation dans nos vignobles,
sous le nom de Fariné, on le trouve dans la liste des mauvais plants
, J,? Besançon ordonnait l’arrachement et l’extirpation
en 17.12. Chevalier, le plus ancien et l’un des plus distingués d'entre les
écrivains oenologues de la Franche-Comté, ne trouve pas en 1774 d’expression
qui rende à son gré l’indignation qu’il éprouve contre les
Le Vignoble. — Tome II. 3