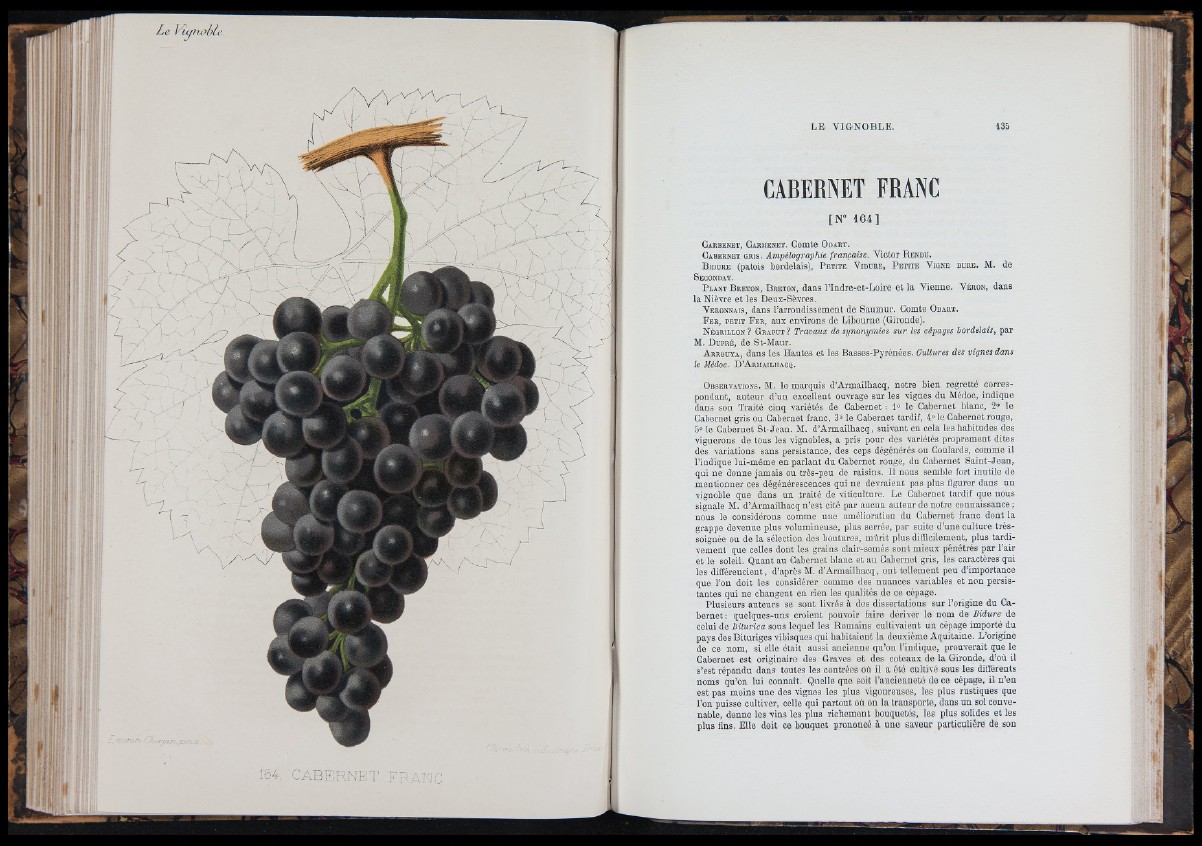
CABERNET FRANC
[ N ' ’ 1 6 4 ]
G a r b b n e t , G a w i e n e t . Gomte O d a r t .
C a b e r n e t g r i s . Ampélographie française. Victor R e n d u .
B id u r b (patois bordelais), P e t i t e V id u r e , P e t i t e V ig n e d u r e . M. de
S e c o n d â t .
P l a n t B r e t o n , B r e t o n , dans l’Iad re -e t-L o ire et la Vienne. V é r o n , dans
la Nièvre et les I)eux-Sèvres.
V e r o n n a i s , dans l’arrondissement de Saumur. Gomte O d a r t .
F e r , p e t i t F e r , aux environs de Libourne (Gironde).
N é g r i l l o n ? G r a p u t ? Travaux de synonymies su r les cépages lordelaîs, par
M. D u p r é , d e St-Manr.
A r r o ü y a , dans les Hautes et les Basses-Pyrénées. Cultures des vignes dans
le Médoc. D ’A r m a i l h a c q .
O b s e r v a t i o n s . M. le marquis d’Armailhacq, notre hien regretté correspondant,
au teu r d’un excellent ouvrage sur les vignes du Médoc, indique
dan s son Traité cinq variétés de Cabernet : 1° le Gabernet blanc, 2® le
Cabernet gris ou Gabernet franc, 3° le Gabernet tardif, 4° le Cabernet rouge,
5° le Cabernet S t-Jean . M. d’A rmailh acq , suivant en cela les habitudes des
vignerons de tous les vignobles, a pris pour des variétés p roprement dites
des variations sans persistance, des ceps dégénérés ou Goulards, comme il
l’indique lui-même en p arlan t du Cabernet rouge, du Cabernet S a in t-Je an ,
qui ne donne jamais ou très-peu de raisins. 11 nous semble fort in u tile de
mentionne r ces dégénérescences qui ne devraient pas plus figurer dans un
vignoble que dans un tra ité de viticulture. Le Gabernet ta rd if que nous
signale M. d ’Armailhacq n ’est cité par aucun au teu r de notre connaissance;
nous le considérons comme une amélioration du Cabernet franc d ont la
grappe devenue plus volumineuse, plus serrée, p a r suite d’u n e culture très-
soignée ou de la sélection des boutures, m û rit plus difficilement, plus tardivement
que celles dont les grains clair-semés sont mieux pénétrés p a r l ’air
et le soleil. Quant au Gabernet blanc et au Gabernet gris, les caractères qui
les différencient, d’après M. d ’Armailhacq, ont te llement peu d ’importance
que l’on doit les considérer comme des nuances variables et non persistantes
qui ne changent en rien les qualités de ce cépage.
Plusieurs auteurs se sont livrés à des disserta tions su r l’origine du Cab
e rn e t: quelques-uns croient pouvoir faire dériver le nom de Bidure do
celui de Büurica sous lequel les Romains cultivaient u n cépage importé du
pays des Bituriges vibisques qui h ab itaien t la deuxième Aquitaine. L ’origine
de ce nom, si elle é ta it aussi ancienne qu ’on l ’indique, prouverait que le
Cabernet est originaire des Graves et des coteaux de la Gironde, d’où il
s’est répandu dans toutes les contrées où il a été cultivé sous les différents
noms qu ’on lui connaît. Quelle que soit l’anc ienneté de ce cépage, il n ’en
e st pas moins u n e des vignes les plus vigoureuses, les plus rustiques que
l ’on puisse cultiver, celle qui partout où on la transporte, dans un sol convenable,
donne les vins les plus rich emen t bouquetés, les plus solides et les
plus fins. Elle doit ce bouquet prononcé à une saveur particulière de son