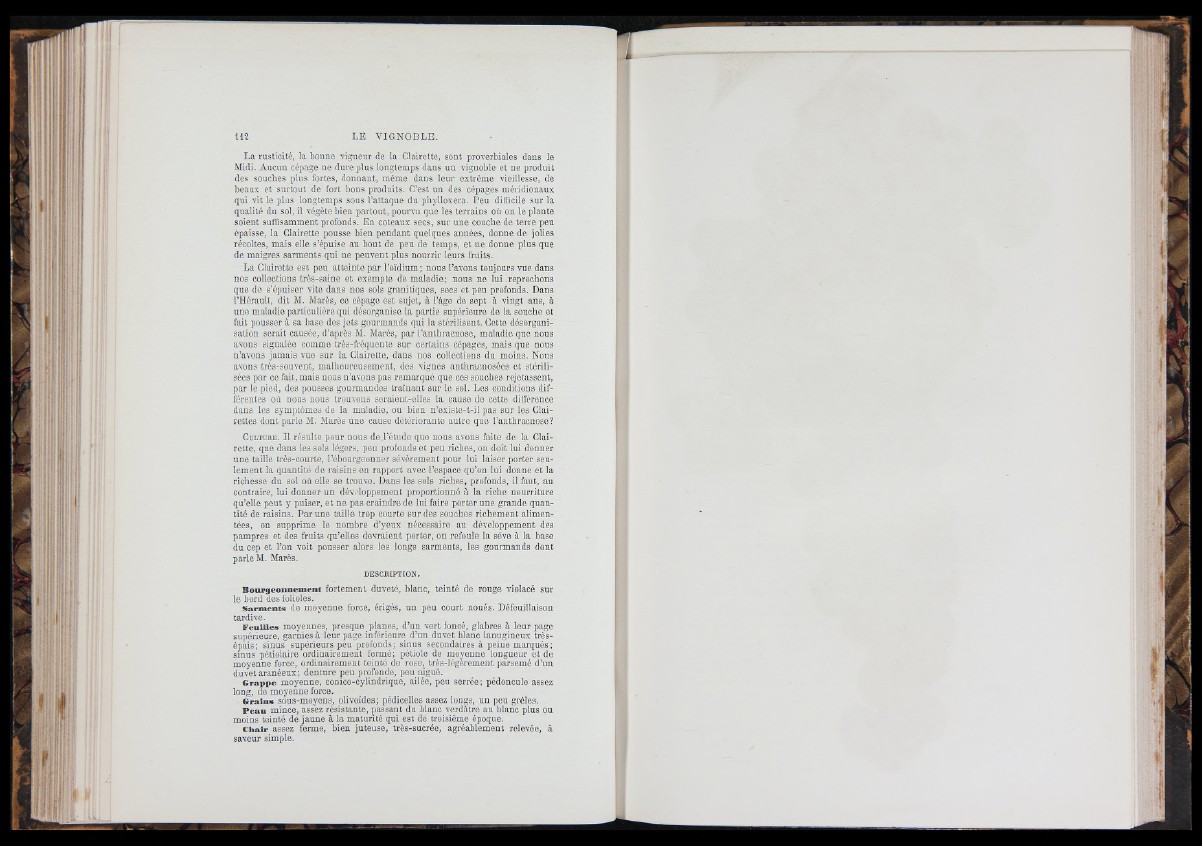
I
La rusticité, la bonne \ig a e u r de la Clairette, sont proverbiales dans le
Midi. Aucun ccpage ne dure plus longtemps dans un vignoble et ne produit
des souches plus fortes, donnant, même dans leur extrême vieillesse, de
beaux et surtout do fort bons produits. C’est un des cépages méridionaux;
qui vit le plus longtemps sous l ’attaque du phylloxéra. Peu difficile sur la
qualité du sol, il végète bien partout, pourvu que les te rrain s où on le plante
soient suffisamment profonds. En coteaux secs, sur u n e couche de te rre peu
épaisse, la Clairette pousse bien pendant quelques années, donne de jolies
récoltes, mais elle s’épuise au bout de peu de temps, et ne donne plus que
de maigres sarments qui ne peuvent plus nourrir leurs fruits.
La Clairette est peu a ttein te p a r l ’oïdium; nous l’avons toujours vue dans
nos collections trè s-saine et exempte de maladie; nous ne lui reprochons
que de s’épuiser vite dans nos sols granitiques, secs et peu profonds. Dans
l’Hérault, dit M. Marès, ce cépage est sujet, à l’âge de sept à vingt ans, à
une maladie particulière qui désorganise la partie supérieure de la souche et
fait pousser à sa base des jets gourmands qui la stérilisent. Cette désorganisation
serait causée, d ’après M. Marès, par l’anlhracnose, maladie que nous
avons signalée comme très-fréquente sur certains cépages, mais que nous
n ’avons jamais vue su r la Clairette, dans nos collections du moins. Nous
avons très-souvent, ma lheureusement, des vignes anthracnosées et stérilisées
par ce fait, mais nous n ’avons pas remarqué que ces souches rejetassent,
par le pied, des pousses gourmandes tram an t sur le sol. Les conditions différentes
où nous nous trouvons seraient-elles la cause de cette différence
dans les symptômes de la maladie, ou bien n ’ex iste-t-il pas sur les Clairettes
dont parle M. Marès u n e cause détériorante autre que l’anthracnose?
C u l t u r e . Il résulte pour nous de l ’étude que nous avons faite de la Clairette,
que dans les sols légers, peu profonds et peu riches, on doit lui donner
u n e taille très-courte, l’éhourgeonner sévèrement pour lui laiser p orte r seulement
la quantité de raisins en rapport avec l ’espace qu’on lui donne et la
richesse du soi où elle se trouve. Dans les sols riches, profonds, il faut, au
contraire, lui donner u n développement proportionné à la riche nourriture
qu’elle peut y puiser, e t ne pas craindre de lui faire porter une grande quantité
de raisins. P a r une taille trop courte sur des souches rich emen t alimentées,
on supprime le nombre d’yeux nécessaire au développement des
pampres et des fruits qu ’elles devraient porter, on refoule la séve à la base
du cep e t l’on voit pousser alors les longs sarments, les gourmands dont
parle M. Marès.
DESCRIPTION.
Bourgeonnement fortement duveté, blanc, te in té de rouge violacé sur
le bord des folioles.
Sarments de moyenne force, érigés, u n peu court noués. Défeuillaison
tardive.
FcuiUcs moyennes, presque planes, d’un vert foncé, glabres à leur page
supérieure, garnies à leur page inférieure d’un duvet blanc lanugineux très-
épais; sinus supérieurs peu profonds; sinus secondaires à peine marqués;
sinus pétiolaire ordin a iremen t fermé; pétiole de moyenne longueur e t de
moyenne force, o rdina irement te in té de rose, très-légerement parsemé d’un
duvet aranéeux; denture peu profonde, peu aiguë.
G r a p p e moyenne, conico-cylindrique, ailée, peu serree; pédoncule assez
long, de moyenne force.
Grains sous-moyens, olivoïdes; pédicelles assez longs, un peu grêles.
Peau mince, assez résistante, p assant du blanc v erdâtre au blanc plus ou
moins te in té de ja u n e à la ma turité qui est de troisième époque.
Chair assez ferme, bien ju teu se, très-sucrée, agréablement relevée, à
saveur simple.