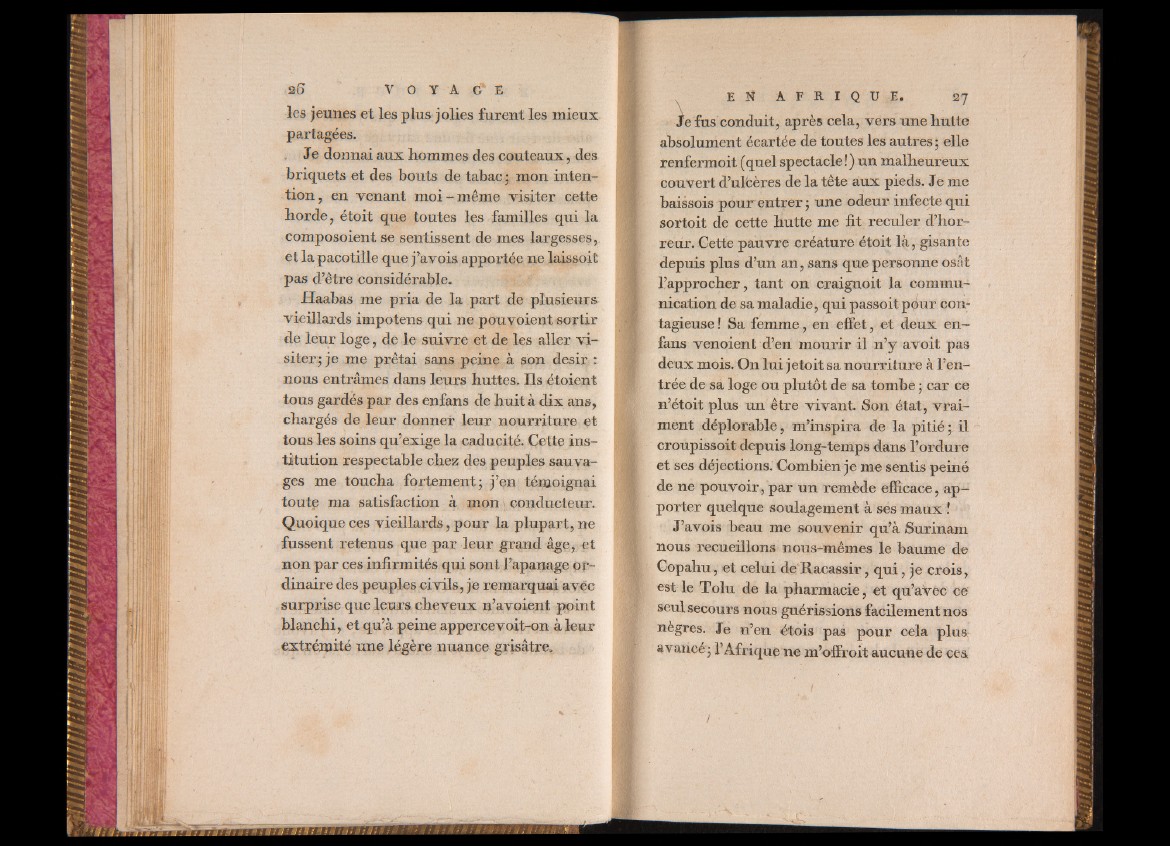
2 6 V O Y A G* E
les jeunes et les plus jolies furent les mieux
partagées.
Je donnai aux hommes des couteaux, des
briquets et des bouts de tabac ; mon intentio
n , en venant moi-même visiter cette
horde, étoit que toutes les familles qui la
eomposoient se sentissent de mes largesses,,
et la pacotille que j’avois apportée ne laissoit
pas d’être considérable.
Haabas me pria de la part de plusieurs
vieillards impotens qui ne pouvoient sortir
de leur loge, de le suivre et de les aller v isiter;
je me prêtai sans peine à son désir :
nous entrâmes dans leurs huttes. Ils étoient
tous gardés par des enfans de huit à d ix ans,
chargés de leur donner leur nourriture et
tous les soins qu’exige la caducité. Cette institution
respectable chez des peuples sauvages
me toucha fortement; j’en témoignai
toute ma satisfaction à mon \ conducteur.
Quoique ces vieillards, pour la plupart, ne
fussent retenus que par leur grand âge, et
non par ces infirmités qui sont l ’apanage ordinaire
des peuples civils, je remarquai avec
surprise que leurs cheveux n’avoient point
blanchi, et qu’à peine appercevoit-on à leur
extrémité une légère nuance grisâtre.
j/e fus conduit, après cela, vers une hutte
absolument écartée de tontes les autres; elle
renfermoit (quel spectacle!) un malheureux
couvert d’ulbères de la tête aux pieds. Je me
baissois pour entrer ; une odeur infecte qui
sortoit de cette hutte me fit reculer d’horreur.
Cette pauvre créature étoit là , gisante
depuis plus d’un an, sans que personne osât
l ’approcher, tant on craignoit la communication
de sa maladie, qui passoit pour contagieuse
! Sa femme, en effet, et deux en-
fans venoient d’en mourir il 11’y avoit pas
deux mois. On lui jetoit sa nourriture à l’entrée
de sa loge ou plutôt de sa tombe ; car ce
n’étoit plus un être vivant. Son état, vraiment
déplorable, m’inspira de la pitié;, il
croupissoit depuis long-temps dans l’ordure
et ses déjections. Combien je me sentis peiné
de ne pouvoir,par un remède efficace, apporter
quelqne soulagement à ses maux !
J’avois beau me souvenir qu’à Surinam
nous recueillons nous-mêmes le baume de
Copahu, et celui de Racassir, q u i, je crois,
est le Tolu de la pharmacie, et qu’aVec ce
seul secours nous guérissions facilement nos
nègres. Je n’en étois pas pour cela plus
avancé ; l’Afrique ne m’offroit aucune de çea