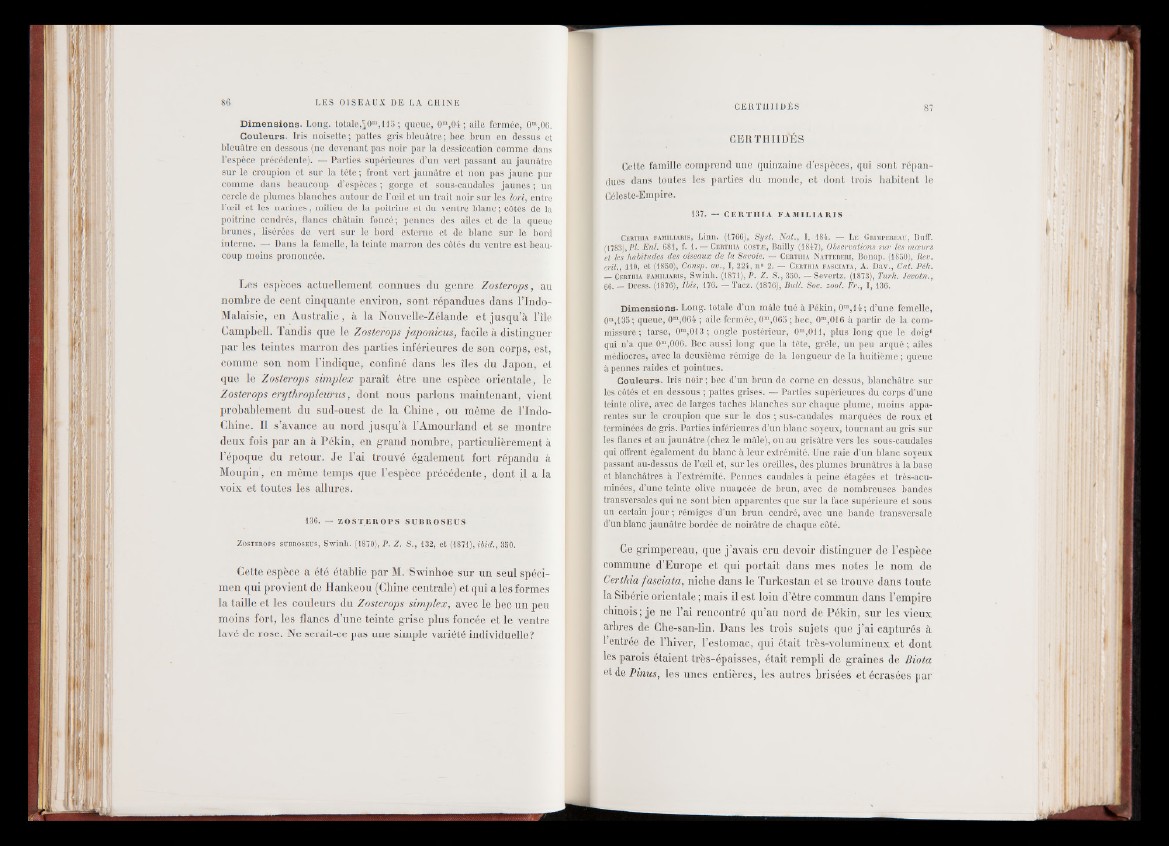
Dimensions. Long, totale,$0m,115 ; queue, 0m,04; aile fermée, 0m,06.
Couleurs. Iris noisette; pattes gris bleuâtre; bec, brun en dessus et
bleuâtre en dessous (ne devenant pas noir par la dessiccation comme dans
l’espèce précédente). — Parties supérieures d’un vert passant au jaunâtre
sur le croupion et sur la tête; front vert jaunâtre et non pas jaune pur
comme dans beaucoup d’espèces ; gorge et sous-caudales jaunes ; un
cercle de plumes blanches autour de l’oeil et un trait noir sur les lori, entre
l’oeil et les narines ; milieu de la poitrine et du ventre blanc ; côtés de la
poitrine cendrés, flancs châtain foncé; pennes des ailes et de la queue
brunes, lisérées de vert sur le bord externe et de blanc sur le bord
interne. — Dans la femelle, la teinte marron des côtés du ventre est beaucoup
moins prononcée.
Les espèces actuellement connues du genre Zosterops, au
nombre de cent cinquante environ, sont répandues dans l’Indo-
Malaisie, en Australie, à la Nouvelle-Zélande et jusqu’à l’île
Campbell. Tandis que le Zosterops japonicus, facile à distinguer
par les teintes marron des parties inférieures de son corps, est,
comme son nom l’indique, confiné dans les îles du Japon, et
que le Zosterops simplex paraît être une espèce orientale, le
Zosterops erythropleurus, dont nous parlons maintenant, vient
probablement du sud-ouest de la Chine, ou même de l’Indo-
Chine. Il s’avance au nord jusqu’à l’Amourland et se montre
deux fois par an à Pékin, en grand nombre, particulièrement à
l’époque du retour. Je l’ai trouvé également fort répandu à
Moupin, en même temps que l’espèce précédente, dont il a la
voix et toutes les allures.
136. — Z O S T E R O P S SUJB ROSEUS
Zosterops sübroseüs, Swinli. (1870), P. Z. S., 132, et (1871), ibid., 350.
Cette espèce a été établie par M. Swinhoe sur un seul spécimen
qui provient de Hankéou (Chine centrale) et qui aies formes
la taille et les couleurs du Zosterops simplex, avec le bec un peu
moins fort, les flancs d’une teinte grise plus foncée et le ventre
lavé de rose. Ne serait-ce pas une simple variété individuelle?
CERTHIID'ÉS
Cette famille comprend une quinzaine d’espèces, qui sont répandues
dans toutes les parties du monde, et dont trois habitent le
Géleste-Empire.
137. — CEKTIIIA FAMILIARIS
Certhia familiaris, Linn. (1766), Syst. Nat., I, 184. — Le Grimpereau, Buff.
(1783), PI- Enl. 681, f. 1. — Certhia costæ, Bailly (1847), Observations sur les moeurs
et les habitudes des oiseaux de la Savoie: ^ C erthia Nattereri, Bonap. (1850), Rev.
crit., 110, et (1850), Consp. av., I, 224, n° 2. — Certhia fasciata, A. Dav., Cat. Pék.
— Certhia familiaris, Swinh. (1871), P. Z. S., 350. — Severtz. (1873), Turk. Jevotn.,
66. — Dress. (1876), Ibis, 176. —Tacz. (1876), Bull. Soc. zool. Fr., 1,136.
D im e n s i o n s . Long, totale d’un mâle tué à Pékin, 0m,14'; d’une femelle,
0m,135; queue, Gm,064 ; aile fermée, 0m,065 ; bec, 0m,016 à partir de la commissure
; tarse, 0m,013 ; ongle postérieur, 0m,011, plus long que le doig*
qui n’a que 0m,006. Bec aussi long que là tête, grêle, un peu arqué ; ailes
médiocres, avec la deuxième rémige de la longueur de la huitième ; queue
à pennes raides et pointues.
C o u l e u r s . Iris noir; bec d’un brun de corne en dessus, blanchâtre sur
les côtés et en dessous ; pattes grises. •— Parties supérieures du corps d’une
teinte olive, avec de larges taches blanches sur chaque plume, moins apparentes
sur le croupion que sur le dos ; sus-caudales marquées de roux et
terminées de gris. Parties inférieures d’un blanc soyeux, tournant au gris sur
les flancs et au jaunâtre (chez le mâle), ou au grisâtre vers les sous-caudales
qui offrent également du blanc à leur extrémité. Une raie d’un blanc soyeux
passant au-dessus de l’oeil et, sur les oreilles, des plumes brunâtres à la base
et blanchâtres à l’extrémité. Pennes caudales à peine étagées et très-acu-
minées, d’une teinte olive nuancée de brun, avec de nombreuses bandes
transversales qui ne sont bien apparentes que sur la face supérieure et sous
un certain jour ; rémiges d’un brun- cendré, avec une bande transversale
d’un blanc jaunâtre bordée de noirâtre de chaque côté.
Ce grimpereau, que j’avais cru devoir distinguer de l’espèce
commune d’Europe et qui portait dans mes notes le nom de
Certhia fasciata, niche dans le Turkestan et se trouve dans toute
la Sibérie orientale ; mais il est loin d’être commun dans l’empire
chinois; je ne l’ai rencontré qu’au nord de Pékin, sur les vieux
arbres de Che-san-lin. Dans les trois sujets que j’ai capturés à
1 entrée de l’hiver, l’estomac, qui était très-volumineux et dont
les parois étaient très-épaisses, était rempli de graines de Biota
et de Pinus, les unes entières, les autres brisées et écrasées par