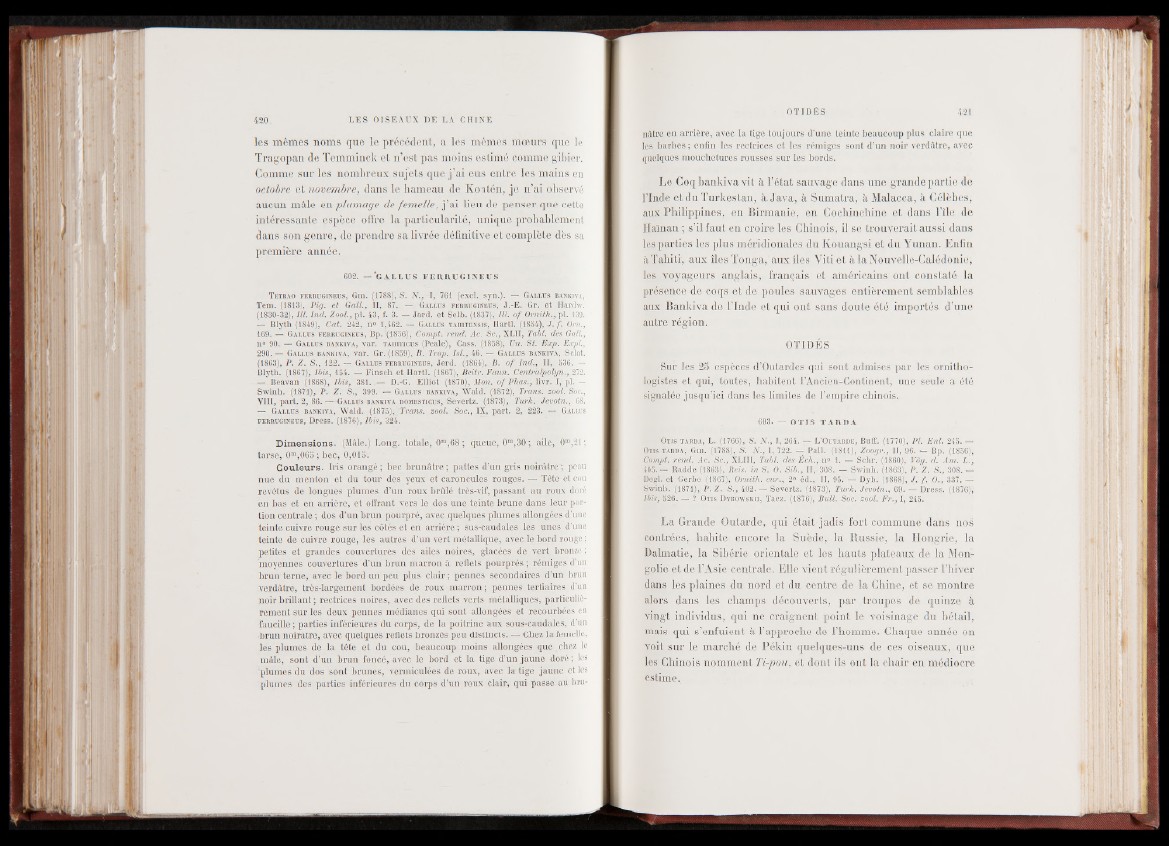
les mêmes noms que le précédent, a les mêmes moeurs que le
Tragopan de Temminck et n’est pas moins estimé comme gibier.
Comme sur les nombreux sujets que j ’ai eus entre les mains en
octobre et novembre, dans le hameau de Koatén, je n’ai observé
aucun mâle en plumage de femelle, j’ai lieu de penser que cette
intéressante espèce offre la particularité, unique probablement
dans son genre, de prendre sa livrée définitive et complète dès sa
première année.
602. - G A im S FERRUGINEUS
Tetrao ferrugineus, Gm. (17S8), S. N., I, 761 (excl. syn.). — Galles bankiva,
Tem. (1813), Pig. et Gall., II, 87. — Gallus ferrugineus, J.-E. Gr. et Hardw.
(1830-32), lit. Ind. Zool., pl. 43, f. 3. — Jard. et Selb. (1837),’ IU. of Omith., pl. 139.
— Blyth (1849), Cat. 242, n° 1,462. — Galles taiuteksis, Ilartl. (1854), J. f . Orn.,
169. — Galles ferrügikeüs, Bp. '(1856), Compt. rend. Ac. Sc., XLII, Tabl. des Gall.,
n ° 90. — Galles bankiva, v a r. taditicus (Peale), Cass. (1858), Un. St. Exp. Expi.,
290. — Gallus b arriva, var. Gr. (1859), B. Trop. Isl., 46. — Galles bankiva, Sciât.
(1863), P. Z. S., 122. — Gallus ferrugineus, Je rd . (1864), B. of Ind., II,Jÿi:36.. —
Blyth. (1867), Ibis, 154. — F in sçh et -Hartl. (1867), Beitr. Faun. Centralpolyn., 272.
Beavan (1868), Ibis, 381. — D.-G. Elliût (1870), Mon. of Phas., livr. I, pl. —
Swinh. (1871),-P. Z. S., 399. —Galles bankiva, Wald.(4.872), Trans. zooÈISoc.,
VIII, part. 2, 86.—Gallus bankiva domesticus, Severtz. (1873), Turk. Jevôtn., 68.
— Galles bankiva, Wald.-, (1875)j Trans. zool. Soc., IX, part. 2, 223. — Galles
ferrugineus, Dress. (4876), tbis, 324.
Dimensions. (Mâle.) Long, totale, 0m,68 ; queue, 0m,30 ; aile, 0m,2f;
tarse, 0m,063; bec, 0,01 Sv
Couleurs. Ms orangé ; bec brunâtre ; pattes d’un gris noirâtre"; peau
nue du menton et du tour des yeux et caroncules rouges. — Tête et cou
revêtus de longues plumes d’un roux brûlé très-vif, passant au roux doré
en bas et en arrière, et offrant vers le dos une teinte brune dans leur portion
centrale ; dos d’un brun pourpré, avec quelques plumes allongées d’une
teinte cuivre rouge sur les côtés et en arrière ; sus-caudales les unes d’une
teinte de cuivre rouge, les autres d’un vert métallique, avec,le bord rouge;
petites et grandes couvertures des ailes .noires, glacées de.vert bronze;
moyennes couvertures d’un brun marron à reflets pourprés ; rémiges d’un
brun terne, avec le bord un peu plus clair ; pennes secondaires d’un brun
.verdâtre, très-largement bordées de roux marron ; pennes tertiaires d’un
noir brillant ; rectrices noires, avec des reflets verts métalliques, particulièrement
sur les deux pennes .médianes qui sont allongées et recourbées en
faucille ; parties inférieures du corps, de la poitrine "aux sous-caudales, d’un
■brun noirâtre, avec quelques reflets bronzés peu distincts. — Chez la femelle,
les plumes de la tête et du cou, beaucoup moins allongées que chez le
mâle, sont d’un brun foncé, avec le bord et la tige d’un jaune doré ; les
plumes du dos sont brunes, vermiculées de roux, avec la lige jaune et les
plumes des parties inférieures du corps d’un roux clair, qui passe au brunâtre
en arrière, avec la tige toujours d’une teinte beaucoup plus claire que
les barbes ; enfin les.rectrices et les rémiges sont d’un noir verdâtre, avec
quelques mouchetures rousses sur les bords.
Le Coq bankiva vit à l’état sauvage dans une grande partie de
l’Inde et du Turkestan, à, Java, à Sumatra, à Malacca, à Célèbes,
aux Philippines, en Birmanie, en Cochinchine et dans l’île de
Ilaïnan ; s’il faut en croire les Chinois, il se trouverait aussi dans
les parties les plus méridionales du Kouangsi et du Yunan. Enfin
à Tahiti, aux îles Tonga, aux îles Viti et à la Nouvelle-Calédonie,
les voyageurs anglais, français et américains ont constaté la
présence de coqs et de poules sauvages entièrement semblables
aux Bankiva de l’Inde et qui ont sans doute été importés d’une
autre région.
OTIDÉS
Sur lès 25 espèces d’Outardes qui Sbnt admises par les ornithologistes
et qui, toutes, habitent FAncien-Continent, une seule a été
signalée jusqu'ici dans les limites de l’empire chinois.
603. — OTIS TARDA
Oms tarda, L. (1766), S. N . , I, 264. — L’Outarde, Buff. (1770), PI. U n i. 245. —
Ons TARDA,. G in. (1788), S.- N ., I, 722. — Pall. (1811), Z o o g r ., II, 96. — Bp. (1856))
C om p t.',re n d . A c . S c ., X L III, T a b l. d e s É c h ., n° 1. — Schr. (1860), V o g . d . A m . L .,
405. — Radcle (1863), R c is. in S . O. S ib ., II, 308. — Swinh. (18:63), P. Z . S . , 308. —
Deglî et Gerbe (IS67), O m i t h . cto-., 2“ éd., II, 95. — Dyb. (1868)',/. f . O ., 337. - S
Swinh. (IS71), P. Z . S ., 402. — Severtz. ’(1873), T u r k . J e v o tn ., 69. — Dress. (1876);
Ibis, 526. — ? Otis Dybowskii, Tacs. (1876), Bull. S o c . z ô o l. F r ., I, 245.
La Grande Outarde, qui était jadis fort commune dans nos
contrées, habite encore la Suède, la Russie, la Hongrie, la
Dalmatie, la Sibérie orientale et les hauts plateaux de la Mongolie
et de l’Asie centrale. Elle vient régulièrement passer l’hiver
dans les plaines du nord et du centre de la Chine, et se montre
alors dans les champs découverts, par troupes de quinze à
vingt individus, qui ne craignent point le voisinage du bétail,
mais qui s’enfuient à l’approche de l’homme. Chaque année on
voit sur le marché de Pékin quelques-uns de ces oiseaux, que
les Chinois nomment Ti-pou, et dont ils ont la chair en médiocre
estime.