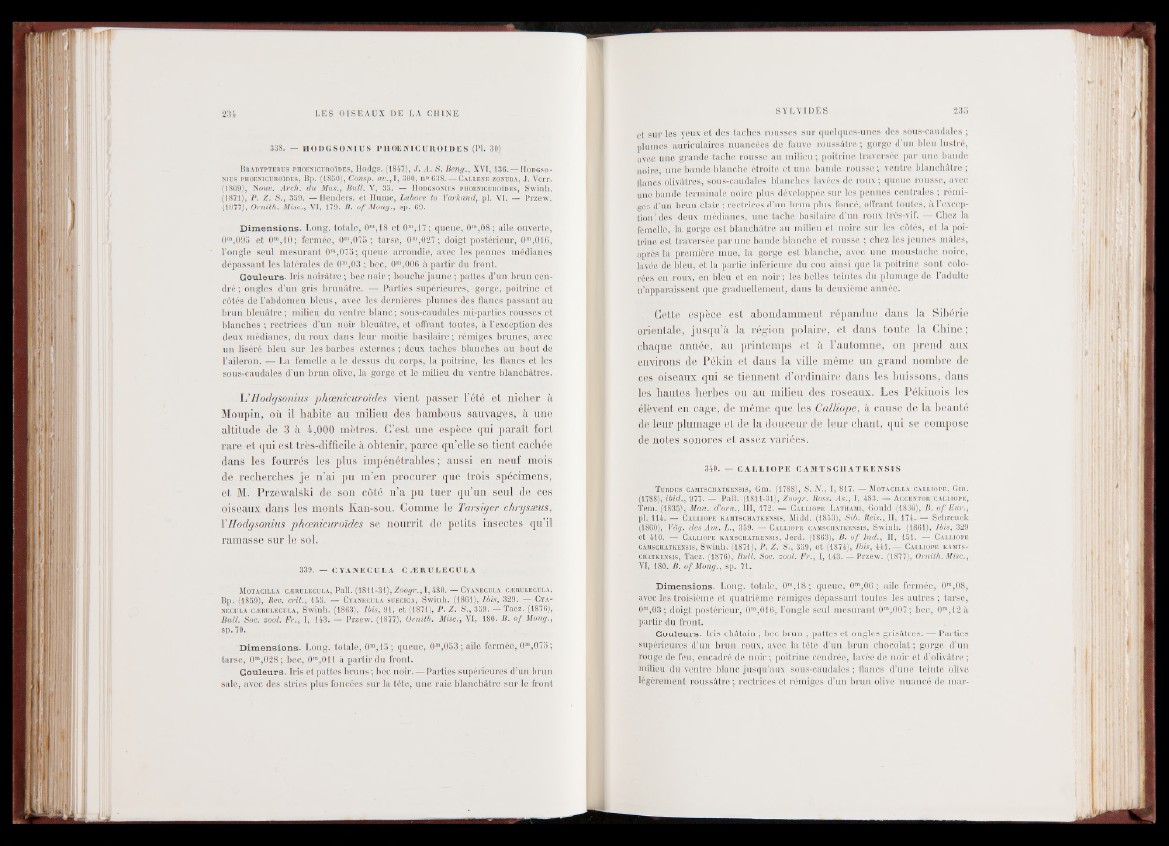
338. — IIODGSOMUS THOENICUROIDES (PL 30)
Bradypterus phoenicuroïdes, Hodgs. (1847), J. A. S. Beng., XVI, 136. —Hodgsonius
phoenicuroïdes, Bp. (1860), Consp. av.,I, 300, n° 638. —Callene zonura, J. Verr.
(1869), Nowu. Arch. du Mus., Bull. V, 35. — Hodgsonius phoenicuroïdes, Swinh.
(1871), P. Z. S., 359. —Henders. et Hume, Lahore to Yarkand, pi. VI. — Przew.
(1877), Omith. Mise., VI, 179. B. of Mong., sp. 69.
Dimensions. Long, totale, 0m,18 et 0m,17; queue, 0m,08 ; aile ouverte,
0m,095 et 0“ ,10; fermée, 0m,075 ; tarse, 0m,027; doigt postérieur, 0m,016,
l’ongle seul mesurant 0m,075 ; queue arrondie, avec les pennes médianes
dépassant les latérales de 0m,03 ; bec, 0m,006 à partir du front.
Couleurs. Iris noirâtre ; bec noir ; bouche jaune ; pattes d’un brun cendré
; ongles d’un gris brunâtre. 9 Parties supérieures, - gorge, poitrine et
côtés de l’abdomen bleus, avec les dernières plumes des flancs passant au
brun bleuâtre ; milieu du ventre blanc; sous-caudalës mi-parties rousses et
blanches ; rectrices d’un noir bleuâtre, et offrant toutes, à l’exception des
deux médianes, du roux dans leur moitié basilaire ; rémiges brunes, avec
un liséré bleu sur les barbes externes ; deux taches blanches au bout de
l’aileron. La femelle a le dessus du corps, la poitrine, les flancs et les
sous-caudales d’un brun olive, la gorge et le milieu du ventre blanchâtres.
L’Hodgsonius phoenicuroïdes vient passer l’été et nicher à
Moupin, où il habite au milieu des bambous sauvages, à une
altitude de 3 à 4,000 mètres. C’est une espèce qui paraît fort
rare et qui est très-difficile à obtenir, parce qu’elle se tient cachée
dans les fourrés les plus impénétrables ; aussi en neuf mois
de recherches je n’ai pu m’en procurer que trois spécimens,
et M. Przewalski de son côté n’a pu tuer qu’un seul de ces
oiseaux dans les monts Kan-sou. Comme le Tarsiger chnjsæus,
l’Hodgsonius phoenicuroïdes se nourrit de petits insectes qu’il
ramasse sur le sol.
339. — CYASECDLA CÆRULECULA
Motacilla cærulecula, Pâli. (1811-31), Zoogr., I, 480. — Cyanecula cærulecula,
Bp. (1859), Rev. crit., 155. — Cyanecula suecica, Swinh. (1861), Ibis, 329. — Cya-
necui.a cærulecula, Swinh. (1863), Ibis, 91, et j|871), P. Z. S., 359. —Tacz. (1876),
Bull. Soc. zool. Fr., I, 143. — Przew. (1877), Omith. Mise:, VI, 180. B. of Mortg.,
sp.70.
Dimensions. Long, totale, 0m,I5; queue, 0“ ,053 ; aile fermée, 0m,675 ;
tarse, 6m,628; bec, 0m,011 à partir du front.
Couleurs. Iris et pattes bruns ; bec noir.—Parties supérieures d!un brun
sale, avec des stries plus foncées sur la tête, une raie blanchâtre sur le front
et sur les yeux et des taches rousses sur quelques-unes des sous-caudales ;
plumes auriculaires nuancées de fauve roussâtre ; gorge d’un bleu lustré,
avec une grande tache rousse au milieu ; poitrine traversée par une bande
noire, une bande blanche étroite et une bande rousse ; ventre blanchâtre ;
flancs olivâtres, sous-caudales blanches lavées, de roux ; queue rousse, avec
une bande terminale noire plus développée sur les pennes centrales ; rémiges
d’un brun clair ; rectrices d’un brun plus foncé, offrant toutes, à l’exception)
des deux médianes, une tache basilaire d’un roux très-vif. — Chez la
femelle, la gorge est blanchâtre au milieu et noire sur les côtés, et la poitrine
est traversée par une bande blanche et rousse ; chez les jeunes mâles,
après la première mue, la gorge est blanche, avec une moustache noire,
lavée de bleu, et la partie inférieure du cou ainsi que la poitrine sont colorées
en roux, en bleu et en noir ; les belles teintes du plumage de l’adulte
n’apparaissent que graduellement, dans la deuxième année. .
Cette espèce est abondamment répandue dans la Sibérie
orientale, jusqu’à la région polaire, et dans toute la Chine;
chaque année, au printemps et à l’automne, on prend aux
environs de Pékin et dans la ville m,ême un grand nombre de
ces oiseaux qui se tiennent d’ordinaire dans les buissons, dans
les hautes herbes ou au milieu des roseaux. Les Pékinois les
élèvent en cage, de même que les .Calliope, à cause de la beauté
de leur plumage et de la douceur de leur chant, qui se compose
de notes sonores et assez variées.
340. — C A L L IO P E C A M T S C H A T K E N S IS
Turdus camtschatkensis, Gm. (1788), S. N., I, 817. S M otacilla calliope, Gm.
Hf788), ibid., 977. — Pâli. (1811-31), Zoogr. Ross: As., I, 483, — Accentok'CAlliope,
Tem.-(18'35), Man. d'orn., III, 172. — Calliope Lathami, Gould (1836), B. of E u r . ,
pi. 114. 4- Calliope kamtschatkensis, Midd. (1853), Sib. Reis., II, 174„— Sch ren ck
(1860), VSg. des Am. L . , 359. — Calliope- camscuatkensis, Swinh. (1861), Ibis, 329
et 410. — Calliope kamschatkensis, Jerd. (1863), B. of Ind., II, 151. — Calliope
càmschatkensis, Sw in h . (1871 ), P. Z. S., 359, e t (1874), Ibis, 441. — Calliope kamtschatkensis,
Tacz. (1876), Bull. Spc. zool. Fr., I, 143. — Przew. (1877), Omith. Mise.,
VI, 180. B. of Mong., sp. 71.
Dimensions. Long, totsde, 0m,18; queue, 0m,06 ; aile fermée, 0m,08,
avec les troisième et quatrième rémiges dépassant toutes les autres ; tarse,
Om,03 ; doigt postérieur, 0m,016Mjongle seul mesurant 0m,007 ; bec, O“ , ^ à
partir du front.
Couleurs. Iris châtain ; bec brun ; pattes et ongles grisâtres. — Parties
supérieures d’un brun roux, avec la tête d’un brun chocolat; gorge d’un
rouge de feu, encadré de noir ; poitrine cendrée, iavée de noir et d’olivâtre ;
milieu du ventre blanc jusqu’aux sous-câudales ; flancs d’uné teinte olive
légèrement roussâtre ; rectrices et rémiges d’un brun olive nuancé de mar