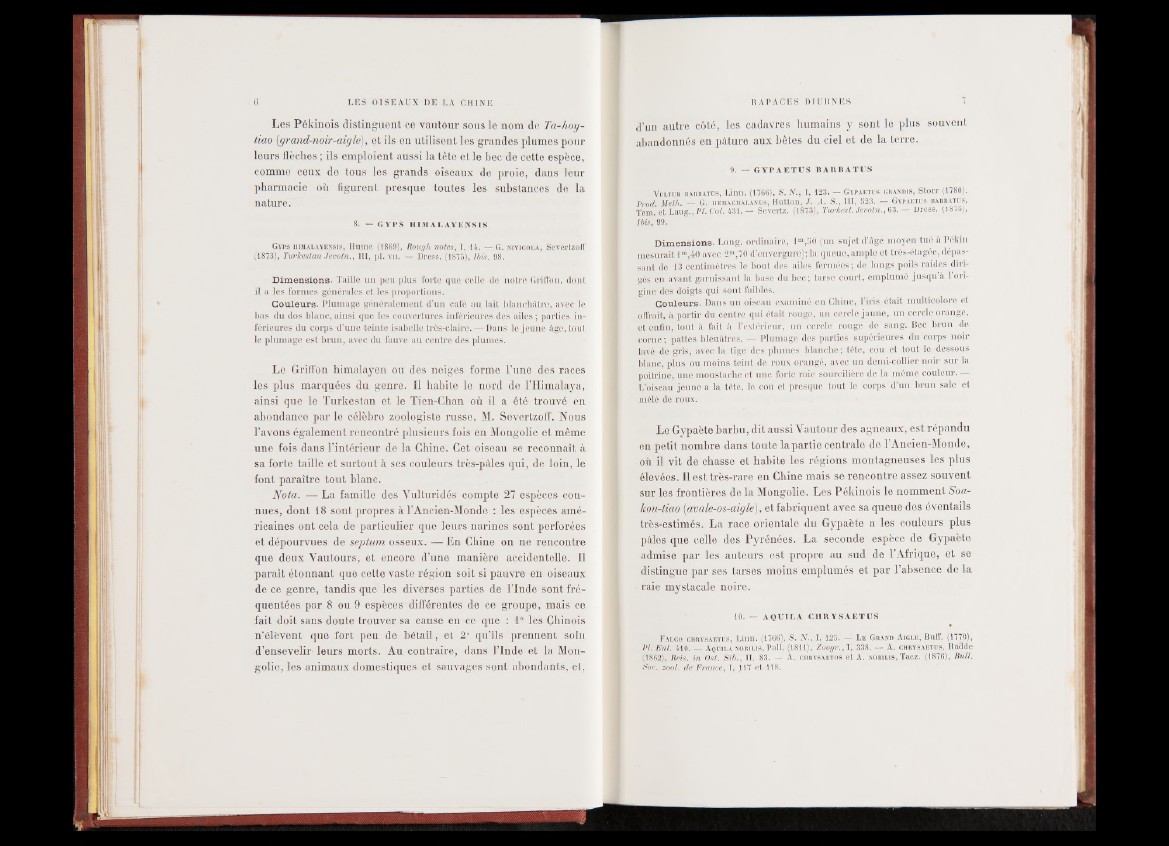
Les Pékinois distinguent ce vautour sous le nom de Ta-hoy-
tiao (grand-noir-aigle), et ils en utilisent les grandes plumes pour
leurs flèches ; ils emploient aussi la tête et le bec de cette espèce,
comme ceux de tous les grands oiseaux de proie, dans leur
pharmacie où figurent presque toutes les substances de la
nature.
8. GYPS IIIMALAYEIXSIS
Gtps himalayensis, Hume (1869), Roug/i notes, I, 14. —7G. nivicola, Severtzoff
(1873), Turlcestan Jevotn., III, pi. vu. — Dress. (1875), Ibis, 98.
Dimensions. Taille un peu plus forte que celle de notre Griffon, dont
il a les formes générales et les proportions.
Couleurs. Plumage généralement d’un café, au lait blanchâtre, avec le
bas du dos blanc, ainsi que les couvertures inférieures des ailes ; parties inférieures
du corps d’une teinte isabelle très-claire. — Dans le jeune âge, tout
le plumage est brun, avec du fauve au centre des plumes. -
Le Griffon himalayen ou des neiges forme l’une des races
les plus marquées du genre. Il habite le nord de l’Himalaya,
ainsi que le Turkestan et le Tien-Chan où il a été trouvé en
abondance par le célèbre zoologiste russe, M. Severtzoff. Nous
l’avons également rencontré plusieurs fois en Mongolie et même
une fois dans l’intérieur de la Chine. Cet oiseau se reconnaît à
sa forte taille et surtout à, ses couleurs très-pâles qui, de loin, le
font paraître tout blanc.
Nota. — La famille des Vulturidés compte 27 espèces connues,
dont 18 sont propres à l’Ancien-Monde : les espèces américaines
ont cela de particulier que leurs narines sont perforées
et dépourvues de septum osseux. — En Chine on ne rencontre
que deux Vautours, et encore d’une manière accidentelle. Il
paraît étonnant que celte vaste région soit si pauvre en oiseaux
de ce genre, tandis que les diverses parties de l’Inde sont fréquentées
par 8 ou 9 espèces différentes de ce groupe, mais ce
fait doit sans doute trouver sa cause en ce que : 1“ les Çhinois
n’élèvent que fort peu de bétail, et 2° qu’ils prennent soin
d’ensevelir- leurs morts. Au contraire, dans l’Inde et la Mongolie,
les animaux domestiques et sauvages sont abondants, et,
d’un autre côté, les cadavres humains y sont le plus souvent
abandonnés en pâture aux bêtes du ciel et de la terre.
9. — GYPAETUS BARBATUS
VuLTim barbatüs, Linn. (1766), S. N., I, 123. — Gypaetus grandis, Storr (1780),
Prod. Meth. — G. iiemachAlanüs, Hutton, J: A. S., III, 523. | | | Gypaetus barbatüs,
Tem. et Laug., PL Col. 431. — Severtz, (1873J, Turkest. Jevotn., 63. — Dress. (1875),
Ibis, 99.
Dimensions. Long, ordinaire, lm,50 (un sujet d’âge moyen tué à Pékin
mesurait lm,40 avec 2“ ,70 d’envergure); la queue, ample et très-étagée, dépassant
de 13 centimètres le bout des ailes fermées; de longs poils raides dirigés
en avant garnissant la base du bec; tarse court, emplumé jusqu’à l’origine
des doigts qui sont faibles.
Couleurs. Dans un oiseau examiné en Chine, l’iris était multicolore et
offrait, à partir du centre qui était rouge, un cercle jaune, un cercle orange,
et enfin, tout à fait à l’extérieur, un cercle rouge de sang. Bec brun de
corne ; pattes bleuâtres. — Plumage des parties supérieures du corps noir
lavé de gris, avec la tige des plumes blanche; tête, cou et tout le dessous
blanc, plus ou moins teint de roux orangé, avec un demi-collier noir sur la
poitrine, une moustache et une forte raie sourcilière de la même couleur. -|B|
L’oiseau jeune a la tête, le cou et presque tout le corps d’un brun sale et
mêlé de roux.
Le Gypaète barbu, dit aussi Vautour des agneaux, est répandu
en petit nombre dans toute la partie centrale de l’Ancien-Monde,
■ où il vit de chasse et habite les régions montagneuses les plus
élevées. Il est très-rare en Chine mais se rencontre assez souvent
sur les frontières de la Mongolie. Les Pékinois le nomment Soa-
kou-tiao (avale-os-aigle), et fabriquent avec sa queue des éventails
très-estimés. La race orientale du Gypaète a les couleurs plus
pâles que celle des Pyrénées. La seconde espèce de Gypaète
admise par les auteurs est propre au sud de l’Afrique, et se
distingue par ses tarses moins emplumés et par l’absence de la
raie myslacale noire.
10. — AQUILA CIIRYSAETÜS
F alco chrysaetüs, Linn. (1766), S. N., I, 125. — Le Grand Aigle, Buff. (1770),
Pl. Enl. 410. — Aquila nobilis, Pall. (1811), Zoogr., I, 338. — A. chrysaetüs, RaÛde
'(1862), Reis. in Ost. Sib., II, 83. — A. chrysaetos e t A. nobilis, Tacz. (1876), Bull.
Soc. zool. de France, I, 117 e t 118.