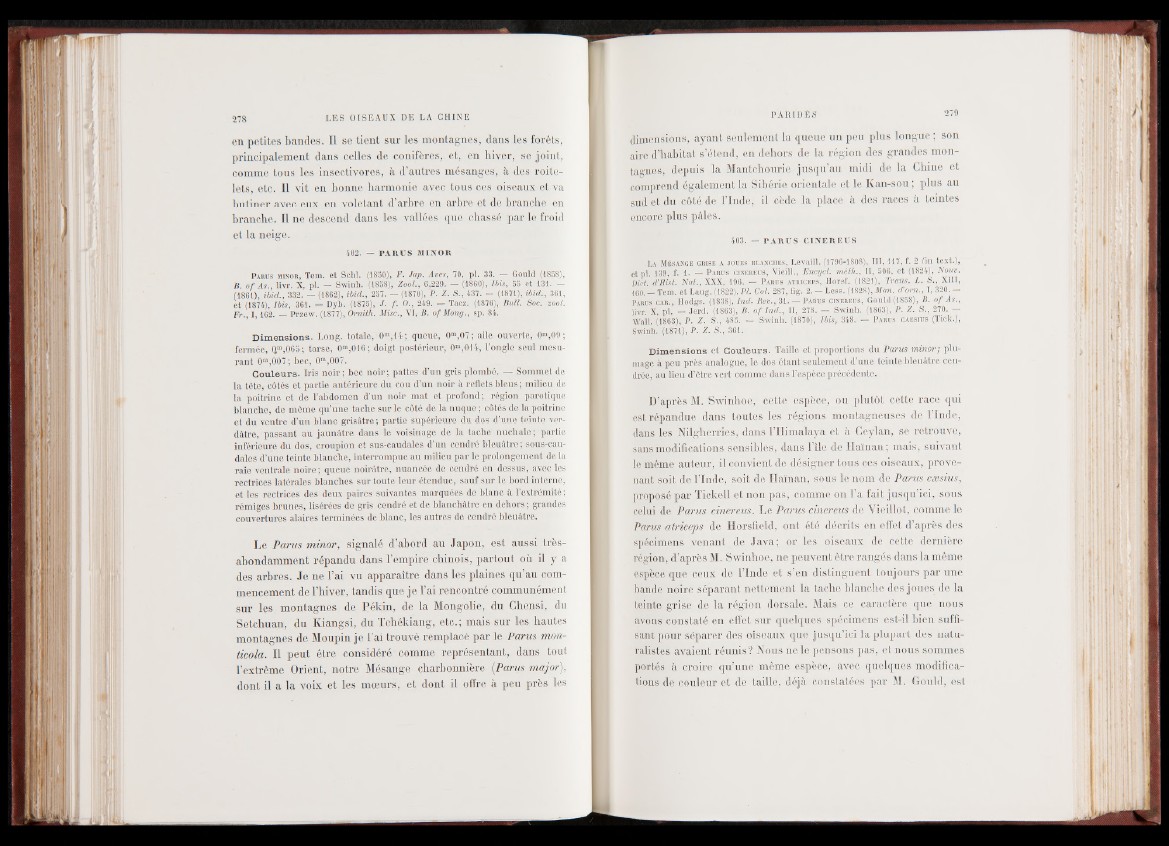
en petites bandes. Il se tient sur les montagnes, dans les forêts,
principalement dans celles de conifères, et, en hiver, se joint,
comme tous les insectivores, à d’autres mésanges, à des roitelets,
etc. Il vit en bonne harmonie avec tous ces oiseaux et va
butiner avec eux en voletant d’arbre en arbre et de branche en
branche. Il ne descend dans les vallées que chassé par le froid
et la neige.
402. — PARUS MINOR
Parus minor, Tem. et Schl. (1850), F. Jap. Aves, 70, p l. 33. — Gould (1858),
B of As. livr. X, pl. — Swinh. (1858), Zool., 6,229. — (1860), Ibis, 55 et 131. —
(1861), ibid., 332. — (1862), ibid., 257. Ig (1870), P. Z. S., 437. — (1871), ibid., 361,
et (1874), Ibis, 361. — Dyb. (1875), J. f. O., 249. — Tacz. (1876), Bull. Soc. zool.
Fr., 1,162. B Przew. (1877), Ornith. Mise., VI, B. ofMong., sp. 84.
Dimensions. Long, totale,'0m,14; queue, 0m,07; aile ouverte, 0m,09 ;
fermée, Qm,06S; tarse, 0m,016; doigt postérieur, 0m,014, l’ongle seul mesurant
0m,007 ; bec, 0m,007.
Couleurs. Iris noir ; bec noir; pattes d’un gris plombé. — Sommet de
la tête, côtés et partie antérieure du cou d’un noir à reflets bleus ; milieu de
la poitrine et de l’abdomen d’un noir mat et profond; région parotique
blanche, de même qu’une tache sur le côté de la nuque ; côtés de la poitrine
et du ventre d’un blanc grisâtre ; partie supérieure du dos d’une teinte verdâtre,
passant au jaunâtre dans le voisinage de la tache- nuchale; partie
inférieure du dos, croupion et sus-caudales d’un cendré bleuâtre ('sous-caudales
d’une teinte blanche, interrompue au milieu par le prolongement de la
raie ventrale noire ; queue noirâtre, nuancée de cendré en dessus, avec les
rectrices latérales blanches sur toute leur étendue, sauf sur le bord interne,
et les rectrices des deux paires suivantes marquées de blane-à l’extrémité;
rémiges brunes, lisérées de gris cendré et de blanchâtre en dehors; grandes
couvertures alaires terminées de blanc, les autres de cendré bleuâtre.
Le Parus minor, signalé d’abord au Japon, est aussi très-
abondamment répandu dans l’empire chinois, partout où il y a
des arbres. Je ne l’ai vu apparaître dans les plaines qu’au commencement
de l’hiver, tandis que je l’ai rencontré communément
sur les montagnes de Pékin, de la Mongolie, du Chensi, du
Setchuan, du Kiangsi, du Tchékiang, etc.;, mais sur les hautes
montagnes de Moupin je l’ai trouvé remplacé par le Parus mon-
ticola. Il peut être considéré" comme représentant, dans tout
l’extrême Orient, notre Mésange charbonnière (Parus major),
dont il a la voix et les moeurs, et dont il offre à peu près les
dimensions, ayant seulement la queue un peu plus longue; son
aire d’habitat s’étend, en dehors de la région des grandes montagnes,
depuis la Mantchourie jusqu’au midi de la Chine et
comprend également la Sibérie orientale et le Kan-sou ; plus au
sud et du côté de l’Inde, il cède la place à des races à teintes
encore plus pâles.
403. — PARUS CINEREUS
La Mésange grise a joues blancues, Levaill. (1796-1808), III, 117, f. 2 lin text.),
etpl. 139, f- 1- — P arus cinereus, Vieill., Encycl. mèth., Il, 506, et (1824), Nouv.
Dict. d’Hist. Nat., XXX, 196. — Parus atriceps, Hors{:,:(182li,-f Trans. L. S., XIII,
160. — Tem. et Lang. (1822), Pl. toi. 287, fig. 2. — Less. (1828), Man. cl’orn., I, 320. —
Parus car., Hodgs. (1838), Ind. Rev., 31. — Parus cinereus, Gould (1858), B. of As.,
livr. X, pl. Bjerd. (1863), B. mind., II, 278. — Swinh. (1$*$, P. Z, S., 270. —
Wall. (1863), P. Z. S.,' 485. — Swinh. (-1S70), Ibis, 348. — Parus caesius (Tick.),
Swinh. (1871), P. Z. S., 361.
Dimensions et Couleurs. Taille et proportions du Parus minor; plumage
à peu près analogue, le dos étant seulement d’une teinte bleuâtre cendrée,
au lieu d’être vert- comme dans l’espèce précédente.
D’après M. Swinhoe, cette espèce, ou plutôt cette race qui
est répandue dans toutes les régions montagneuses de l’Inde,
dans les Nilgherries, dans mimalaya et à Ceylan, se retrouve,
sans modifications sensibles, dans l’île de Ilaïnan; mais, suivant
le même auteur, il convient de désigner tous ces oiseaux, provenant
soit de l’Inde, soit de Haïnan, sous le nom de Parus cæsius,
proposé par Tickell et non pas, comme on l’a fait jusqu’ici, sous
celui de Parus cinereus. Le Parus cinereus de Yieillot, comme le
Parus atriceps de Ilorsfield, ont été décrits en effet d’après des
spécimens, venant de Java; or les oiseaux de cette dernière
région, d’après M. Swinhoe, ne peuvent être rangés dans la même
espèce que ceux de l’Inde et s’en distinguent toujours par une
bande noire séparant nettement la tache blanche des joues de la
teinte grise de la région dorsale. Mais ce caractère que nous
avons constaté en effet sur quelques spécimens est-il bien suffisant
pour séparer des oiseaux que jusqu’ici la plupart des naturalistes
avaient réunis? Nous ne le pensons pas, et nous sommes
portés à croire qu’une même espèce, avec quelques modifications
de -couleur et de taille, déjà constatées par M. Gould, est