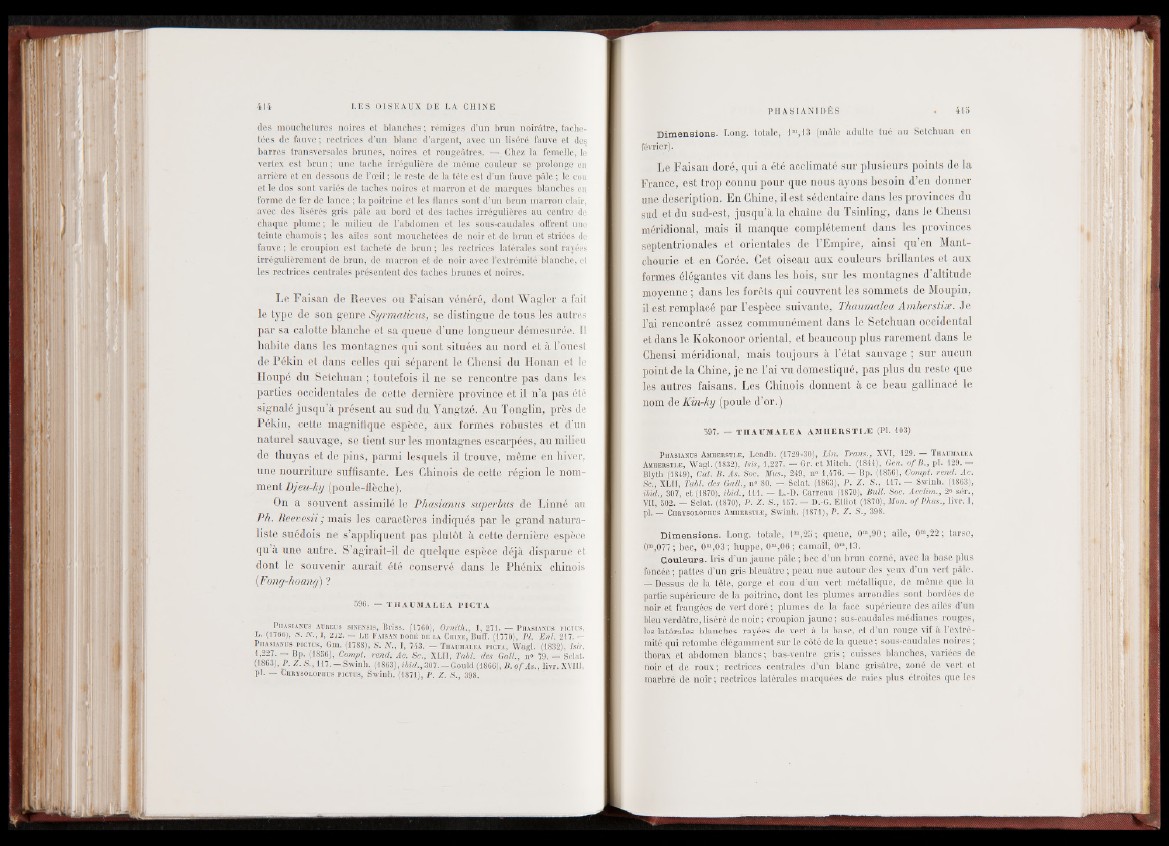
des mouchetures noires et blanches ; rémiges d’un brun noirâtre, tachetées
de fauve ; rectriees d’un blanc d’argent, avec un liséré fauve et de§
barres transversales brunes, noires et rougeâtres. —_ Chez la femelle, le
vertex est brun ; une tache irrégulière de même couleur se prolonge en
arrière et en dessous de l’oeil ; le reste de la tête est d’un fauve pâle ; le cou
et le dos sont variés de taches noires et marron et de marques blanches en
forme de fer de lance ; la poitrine et les flancs sont d’un brun marron clair,
avec des lisérés gris pâle au bord et des taches irrégulières au centre de
chaque plume ; le milieu de l’abdomen et les sous-caudales offrent une
teinte chamois ; les ailes sont mouchetées de noir et de brun et striées de
fauve ; le croupion est tacheté de brun ; les rectriees latérales sont rayées
irrégulièrement de brun, de marron et de noir avec l’extrémité blanche, et
les rectriees centrales présentent des taches brunes et noires.
Le Faisan de Reeves ou Faisan vénéré, dontWagler a fait
le type de son genre Syrmaticiis, se distingue de tous les autres
par sa calotte blanche et sa queue d’une longueur démesurée. Il
habite dans les montagnes qui sont situées au nord et à l’ouest
de Pékin et dans celles qui séparent le Chensi du Honan et le
Houpé du Setchuan ; toutefois il ne se rencontre pas dans les
parties occidentales de cette dernière province et il n’a pas été
signalé jusqu’à présent au sud du Yangtzé. Au Tonglin, près de
Pékin, cette magnifique espèce, aux formes robustes et d’un
naturel sauvage, se tient sur les montagnes escarpées, au milieu
de thuyas et de pins, parmi lesquels il trouve, même en hiver,
une nourriture suffisante. Les Chinois de cette région le nomment
Djeu-ky (poule-flèche).
On a souvent assimilé le Phasiamis superbus de Linné au
Ph. Reevesii; mais les caractères indiqués par le grand naturaliste
suédois ne s’appliquent pas plutôt à cette dernière espèce
qu’à une autre. S’agirait-il de quelque espèce déjà disparue; et
dont le souvenir aurait été conservé dans le Phénix chinois
(.Fong-hoang) ?
596. — IHACMAlliA l'ICTA
Phasianus aureus sinensis, Brissai760|(’OTO!%., I, 271. - Piusiancs rictus,
L. (1766), S. N ., I, 272. — Le Eaisan doris de la Chine, Buff. (1770), Pl. Ent. 217. - f
Phasianus rictus, Gm. (1788), S. IV., I, 743. — Thaumalea picta, Wagls (1832), Isis,
1,227. — Bp. (1856), Compt. rend.-. AmSc., XLII, Tail., des Gall., n» 79. —Sclat.
(1863), P. Z.S., 117. — Swinh. (1863), ibid., 307. —Gould (1866), B. of As., livr. XVIII,
pi. — Chrysolophus pictcs, Swinh. (1871), P. Z. S., 398.
Dimensions. Long, totale, dm,13 (male adulte tué au Setchuan en
février)'.
Le Faisan doré, qui a été acclimaté sur plusieurs points de la
France, est trop connu pour que nous ayons besoin d’en donner
une description. En Chine, il est sédentaire dans les provinces du
sud et du sud-est, jusqu’à la chaîne du Tsinling, dans le Chensi
méridional, mais il manque complètement dans les provinces
septentrionales et orientales de l’Empire, ainsi qu’en Mant-
chourie et en Corée. Cet oiseau aux couleurs brillantes et aux
formes élégantes vit dans les bois, sur les montagnes d altitude
moyenne ; dans les forêts qui couvrent les sommets de Moupin,
il est remplacé par l’espèce suivante, Thaumalea Amherstiæ. Je
l’ai rencontré assez communément dans le Setchuan occidental
et dans le Kokonoor oriental, et beaucoup plus rarement dans le
Chensi méridional, mais toujours à l’état sauvage ; sur aucun
point de la Chine, je ne l’ai vu domestiqué, pas plus du reste que
les autres faisans. Les Chinois donnent à ce beau gallinacé le
nom de Kin-ky (poule d’or.)
397. — THAUMALEA AMHERSTIÆ (Pl. 103)
Phàsianus Amherstiæ, Lcadb. (1729-30), Lin. Transi, XVI, 129. — Thaumalea
Amherstiæ, Wagl. (1832))'Isis, 1,227. — Gr. et Mitch. (1844)), Gen. ofB., pl. 129. —
Blyth (1849), Cat. B. As. Soc. Mus., 249, n» 1,476. — Bp. (1856), Compt. rend. Ac.
Sc., XLII, Tabl. des Gall., n» 80. —. Sciât, (1863), P. Z. S., 117. — Swinh. (1863),
ibid., 307, et (1870),.ibid., 111. — L.-D. Carreau (1870), Bull. Soc. Acclim., 2® sér.,
VII, 502. — Selat. (1870), P. Z. S., 157.B D.-G. Elliot (1870), Mon. ofPhas., livr. I,
P Ü S C hrysolophüs Amherstiæ, Swinh. (1871), P. Z. S., 398.
Dimensions. Long, totale, 1m,25 ; queue, 0m,90; aile, 0m,22 ; tarse,
0m,077 ; bec, 0m,,03-, huppe, O31,06 ; c.amail, 0m,13.
Couleurs. Iris d’un jaune pâle ; bec d’un brun corné, avec la base plus
foncée ; pattes d’un gris bleuâtre ; peau nue autour des yeux d’un vert pâle.
— Dessus de la tête, gorge et cou d’un vert métallique, de même que la
partie supérieure de la poitrine, dont les plumes arrondies sont bordées de
noir et frangées de vert doré ; plumes de la face supérieure des ailes d’un
bleu verdâtre, liséré de noir; croupion jaune ; sùs-caudales médianes rouges,
les latérales blanches rayées de vert à la base, et d’un rouge vif à l’extrémité
qui retombe élégamment sur le côté de la queue ; sous-caudales noires ;
thorax et abdomen blancs ; bas-ventre gris ; cuisses blanches, variées de
noir et de roux; rectriees centrales d’un blanc grisâtre, zoné de vert et
marbré de noir ; rectriees latérales marquées de raies plus étroites que les