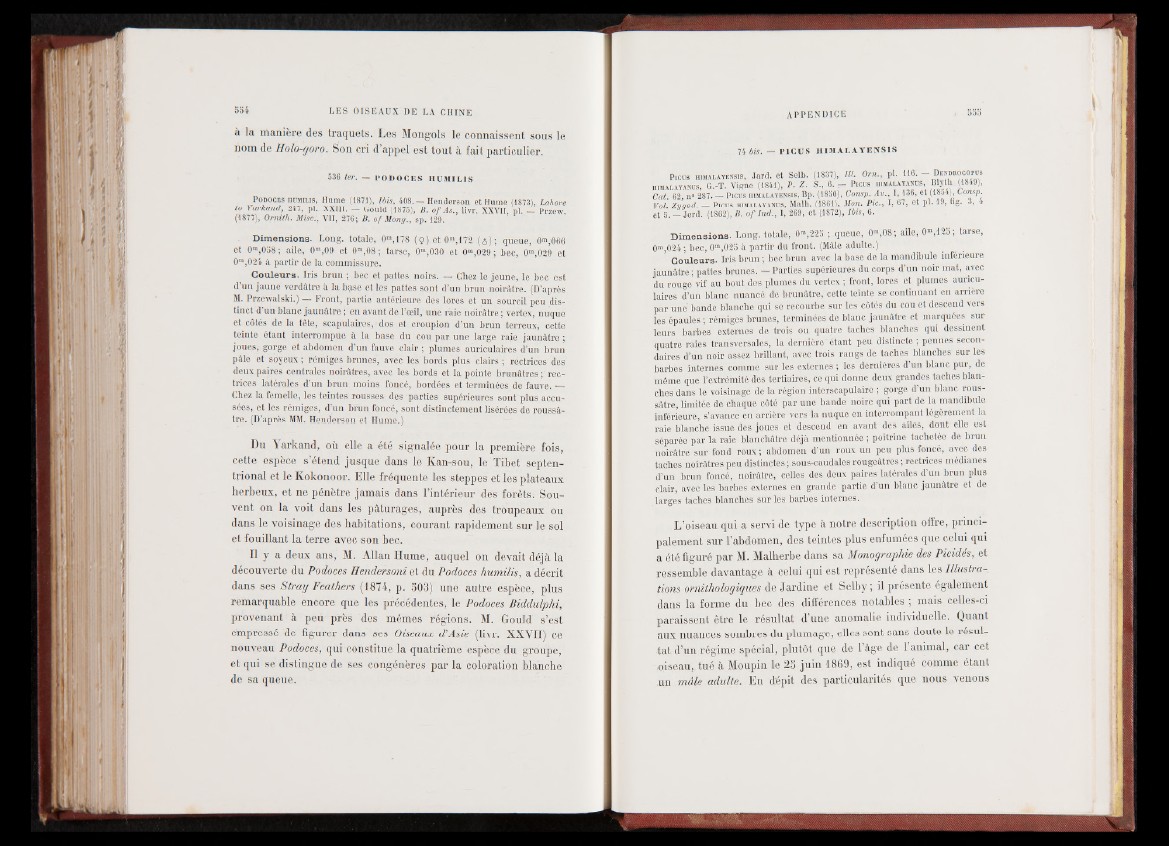
à la manière des traquets. Les Mongols le connaissent sous le
nom de Holo-goro. &on cri d’appel est tout à fait particulier.
536 ter. — PO D O C E S H UM IL IS
Podoces humilis, Hume (1871), Ibis, 408. — Henderson et Hume (1873) Làhore
to Yarkand, 247, pl. XXIII. — Gould (1875), B. of As., livr. XXVII, pl. — Przew.
(1877), Ornith. Misa, VII, 276; B. of Mony., sp. 129.
Dimensions. Long, totale, 0m,178 (ç) et 0m,172 (ô')l queue, 0m,066
et 0m,058 ; aile, 0m,09 et 0m,08 ; tarse, 0m,030 et 0m,029 ; bec, 0m,029 et
0m,024 à partir de la commissure.
Couleurs. Iris brun ; bec et pattes noirs. — Chez le jeune, le bec est
d’un jaune verdâtre à la bqse et les pattes sont d’un brun noirâtre. (D’après
M. Przewalski.) —■ Front, partie antérieure des lores et un sourcil peu distinct
d’un blanc jaunâtre ; en avant de l’oeil, une raie noirâtre ; vertex, nuque
et côtés de la tête, scapulaires, ■ dos et croupion d’un brun terreux, cette
teinte étant interrompue à la base du cou par une large raie jaunâtre ;
joues, gorge et abdomen d’un fauve clair ; plumes auriculaires d’un brun
pâle et soyeux; rémiges brunes, avec les bords plus clairs ; rectrices des
deux paires centrales noirâtres, avec les bords et la pointe brunâtres ;■ rectrices
latérales d’un brun moins foncé, bordées et terminées de fauve. —
Chez la femelle, les teintes rousses des parties supérieures sont plus accusées,
et les rémiges, d’un brun foncé, sont distinctement lisérées de roussâ-
tre. (D’après MM. Henderson et Hume.)
Du Yarkand, où elle a été signalée pour la première fois,
cette espèce s’étend jusque dans le Kan-sou, le Tibet septentrional
et le Kokonoor. Elle fréquente les steppes et les plateaux
herbeux, et ne pénètre jamais dans l’intérieur des forêts: Souvent
on la voit dans les pâturages, auprès des troupeaux ou
dans le voisinage des habitations, courant rapidement sur le sol
et fouillant la terre avec son bec.
Il y a deux ans, M. Allan Hume, auquel on devait déjà la
découverte du Podoces Hendersoni et du Podoces humilis, a décrit
dans ses Stray Feathers (1874, p. 503) une autre espèce, plus
remarquable encore que les précédentes, le Podoces Biddulphi,
provenant à peu près des mêmes régions. M. Gould s’est
empressé de figurer dans ses Oiseaux d'Asie (livr. XXVII) ce
nouveau Podoces, qui constitue la quatrième espèce du groupe,
et qui se distingue de ses congénères par la coloration blanche
de sa queue.
iiiÉiii
APPENDICE
74 bis, — F IC U S H IM A L A Y E N S I S
Picus HIMALAYENSIS, Jard. et Selbl (1837), M Orn., pl. 116. - DendSocopds
h im a l a y a n u s , G.-T. Vigne (1841), P. Z. S., 8. - Picot• h im a l a ï « w ,
Cat. 62 n° 287. — Picus h im a l à y e n s is , Bp. (1850), Consp. Av., 1,136, et (lool), tonsp.
Vol. Zygod. — Picus h im a l a y a n u s , Malh. (1861), Mon. Pic., I, 67, et pl. 19, ng. 3, 4
D im e n s i o n s . Long, totale, O1",225 ; queue, 0m,08; aile, 0m,12o; tarse,
0m,024 ; bec, 0m,025 à partir du front. (Mâle adulte-gl
C o u l e u r s . Iris brun ; bec brun avec la base de la mandibule inférieure
jaunâtre; pattes brunes. — Parties supérieures du corps d’un noir mat, avec
du rouge vif au bout des plumes du vertex ; front, lores et plumes auriculaires
d’un blanc nuancé, de brunâtre, cette teinte se continuant en arrière
par une bande blanche qui se recourbe sur les côtés du cou et descend vers
les épaules ; rémiges brunes, terminées de blanc jaunâtre et marquées sur
leurs barbes externes de trois ou quatre taches blanches 'qui dessinent
quatre raies transversales, la dernière' étant peu distincte ; pennes secondaires
d’un noir assez brillant, avec trois rangs de taches blanches sur les
barbes internes comme sûr les externes ; les dernières d’un blanc pur, de
môme que l’extrémité des tertiaires, ce qui donne deux grandes taches blanches
dans le voisinage de la région interscapulaire ; gorge d’un blanc rous-
sâtrê, limitée de chaque côté par une bande noire qui part de la mandibule
inférieure, s’avance en arrière vers la nuque en interrompant légèrement la
raie blanche issue des joues et descend en avant des ailes, dont elle est
séparée par la raie blanchâtre déjà mentionnée ; poitrine tachetée de brun
noirâtre sur fond roux ; abdomen d’un roux un peu plus foncé, avec des
taches noirâtres peu distinctes ; sous-caudales rougeâtres ; rectrices médianes
d’un brun foncé, noirâtre, celles des deux paires latérales d’un brun plus
clair, avec les barbes externes en grande partie d’un blanc jaunâtre et de
larges taches blanches sur les barbes internes.
L’oiseau qui a servi de type à notre description offre, principalement
sur l’abdomen, des teintes plus enfumées que celui qui
a été figuré par M. Malherbe dans sa Monographie des Picides, et
ressemble davantage à celui qui est représente dans les Illustrations
ornithologiques de Jardine et Selby ; il présente également
dans la forme du bec des différences notables ; mais celles-ci
paraissent être le résultat d’une anomalie individuelle. Quant
aux nuances sombres du plumage, elles sont sans doute le résultat
d’un régime spécial, plutôt que de l’âge de l’animal, car cet
.oiseau, tué à Moupin le 25 juin 1869, est indiqué comme étant
un mâle adulte. En dépit des particularités que nous venons