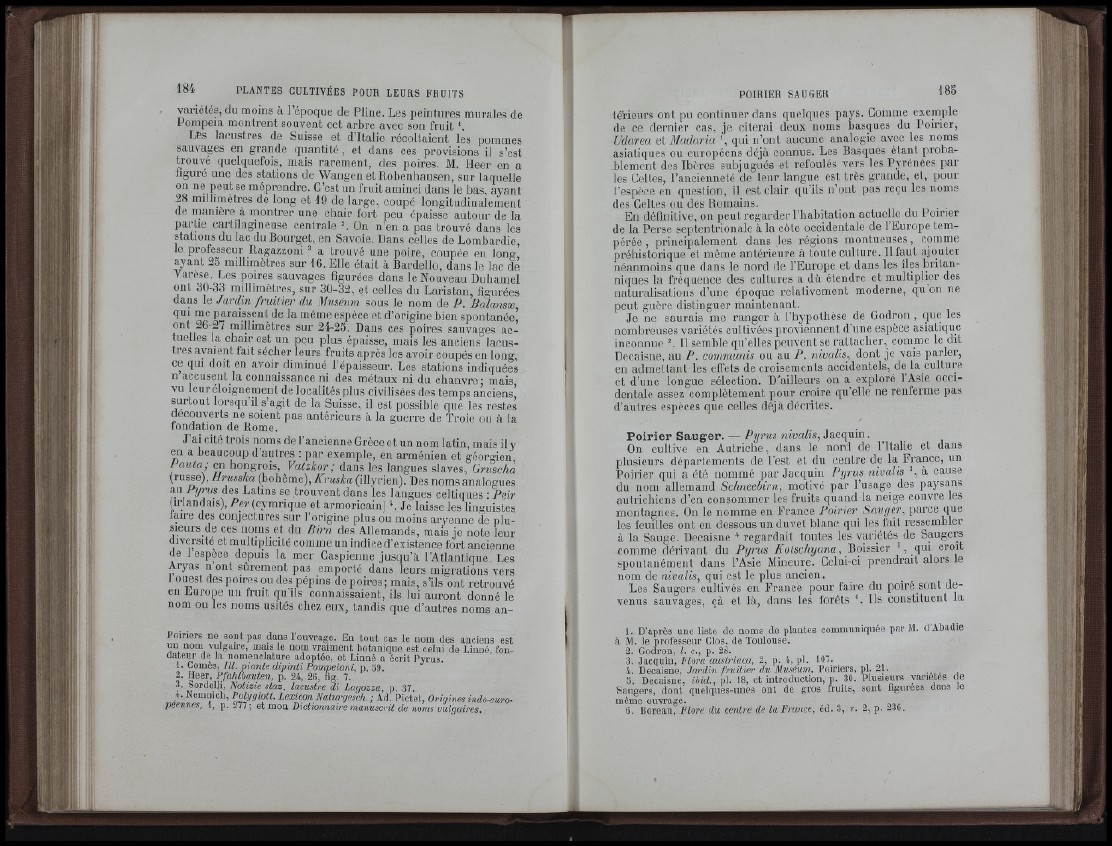
\,
hi.1
\
r i
j£l
: i
variétés, du moins à l ’époque de Pline. Les peintures murales de
Pompeia montrent souvent cet arbre avec son fruit fe
Les lacustres de Suisse et d’Italie récoltaient les pommes
sauvages en grande quantité, et dans ces provisions il s ’est
trouve quelquefois, mais rarement, des poires. M. Heer en a
figuré une des stations de Wangen et Robenhausen, sur laquelle
on ne peut se méprendre. G’est un fruit aminci dans le bas, ayant
28 millimètres de long et 19 de large, coupé longitudinalement
de maniere à montrer une chair fort peu épaisse autour de la
partie cartilagineuse centrale fe On n’en a pas trouvé dans les
stations du lac du Bourget, en Savoie. Dans celles de Lombardie,
le professeur Ragazzoni ^ a trouvé une poire, coupée en long
a p n t 25 millimètres sur 16. Elle était à Bardello, dans le lac de
Varèse. Les poires sauvages figurées dans le Nouveau Duhamel
ont 30-33 millimètres, sur 30-32, et celles du Laristan, figurées
dans le Ja rdm fruitier du Aluséum sous le nom de P . Balansæ
qui me paraissent de la même espèce et d’origine bien spontanée!
ont 26-27 millimètres sur 24-25. Dans ces poires sauvages actuelles
la chair est un peu plus épaisse, mais les anciens lacustres
avaient fait sécher leurs fruits après les avoir coupés en long,
ce qui doit en avoir diminué l’épaisseur. Les stations indiquées
n accusent la connaissance ni des métaux ni du chanvre ’ mais
vu leur/oignenoeut de localités plus civilisées des temps anciens,
/ r to u t lorsqu il s agit de la Suisse, il est possible que les restes
/ co u v e r t s ne soient pas antérieurs à la guerre de Troie ou à la
fondation de Rome.
J ’ai cité trois noms de l’ancienne Grèce et un nom latin, mais il y
en a b e a u c / p d’autres ; par exemple, en arménien et géorgien,
f f iu t a ; / h o / r o i s , Vatzkor ; dans les langues slaves, Gruscha
(rusre), Brusska (bohème), Kruska (illyrien). Des noms analogues
an Pijrus des Latins se trouvent dans les langues celtiques : P e ir
/ lan d a is ) , P e r (cymrique et armoricain) fe Je laisse les linguistes
taire des conjectures sur l ’origine plus ou moins aryenne de pinceurs
de ces noms et du Bi?m des Allemands, mais je note leur
div / s ité et multiplicité comme un indice d’existence fort ancienne
/ 1 e sp / e depuis la mer Caspienne jusqu’à l ’Atlantique. Les
Aryas n ont sûrement pas emporté dans leurs migrations vers
1 ouest des poires ou des pépins de poires ; mais, s ’ils ont retrouvé
en Europe un fruit qu’ils connaissaient, ils lui auront donné le
nom ou les noms usités chez eux, tandis que d’autres noms an-
Poiriers ne sopt pas dans l’ouvrage. En tout cas le nom des anciens est
/ nom vulgaire, mais le nom vraiment botanique est celui de Linné fondateur
de la nomenclature adoptée, et Linné a écrit Pyrus.
1. Comès, III. piante dipinti Pompeiani, p. 59.
2. Heer, Pfahlbauten, p. 24, 26, fig. 7.
3. Sordelli, Notizie staz. lacustre d i Lagozza, p. 37.
Í. Nemnich, Polyglott. Lexicon Naturgesch. ; Ad. Pictet, Origines indo-europeennes,
1 , p. 277 ; et mon Dictionnaire manuscrit de noms vulgaires.
I
I
té'ricurs ont pu continuer dans quelques pays. Gomme exemple
de ce dernier cas, je citerai deux noms basques du Poirier,
Udarea et Aladaria fe qui n’ont aucune analogie avec les noms
asiatiques ou européens déjà connus. Les Basques étant probablement
des Ibères subjugués et refoulés vers les Pyrénées par
les Celles, l ’ancienneté de leur langue est très grande, et, pour
l ’espèce en question, il est clair qu’ils n’ont pas reçu les noms
des Geltes ou des Romains.
En définitive, on peut regarder l’habitation actuelle du Poirier
de la Perse septentrionale à la côte occidentale de 1 Europe tempérée
, principalement dans les régions montueuses, comme
préhistorique et même antérieure à toute culture. Il faut ajouter
néanmoins que dans le nord de l’Europe et dans les îles britanniques
la fréquence des cultures a dû étendre et multiplier des
naturalisations d’une époque relativement moderne, qu on ne
peut guère distinguer maintenant.
Je ne saurais me ranger à l’hypothèse de Godren , que les
nombreuses variétés cultivées proviennent d’une espèce asiatique
inconnue fe H semble qu’elles peuvent se rattacher, comme le dit
Deeaisne, au P . communis ou au P . nivalis, dont je vais parler,
en admettant les effets de croisements accidentels, de la culture
et d’une longue sélection. D'ailleurs on a exploré l’Asie occidentale
assez complètement pour croire qu’elle ne renferme pas
d’autres espèces que celles déjà décrites.
/
P o i r i e r S a u g e r . — Pyrus nivcdis, Jacquin.
On cultive en Autriche, dans le nord de l ’Italie et dans
plusieurs départements de l ’est et du centre de la France, nn
Poirier qui a été nommé par Jacquin Pyrus nivalis fe à cause
du nom allemand Schneebirn, motivé par l ’usage des paysans
autrichiens d’en consommer les fruits quand la neige couvre les
montagnes. On le nomme en France P o irie r Sauger, parce que
les feuilles ont en dessous un duvet blanc qui les lait ressembler
à la Sauge. Deeaisne *» regardait toutes les variétés de Saugers
comme dérivant du Pyt'us Kotschyana, Boissier **, qui croit
spontanément dans l’Asie Mineure. Celui-ci prendrait alors le
nom de nivalis, qui est le plus ancien.
Les Saugers cultivés en France pour faire du poiré sont d /
venus sauvages, çà et là, dans les forêts Ils constituent la
1. D’après une liste de noms de plantes communiquée pai- M. d'Abadie
à M. le professeur Clos, de Toulouse.
2. Godron, l. c., p. 28.
3. Jacquin, Floxm ausùùaca, 2, p. 4, pl. 107.
4. Deeaisne, Ja rdin fn iitie r du Muséum, Poiriers, pl. 21. _
5. Deeaisne, ibid., pl. 18, et introduction, p. 30. Plusieurs variétés de
Saugers, dont quelques-unes ont de gros fruits, sont figurées dans le
même ouvrage. ,7 coe
6. Boreau, Flore du centre de la France, éd. 3, v. 2, p. 236.
t