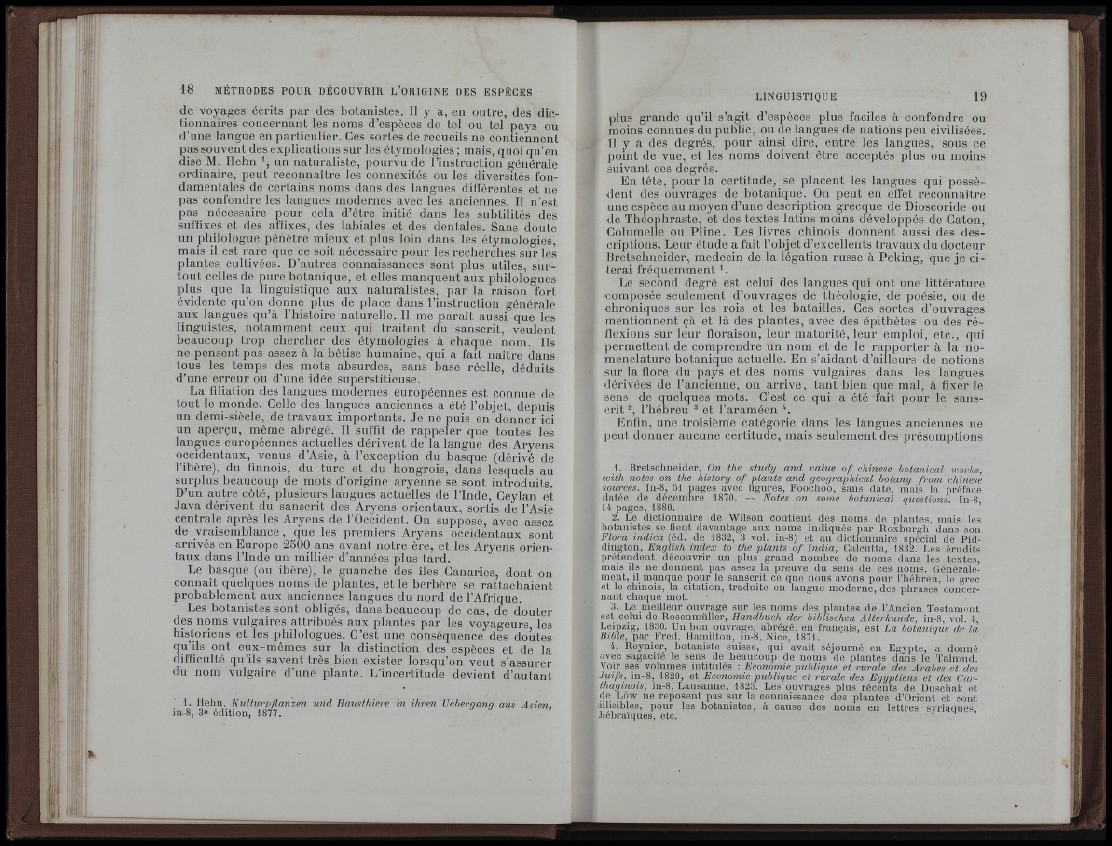
t1
il- I
I
I
r i
J
\ iii
de voyages écrits par des botanistes. Il y a, en outre, des dictionnaires
concernant les noms d’espèces de tel ou tel pays ou
d’une langue en particulier. Ges sortes de recueils ne contiennent
pas souvent des explications sur les étymologies ; mais, quoi qu’en
dise M. Hebn \ un naturaliste, pourvu de l ’instruction générale
ordinaire, peut reconnaître les connexités ou les diversités fondamentales
de certains noms dans des langues différentes et ne
pas confondre les langues modernes avec les anciennes. Il n’est
pas nécessaire pour cela d’étre initié dans les subtilités des
suffixes et des affixes, des labiales et des dentales. Sans doute
un philologue pénètre mieux et plus loin dans les étymologies,
mais il est rare que ce soit nécessaire pour les recherches sur les
plantes cultivées. D’autres connaissances sont plus utiles, surtout
celles de pure botanique, et elles manquent aux philologues
plus que la linguistique aux naturalistes, par la raison fort
évidente qu’on donne plus de place dans l ’instruction générale
aux langues qu’à l ’histoire naturelle. Il me paraît aussi que les
linguistes, notamment ceux qui traitent du sanscrit, veulent
beaucoup trop chercher des étymologies à chaque nom. Ils
ne pensent pas assez à la bêtise humaine, qui a fait naître dans
tous les temps des mots absurdes, sans base réelle, déduits
d’ une erreur ou d’une idée superstitieuse.
La filiation des langues modernes européennes est connue de
tout le monde. Celle des langues anciennes a été l’objet, depuis
un demi-siècle, de travaux importants. Je ne puis en donner ici
un aperçu, même abrégé. Il suffit de rappeler que toutes les
langues européennes actuelles dérivent de la langue des Aryens
occidentaux, venus d’Asie, à l ’exception du basque (dérivé de
l’ibère), du finnois, du turc et du hongrois, dans lesquels au
surplus beaucoup de mots d’origine aryenne se sont introduits.
D’un autre côté, plusieurs langues actuelles de l’Inde, Geylan et
Ja v a dérivent du sanscrit des Aryens orientaux, sortis de l’Asie
centrale après les Aryens de fOccident. On suppose, avec assez
de vraisemblance, que les premiers Aryens occidentaux sont
arrivés en Europe 2500 ans avant notre ère, et les Aryens orientaux
dans l ’Inde un millier d’années plus tard.
Le basque (ou ibère), le guanche des îles Ganaries, dont on
connaît quelques noms de plantes, et le berbère se rattachaient
probablement aux anciennes langues du nord de l ’Afrique.
Les botanistes sont obligés, dans beaucoup de cas, de douter
des noms vulgaires attribués aux plantes par les voyageurs les
historiens et les philologues. C’est une conséquence des doutes
qu’ils ont eux-mêmes sur la distinction des espèces et de la
difficulté qu’ils savent très bien exister lorsqu’on veut s’assurer
du nom vulgaire d’une plante. L'incertitude devient d’autant
»
1. Hehn, Kulturpflanzen und Eausthiere in ihren Ueberqanq aus Asien,
in-8, 3e édition, 1877.
plus grande qu’il s ’agit d’espèces plus faciles à confondre ou
moins connues du public, ou de langues de nations peu civilisées.
Il y a des degrés, pour ainsi dire, entre les langues, sous ce
point de vue, et les noms doivent être acceptés plus ou moins
suivant ces degrés.
En tête, pour la certitude, se placent les langues qui possèdent
des ouvrages de botanique. On peut en effet reconnaître
une espèce au moyen d’une description grecque de Dioscoride ou
de Théophraste, et des textes latins moins développés de Gaton,
Golumelle ou Pline. Les livres chinois donnent aussi des descriptions.
Leur étude a fait l’objet d’excellents travaux du docteur
Bretschneider, médecin de la légation russe à Peking, que je citerai
fréquemment L
Le second degré est celui des langues qui ont une littérature
composée seulement d’ouvrages de théologie, de poésie, ou de
chroniques sur les rois et les batailles. Ges sortes d’ouvrages
mentionnent çà et là des plantes, avec des épithètes ou des réflexions
sur leur floraison, leur maturité, leur emploi, etc., qui
permettent de comprendre un nom et de le rapporter à la nomenclature
botanique actuelle. En s’aidant d ’ailleurs de notions
sur la flore du pays et des noms vulgaires dans les langues
dérivées de l’ancienne, on arrive, tant bien que mal, à fixer le
sens de quelques mots. C’est ce qui a été fait pour le sanscrit
l ’hébreu ^ et l ’araméen
Enfin, une troisième catégorie dans les langues anciennes ne
peut donner aucune certitude, mais seulement des présomptions
1. Bretschneider, On the study and value o f chínese botanical works,
with notes on the history o f plants and geographical botany from chínese
sources. In-8, 51 pages avec figures, Foochod, sans date, mais la préface
datée de décembre 1870. — Notes on some botanical questions, ln-8,
14 pages, 1880.
2. Le dictionnaire de Wilson contient des noms de plantes, mais les
botanistes se fient davantage aux noms indiqués par Roxburgh dans son
Flora indica (éd. de 1832, 3 vol. in-8) et au dictionnaire spécial de Pid-
dington, English index to the plants o f India, Calcutta, 1832. Les érudits
prétendent découvrir un plus grand nombre de noms dans les textes,
mais ils ne donnent pas assez la preuve du sens de ces noms. Généralement,
il manque pour le sanscrit ce que nous avons pour l’hébreu, le grec
et le chinois, la citation, traduite en langue moderne, des phrases concernant
chaque mot.
3. Le meilleur ouvrage sur les noms des plantes de l’Ancien Testament
est celui de Rosenmüller, Handhuch der biblischen Alterkunde, in-8, vol. 4,
Leipzig, 1830. Uu bon ouvrage, abrégé, en français, est La botanique de la
Bible, par Fred. Hamilton, in-8, Nice, 1871.
4. Reynier, botaniste suisse, qui avait séjourné en Egypte, a donné
avec sagacité le sens de beaucoup de noms de plantes dans le Talmud
Voir ses volumes intitulés : Economie publique et rurale des Arabes et des
Ju ifs, in-8, 1820, et Economie publique et rurale des Egyptiens et des Carthaginois,
in-8, Lausanne, 1823. Les ouvrages plus récents de Duschak et
de Low ne reposent pas sur la connaissance des plantes d’Orient et sont
idlisibles, pour les botanistes, à cause des noms en lettres syriaques,
hébraïques, etc.
i I