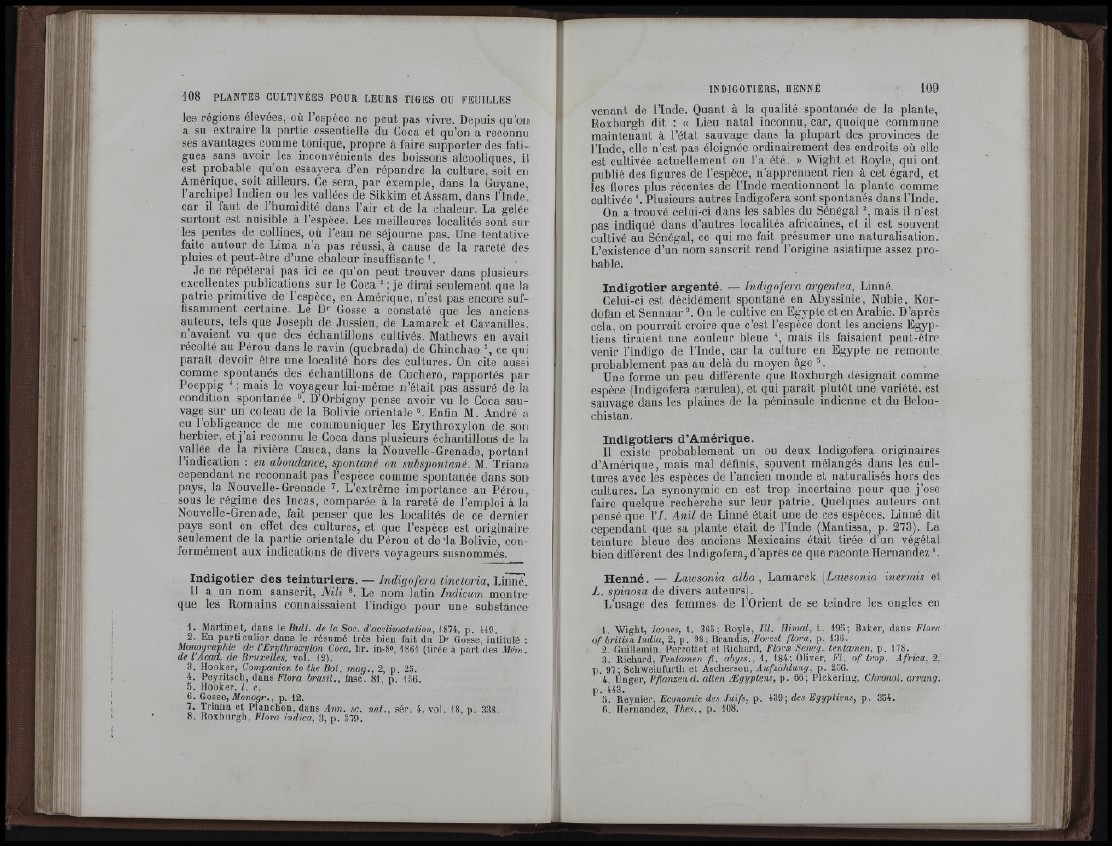
.! ..'.i
-ii ' lU mf: i
i.
.1" I
I
, í
it
Jes régions élevées, où l ’espèce ne peut pas vivre. Depuis qu’on
a su extraire la partie essentielle du Goca et qu’on a reconnu
ses avantages comme tonique, propre à faire supporter des fatigues
sans avoir les inconvénients des boissons alcooliques, il
est probable qu’on essayera d’en répandre la culture, soit en
Amérique, soit ailleurs. Ce sera, par exemple, dans la Guyane,
l’archipel Indien ou les vallées de Sikkim et Assam, dans l’Inde»
car il faut de l ’humidité dans l ’air et de la chaleur. La gelée
surtout est nuisible à l ’espèce. Les meilleures localités sont sur
les pentes de collines, où Teau ne séjourne pas. Une tentative
faite autour de Lima n’a pas réussi, à cause de la rareté des
pluies et peut-être d’une chaleur insuffisante fe
Je ne répéterai pas ici ce qu’on peut trouver dans plusieurs
excellentes publications sur le Coca ^ ; je dirai seulement que la
patrie primitive de fespèce, en Amérique, n’est pas encore suffisamment
certaine. Le D» Gosse a constaté que les anciens
auteurs, tels que Joseph de Jussieu, de Lamarck et Gavanilles,
n’avaient vu que des échantillons cultivés. Mathews en avait
récolté au Pérou dans le ravin (quebrada) de Chinchao fe ce qui
paraît devoir être une localité hors des cultures. On cite aussi
comme spontanés des échantillons de Guchero, rapportés par
Poeppig ^ ; mais le voyageur lui-même n ’était pas assuré de la
condition spontanée fe D’Orbigny pense avoir vu le Coca sauvage
sur un coteau de la Bolivie orientale fe Enfin M. André a
eu l ’obligeance de me communiquer les Erythroxylon de son
herbier, et j ’ai reconnu le Goca dans plusieurs échantillons de la
vallée de la rivière Gauca, dans la Nouvelle-Grenade, portant
l’indication : en abondance, spontané ou subspontané. M. Triana
cependant ne reconnaît pas l’espèce comme spontanée dans son
pays, la Nouvelle-Grenade L ’extrême importance au Pérou,,
sous le régime des Incas, comparée à la rareté de l ’emploi à la
Nouvelle-Grenade, fait penser que les localités de ce dernier
pays sont en effet des cultures, et que l ’espèce est originaire
seulement de la partie orientale du Pérou et de 'la Bolivie, conformément
aux indications de divers voyageurs susnommés.
I n d i g o t i e r d e s t e in t u r i e r s . — Indigofera tinctoria, Linné..
Il a un nom sanscrit, JSili ®. Le nom latin Indicum montre
que les Romains connaissaient l ’indigo pour une substance-
1. Martine t, dans le Bull, de la Soc. d’acclimatation, 1874, p 449
2. En p a r t icu lie r dans le résumé très bien fait dn D> Gosse, intitulé
Monographie de VErythroxylon Coca, br. in-8<>, 1861 (tirée à part des Mém.
de l’Àcad. de Bruxelles, v o l. 12).
3. Hooker, Companion to the Bot. mag., 2, p. 25.
4. Peyr itsch, dans FZom brasil., fase. 81, p. 156.
5. Hooker, l. c.
6. Gosse, Monogr., p. 12.
7. / i a n a et Planchón, dans Ann. sc. nat., sér. 4, v o l. 18, p . 338..
8. Roxburgh, Flora indica, 3, p . 379.
INDIGOTIERS, HENNÉ 109
venant de l ’Inde. Quant à la qualité spontanée de la plante,
Roxburgh dit : « Lieu natal inconnu, car, quoique commune
maintenant à l ’état sauvage dans la plupart des provinces de
finde, elle n’est pas éloignée ordinairement des endroits où elle
est cultivée actuellement ou f a été. » Wight et Royle, qui ont
publié des figures de fespèce, n ’apprennent rien à cet égard, et
les flores plus récentes de find e mentionnent la plante comme
cultivée fe Plusieurs autres Indigofera sont spontanés dans l’Inde.
On a trouvé celui-ci dans les sables du Sénégal fe mais il n’est
pas indiqué dans d’autres localités africaines, et il est souvent
cultivé au Sénégal, ce qui me fait présumer une naturalisation.
L ’existence d’un nom sanscrit rend l ’origine asiatique assez probable.
Indigotier argenté. — Indigofera argentea, Linné.
Celui-ci est décidément spontané en Abyssinie, Nubie, Kor-
dofan et Sennàar fe On le cultive en Egypte et en Arabie. D’après
cela, on pourrait croire que c’est l ’espèce dont les anciens Eg yptiens
tiraient une couleur bleue mais ils faisaient peut-être
venir findigo de l’Inde, car la culture en Egypte ne remonte
probablement pas au delà du moyen âge fe
Une forme un peu différente que Roxburgh désignait comme
espèce (Indigofera cærulea), et qui paraît plutôt une variété, est
sauvage dans les plaines de la péninsule indienne et du Belouchistan.
Indigotiers d’Amérique.
Il existe probablement un ou deux Indigofera originaires
d ’Amérique, mais mal définis, souvent mélangés dans les cultures
avec les espèces de fancien monde et naturalisés hors des
cultures. La synonymie en est trop incertaine pour que j ’ose
faire quelque recherche sur leur patrie. Quelques auteurs ont
pensé que 1’/. A n ü de Linné était une de ces espèces. Linné dit
cependant que sa plante était de find e (Mantissa, p. 273). La
teinture bleue des anciens Mexicains était tirée d’un végétal
bien différent des Indigofera, d’après ce que raconte Hernandez fe
Henné. — Lawsonia alba , Lamarck [Lawsonia inermis et
L . spinosa de divers auteurs).
L ’usage des femmes de l ’Orient de se teindre les ongles en
1. Wight, Icones, t . 365; R o / e , III. Himal, t. 195; Baker, dans Flora
of british India, 2, p. 98; Brandis, Forest flora, p. 136.
2. Gnillemin, Perrottet et Richard» Floræ Seneg. tentamen, p. 178.
3. Richard, Tentamen fl. abyss., 1, 184; Oliver, Fl. of trop. Africa, 2,
p . 97; Schweinfurth et Ascherson, Aufzählung, p. 256.
4 Unger, Pflanzend, alten Ægyptens, p . 66; Pickering, Chronol. arrang.
p . 443.
5. Reynier, Economie des Juifs, p. 439; des Egyptiens, p . 354.
6. Hernandez, Thes., p . 108.
."'l