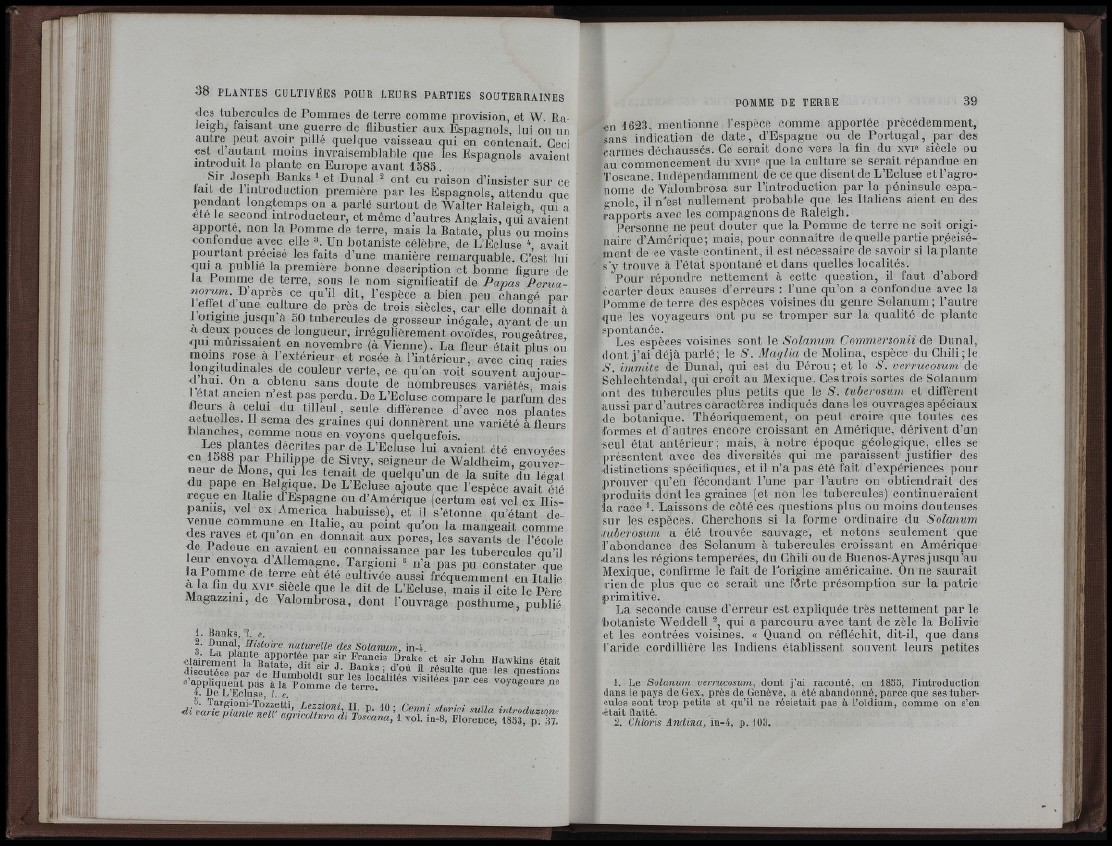
!■' i'-"J''I wi
■ I , i ' ! ' ' i
des tubercules de Pommes de terre comme provision, et W. Raleigh,
faisant une guerre de flibustier aux Espagnols, lui ou un
autre peut avoir pillé quelque vaisseau qui en contenait. Ceci
€st d autant moins invraisemblable que les Espagnols avaient
introduit la plante en Europe avant 158 5 .
r J Joseph Banks ^ et Dunal ^ ont eu raison d’insister sur ce
tait de 1 introduction première par les Espagnols, attendu que
pendant longtemps on a parlé surtout de Walter Baleigh, qui a
été le second introducteur, et même d’autres Anglais, qui avaient
apporté non la Pomme de terre, mais la Batate, plus ou moins
coniondue avec elle fe Un botaniste célèbre, de L ’Ecluse fe avait
pourtant précisé les faits d’une manière remarquable. C’est lui
qui a publié la première bonne description et bonne figure de
la Pomme de terre, sous le nom significatif de Papas Perua-
nomm D après ce qu’il dit, l’espèce a bien peu changé par
1 effet d une culture de près de trois siècles, car elle donnait à
1 origine jusqu à 50 tubercules de grosseur inégale, ayant de un
a deux pouces de longueur, irrégulièrement ovoïdes, rougeâtres,
qui mûrissaient en novembre (à Vienne). La fleur était plus ou
moins rose à l ’extérieur et rosée à l ’intérieur, avec cinq raies
longitudinales de couleur verte, ce qu’on voit souvent auiour-
d nui. Un a obtenu sans doute de nombreuses variétés, mais
1 état ancien n est pas perdu. De L ’Ecluse compare le parfum des
fleurs a celui du tilleul, seule différence d’avec nos plantes
actuelles. 11 sema des graines qui donnèrent une variété à fleurs
manches, comme nous en voyons quelquefois.
L ’Ecluse lui avaient été envoyées
5 Philippe de Sivry, seigneur de Waldheim, gouverneur
de Mons, qui les tenait de quelqu’un de la suite du légat
T? L ’Ecluse ajoute que l ’espèce avait été
reçue en Italie d Espagne ou d’Amérique (certum est vel ex His-
paniis, vel ex America habuisse), et il s ’étonne qii’étant devenue
commune en Italie, au point qufen la mangeait comme
des raves et qu on en donnait aux porcs, les savants de l ’école
, e Dadoue en avaient eu connaissance par les tubercules au’il
leur envoya d Allemagne. Targioni ® n’a pas pu constater que
fe Pomme de terre eut été cultivée aussi fréquemment en Italie
n 1a fin du x v F siecle que le dit de L ’Ecluse, mais il cite le Père
Magazzmi, de Valombrosa, dont l’ouvrage posthume, publié
1. Banks, L e.
2. Dunal, Histoire naturelle des Solanum, in-4
<^lairern\m k ^ h n Hawkins était
4. De L’Ecluse, z. c.
un 1623, mentionne fespèce comme apportée précédemment,
sans indication de date, d’Espagne ou de Portugal, par des
carmes déchaussés. Ce serait donc vers 1a fin du xvi® siècle ou
au commencement du xvii® que 1a culture se serait répandue en
Toscane. Indépendamment de ce que disent de L ’Ecluse et l’agronome
de Valombrosa sur l ’introduction par 1a péninsule espagnole,
il riest nullement probable que les Italiens aient eu des
rapports avec les compagnons de Baleigh.
Personne ne peut douter que 1a Pomme de terre ne soit originaire
d’Amérique; mais, pour connaître de quelle partie précisément
de ce vaste continent, il est nécessaire de savoir si 1a plante
s y trouve à l ’état spontané et dans quelles localités.
Pour répondre nettement à cette question, il faut d’abord
écarter deux causes d’erreurs : l’une qu’on a confondue avec 1a
Pomme de terre des espèces voisines du genre Solanum ; l’autre
que les voyageurs ont pu se tromper sur 1a qualité de plante
spontanée.
Les espèces voisines sont le Solanum Commersonii àa Dunal,
dont j ’ai déjà parlé; le S. Maglia de Molina, espèce du Chili; le
S. immite de Dunal, qui est du Pérou; et le S. verrucosum de
Schlechtendal, qui croît au Mexique. Ges trois sortes de Solanum
ont des tubercules plus petits que le S. tuberosum et diffèrent
aussi par d’autres caractères indiqués dans les ouvrages spéciaux
de botanique. Théoriquement, on peut croire que toutes ces
formes et d’autres encore croissant en Amérique, dérivent d’un
■seul état antérieur; mais, à notre époque géologique, elles se
présentent avec des diversités qui me paraissent justifier des
■distinctions spécifiques, et il n’a pas été fait d’expériences pour
prouver qu’en fécondant l ’une par l ’autre on obtiendrait des
produits dont les graines (et non les tubercules) continueraient
ia race fe Laissons de côté ces questions plus ou moins douteuses
sur les espèces. Cherchons si 1a forme ordinaire du Solanum
tuberosum a été trouvée sauvage, et notons seulement que
l’abondance des Solanum à tubercules croissant en Amérique
•dans les régions tempérées, du Chili ou de Buenos-Ayres jusqu’au
Mexique, confirme le fait de Porigine américaine. On ne saurait
rien de plus que ce serait une fòrte présomption sur 1a patrie
primitive.
La seconde cause d’erreur est expliquée très nettement par le
botaniste Weddell qui a parcouru avec tant de zèle 1a Bolivie
et les contrées voisines, a Quand on réfléchit, dit-il, que dans
l’aride cordilllère les Indiens établissent souvent leurs petites
1. Le Solanum verrucosum, dont j ’ai raconté, en 18SS, l’introduction
dans le pays de Gex, près de Genève, a été abandonné, parce que ses tubercules
sont trop petits et qu’il ne résistait pas à l’oïdimn, comme on s’en
é ta it flatté.
.2. Chloris Andina, in-4, p. 103.
!
il
m
' I
u I f