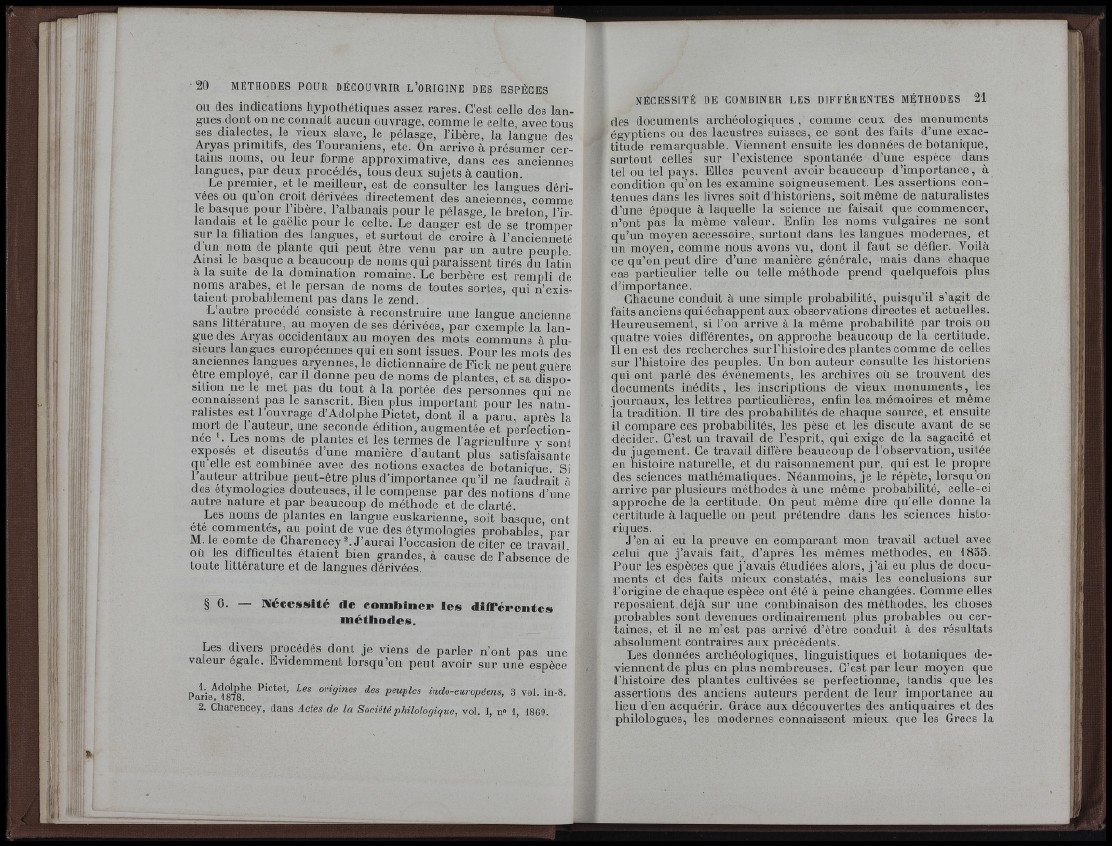
ou des indications hypothétiques assez rares. C’est celle des langues
dont on ne connaît aucun ouvrage, comme le celte, avec tous
ses dialectes, le vieux s la v / le pélasge, Tibère, la langue des
Aryas primitifs, des Touraniens, etc. On arrive a présumer certains
noms, ou leur forme approximative, dans ces anciennes
langues, par deux procédés, tous deux sujets à caution.
Le premier, et le meilleur, est de consulter les langues dérivées
ou qu’on croit dérivées directement des anciennes, comme
le basque pour Tibère, l’albanais pour le pélasge, le breton, Tir-
landais et le gaëlic pour le celte. Le danger est de se tromper
sur la fdiation des langues, et surtout de croire à l ’ancienneté
d ’un nom de plante qui peut être venu par un autre peuple.
Ainsi le basque a beaucoup de noms qui paraissent tirés du latin
à la suite de la domination romaine. Le berbère est rempli de
noms arabes, et le persan de noms de toutes sortes, qui n’existaient
probablement pas dans le zend.
L ’autre procédé consiste à reconstruire une langue ancienne
sans littérature, au moyen de ses dérivées, par exemple la langue
des Aryas occidentaux au moyen des mots communs à plusieurs
langues européennes qui en sont issues. Pour les mots des
anciennes langues aryennes, le dictionnaire de Fick ne peut guère
être employé, car il donne peu de noms de plantes, et sa disposition
ne le met pas du tout à la portée des personnes qui ne
connaissent pas le sanscrit. Bien plus important pour les naturalistes
est l ’ouvrage d’Adolphe Pictet, dont il a paru, après la
mort de Tauteur, une seconde édition, augmentée et perfectionnée
Les noms de plantes et les termes de l ’agriculture y sont
exposés et discutés d’une manière d’autant plus satisfaisante
qu’elle est combinée avec des notions exactes de botanique Si
Tauteur attribue peut-être plus d’importance qu’il ne faudrait à
des étymologies douteuses, il le compense par des notions d’une
autre nature et par beaucoup de méthode et de clarté.
Les noms de plantes en langue euskarienne, soit basque, ont
été commentés, au point de vue des étymologies probables par
M.le comte de Gharencey^ J ’aurai l ’occasion de citer ce travail
où les difficultés étaient bien grandes, à cause de Tabsence de
toute littérature et de langues dérivées.
6. IVécessiîté de comliinei* les différentes
méthodes.
Les divers procédés dont je viens de parler n’ont pas une
valeur égale. Evidemment lorsqu’on peut avoir sur une espèce
Par"is^?87^^^ P ktet, Les origines des peuples indo-européens, 3 vol. in-8.
2. Charencey, dans Actes de la Société philologique, vol. I, n“ 1, 1869.
Né c e s s it é de combiner l e s d if f é r e n t e s méthodes 21
des documents archéologiques , comme ceux des monuments
égyptiens ou des lacustres suisses, ce sont des faits d’une exactitude
remarquable. Viennent ensuite les données de botanique,
surtout celles sur Texistence spontanée d’une espèce dans
tel ou tel pays. Elles peuvent avoir beaucoup d ’importance, à
condition qu’on les examine soigneusement. Les assertions contenues
dans les livres soit d’historiens, soit même de naturalistes
d’une époque à laquelle la science ne faisait que commencer,
n’ont pas la même valeur. Enfin les noms vulgaires ne sont
qu’un moyen accessoire, surtout dans les langues modernes, et
un moyen, comme nous avons vu, dont il faut se défier. Voilà
ce qu’on peut dire d’une manière générale, mais dans chaque
cas particulier telle ou telle méthode prend quelquefois plus
d’importance.
Chacune conduit à une simple probabilité, puisqu’il s’agit de
faits anciens qui échappent aux observations directes et actuelles.
Heureusement, si Ton arrive à la même probabilité par trois ou
quatre voies différentes, on approche beaucoup de la certitude.
Il en est des recherches sur Thistoire des plantes comme de celles
sur Thistoire des peuples. Un bon auteur consulte les historiens
qui ont parlé des événements, les archives où se trouvent des
documents inédits, les inscriptions de vieux monuments, les
journaux, les lettres particulières, enfin les. mémoires et même
la tradition. Il tire des probabilités de chaque source, et ensuite
il compare ces probabilités, les pèse et les discute avant de se
décider. C’est un travail de Tesprit, qui exige de la sagacité et
du jugement. Ce travail diffère beaucoup de l ’observation, usitée
en histoire naturelle, et du raisonnement pur, qui est le propre
des sciences mathématiques. Néanmoins, je le répète, lorsqu’on
arrive par plusieurs méthodes à une même probabilité, celle-ci
approche de la certitude. On peut même dire qu’elle donne la
certitude à laquelle on peut prétendre dans les sciences historiques.
J ’en ai eu la preuve en comparant mon travail actuel avec
«celui que j ’avais fait, d’après les mêmes méthodes, en 1855.
Pour les espèces que j ’avais étudiées alors, j ’ai eu plus de documents
et des faits mieux constatés, mais les conclusions sur
Torigine de chaque espèce ont été à peine changées. Gomme elles
reposaient, déjà sur une combinaison des méthodes, les choses
probables sont devenues ordinairement plus probables ou certaines,
et il ne m’est pas arrivé d’être conduit à des résultats
absolument contraires aux précédents.
Les données archéologiques, linguistiques et botaniques deviennent
de plus en plus nombreuses. C’est par leur moyen que
Thistoire des plantes cultivées se perfectionne, tandis que les
assertions des anciens auteurs perdent de leur importance au
lieu d’en acquérir. Grâce aux découvertes des antiquaires et des
philologues, les modernes connaissent mieux que les Grecs la
i f