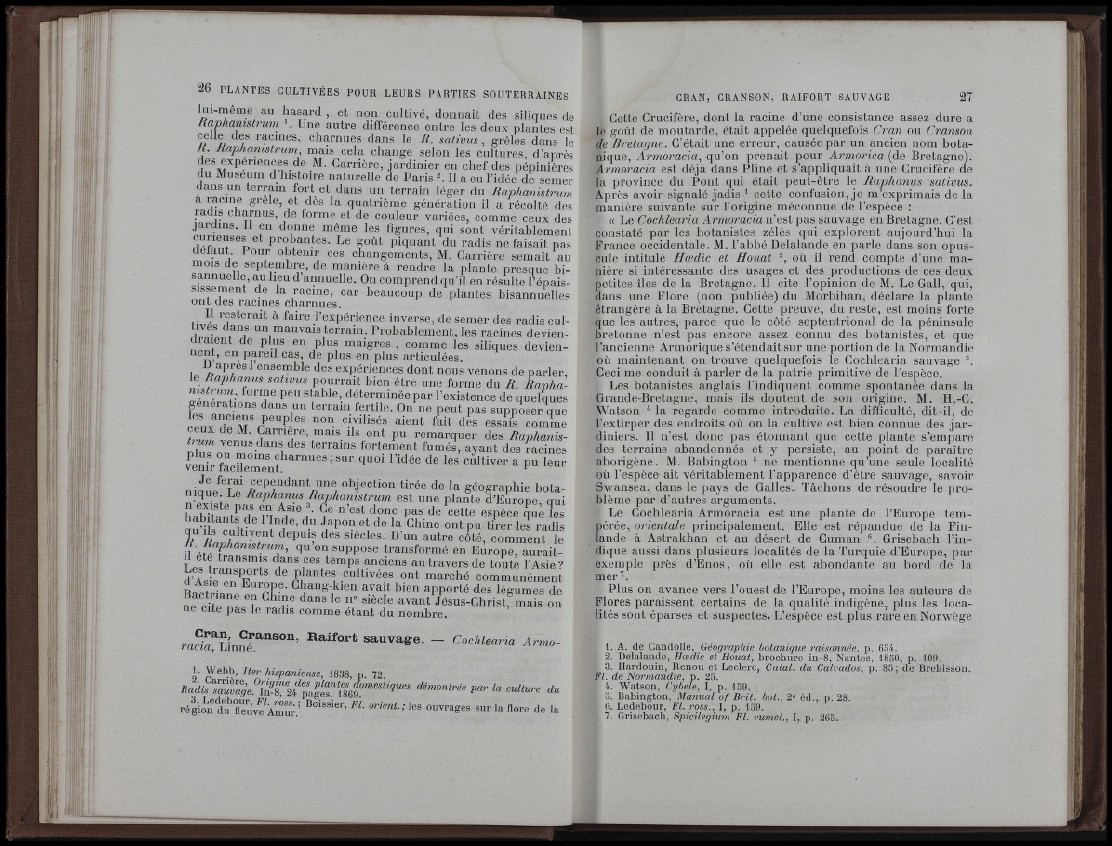
I1 ': I
il i
Il !
lui-même au hasard , et non cultivé, donnait des siliques de
RaphaniUrum . Une autre différence entre les deux plantes est
celle des racines, charnues dans le R. sativus, grêles dans le
Ii. naphamstrum, mais cela change selon les cultures, d’après
des experiences de M. Carrière, jardinier en chef des pépinières
du Museum d histoire naturelle de Paris fe II a eu l ’idée de semer
dans un terrain fort et dans un terrain léger du Raphanistrum
a racine grele, et dès la quatrième génération il a récolté des
radis charnus, de forme et de couleur variées, comme ceux des
jardins. Il en donne même les figures, qui sont véritablement
curieuses et probantes. Le goût piquant du radis ne faisait pas
ûetaut. Pour obtenir ces changements, M. Carrière semait au
mois de septembr/ de manière à rendre la plante presque bisannuelle,
au lieu d annuelle. On comprend qu’il en résulte l’épaississement
de la racine, car beaucoup de plantes bisannudles
ont des racines charnues.
Il resterait à faire l ’expérience inverse, de semer des radis culd
Z Î terrain. Probablement, les racines deviendraient
de plus en plus maigres , comme les siliques deviennent,
en pareil cas, de plus en plus articulées.
D après 1 ensemble des expériences dont nous venons de parler,
le Raphanus sativus pourrait bien être une forme du R. Rapha-
mstrum, forme peu stable, déterminée par l’existence de quelques
generations dans un terrain fertile. On ne peut pas sn p p 7 e r 7 u e
ti um v L f e i P“ des Maphanis- venus dans des terrains fortement fumés, ayant des racines
v t fo c r r n f - p“
Je ferai cependant une objection tirée de la géographie botanique.
Le Raphanus Raphanistrum est une plante d’Europe qui
Labbiutalnftes Xde 1r .In rdief,e d-u Japon et de la PG"h^i ne ont pu etsirpeèro leesX rfaedëiss
R"r. RRalpnhhalnnisltTru^m , qu on suppose transformé en Eurocopme,m aeunrta itl-e
T dans ces temps anciens au travers de toute l ’Asie?
ad ’AAssiier ëenn TELumrop e. Gr ih“an*g*-'!k ien atait bien a“p»p■o■rcthéé dceosm lém©uunmémese dnet
Bactnane en Ghine dans le ii- siècle avant Jésus-Christ Z i s Z
ne cite pas le radis comme étant du nombre.
C ran , C ran so n , R a i f o r t s a u v a g e
racia, Linné. Cochlearia Armo-
1. Webb, Iter hispaniense, 1838, p. 72.
Radis démontrée par la culture du
A m S ; 1» «ore de la
Cette Crucifère, dont la racine d’une consistance assez dure a
le goût de moutarde, était appelée quelquefois Cran ou Cranson
de Bretagne. C’était une erreur, causée par un ancien nom botanique,
Armoracia, qu’on prenait pour Armorica (de Bretagne).
Armoracia est déjà dans Pline et s ’appliquait à une Crucifère de
la province du Pont qui était peut-être le Raphanus sativus.
Après avoir signalé jadis ^ cette confusion, je m’exprimais de la
manière suivante sur l’origine méconnue de l ’espèce :
« Le Cochlearia Armoracia n’est pas sauvage en Bretagne. C’est
constaté par les botanistes zélés qui explorent aujourd’hui la
France occidentale. M. l ’abbé Delalande en parle dans son opuscule
intitulé Hoedic et Houat où il rend compte d’une manière
si intéressante des usages et des productions de ces deux
petites îles de la Bretagne. Il cite l ’opinion de M. Le Gall, qui,
dans une Flore (non publiée) du Morbihan, déclare la plante
étrangère à la Bretagne. Cette preuve, du reste, est moins forte
que les antres, parce que le côté septentrional de la péninsule
bretonne n’est pas encore assez connu des botanistes, et que
l ’ancienne Armorique s ’étendait sur une portion de la Normandie
où maintenant on trouve quelquefois le Cochlearia sauvage
Ceci me conduit à parler de la patrie primitive de Pespèce.
Les botanistes anglais findiquent comme spontanée dans la
Grande-Bretagne, mais ils doutent de son origine. M. H.-G.
Watson ^ la regarde comme introduite. La difficulté, dit-il, de
l’extirper des endroits où on la cultive est bien connue des ja r diniers.
Il n’est donc pas étonnant que cette plante s ’empare
des terrains abandonnés et y persiste, au point de paraître
aborigène. M. Babington ® ne mentionne qu’une seule localité
où l’espèce ait véritablement fapparence d’être sauvage, savoir
Swansea, dans le pays de Galles. Tâchons de résoudre le problème
par d’autres arguments.
Le Cochlearia Armoracia est une plante de l ’Europe tempérée,
orientale principalement. Elle est répandue de la Finlande
à Astrakhan et au désert de Guman ®. Grisebach l’indique
aussi dans plusieurs localités de la Turquie d’Europe, par
exemple près d’Enos, où elle est abondante au bord de la
mer^.
Plus on avance vers l ’ouest de l ’Europe, moins les auteurs de
Flores paraissent certains de la qualité indigène, plus les localités
sont éparses et suspectes. L ’espèce est plus rare en Norwège
1. A. de Candolle, Géographie botanique raisonnée. p. 654.
2. Delalande, Eoedic et Houat, brochure in-8, Nantes, 1850, p. 109.
3. Hardouin, Renou et Ledere, Catal. du Calvados, p. 85; de Brebisson,
Fl. de Normandie, p. 25.
4. W'atson, Cybele, I, p. 159.
5. Babington, Manual o f Brit. bot., 2® éd., p. 28.
6. Ledebour, Fl. ross., I, p. 159.
7. Grisebach, Spicilegium Fl. rumel., I, p. 265.
■' ?
I.
Í?
I pi i 4
J
w
: H
ito iri l