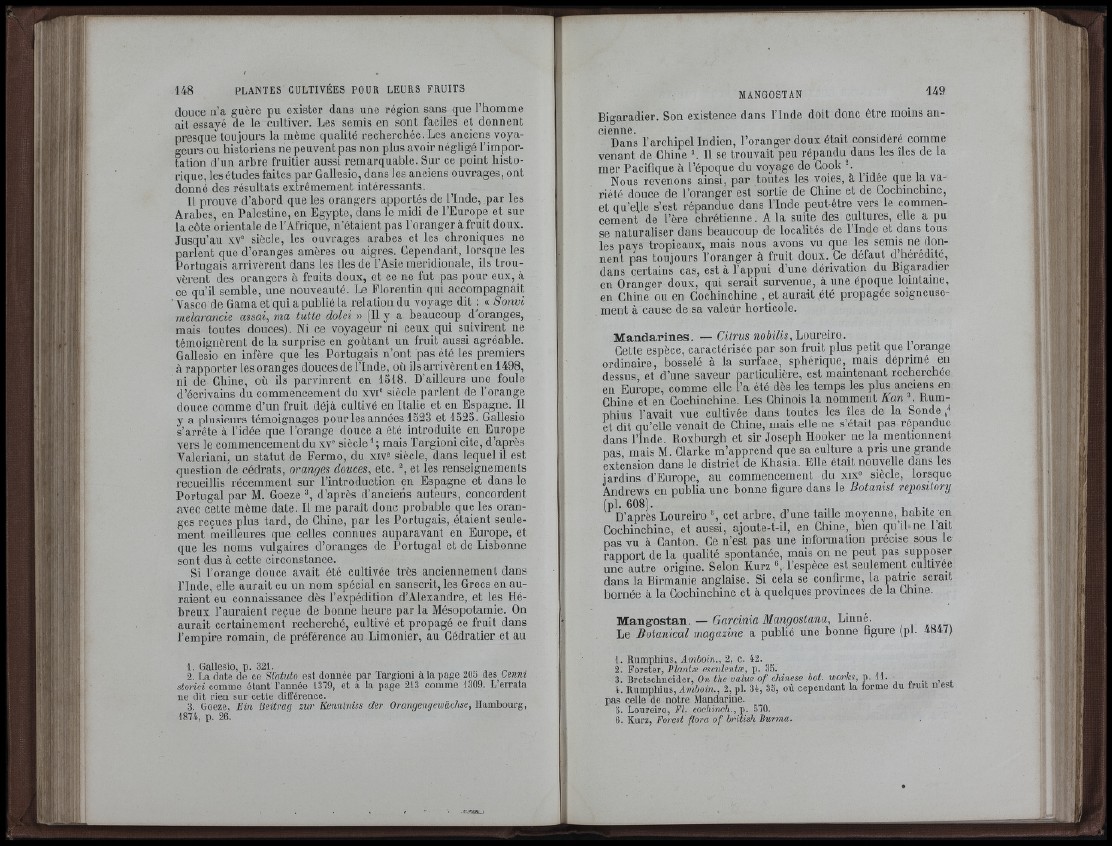
II
n * I
*
!ü!
f-m
douce n’a guère pu exister dans une région sans que Thomrne
ait essayé de le cultiver. Les semis en sont faciles et donnent
presque toujours la même qualité recherchée. Les anciens voyageurs
ou historiens ne peuvent pas non plus avoir négligé l’importation
d’un arbre fruitier aussi remarquable. Sur ce point historique,
les études faites par Gallesio, dans les anciens ouvrages, ont
donné des résultats extrêmement intéressants.
Il prouve d’abord que les orangers apportés de l ’Inde, par les
Arabes, en Palestine, en Egypte, dans le midi de l ’Europe et sur
la côte orientale de l’Afrique, n’étaient pas l’oranger à fruit doux.
Jusqu’au xv“ siècle, les ouvrages arabes et les chroniques ne
parlent que d’oranges amères ou aigres. Gependant, lorsque les
Portugais arrivèrent dans les îles de l’Asie méridionale, ils trouvèrent
des orangers à fruits doux, et ce ne fut pas pour eux, à
ce qu’il semble, une nouveauté. Le Florentin qui accompagnait
Vasco de Gama et qui a publié la relation du voyage dit : « Sonvi
melamncie assai, ma tutte dolci » (Il y a beaucoup d'oranges,
mais toutes douces). Ni ce voyageur ni ceux qui suivirent ne
témoignèrent de la surprise en goûtant un fruit aussi agréable.
Gallesio en infère que les Portugais n’ont pas été les premiers
à rapporter les oranges douces de l ’Inde, où ils arrivèrent en 1498,
ni de Chine, où ils parvinrent en 1518. D’ailleurs une foule
d’écrivains du commencement du xvi® siècle parlent de l’orange
douce comme d’un fruit déjà cultivé en Italie et en Espagne. Il
y a plusieurs témoignages pour les années 1523 et 1525. Gallesio
s’arrête à l’idée que l ’orange douce a été introduite en Europe
vers le commencement du xv “ siècle ‘ ; mais Targioni cite, d’après
Valeriani, un statut de Fermo, du xiv® siècle, dans lequel il est
question de cédrats, oranges douces, etc. fe et les renseignements
recueillis récemment sur l ’introduction en Espagne et dans le
Portugal par M. Goeze fe d’après d’anciens auteurs, concordent
avec cette même date. Il me paraît donc probable que les oranges
reçues plus tard, de Ghine, par les Portugais, étaient seulement
meilleures que celles connues auparavant en Europe, et
que les noms vulgaires d’oranges de Portugal et de Lisbonne
sont dus à cette circonstance.
Si l ’orange douce avait été cultivée très anciennement dans
rinde, elle aurait eu un nom spécial en sanscrit, les Grecs en auraient
eu connaissance dès l’expédition d’Alexandre, et les Hébreux
l’auraient reçue de bonne heure par la Mésopotamie. On
aurait certainement recherché, cultivé et propagé ce fruit dans
l ’empire romain, de préférence au Limonier, au Cédratier et au
1. Gallesio, p. 321.
2. La date de ce Statuto est donnée par Targioni à l a page 205 des Cenm
storici comnie étant l’année 1379, et à la page 213 comme 1309. L’errata
ne dit rien sur cette différence.
3. Goeze, Ein Beitrag zur Kenntniss der Orangengewachse, Hambour
O'
1874, p. 26.
MANGOSTAN 149
Bigaradier. Son existence dans l’Inde doit donc être moins ancienne.
, ,
Dans l ’archipel Indien, l ’oranger doux était considéré comme
venant de Chine fe H se trouvait peu répand/dans les îles de la
mer Pacifique à l ’époque du voyage de Gook fe
Nous revenons ainsi, par toutes les voies, à l’idée que la v ariété
douce de l ’oranger est sortie de Ghine et de Gochinchine,
et qu’elle s’est répandue dans flnde peut-être vers le commencement
de fè re chrétienne. A l a suite des cultures, elle a pu
se naturaliser dans beaucoup de localités de l’Inde et dans tous
les pays tropicaux, mais nous avons vu que les semis ne donnent
pas toujours Toranger à fruit doux. Ge défaut d’hérédité,
dans certains cas^ est à Tappui d’une dérivation du Bigaradier
en Oranger doux, qui serait survenue, à une époque lointaine,
en Chine ou en Gochinchine , et aurait été propagée soigneusement
à cause de sa valeur horticole.
Mandarines. — Citrus nobilis, honveiYo.
Cette espèce, caractérisée par son fruit plus petit que Torange
ordinaire, bosselé à la surface, sphérique, mais déprimé en
dessus, et d’une saveur particulière, est maintenant recherchée
en Europe, comme elle Ta été dès les temps les plus anciens en
Ghine et en Gochinchine. Les Ghinois la nomment Kan fe Rumphius
l ’avait vue cultivée dans toutes les îles de la Sonde f
et dit qu’elle venait de Ghine, mais elle ne s’était pas répandue
dans l ’Inde. Roxburgh et sir Joseph Hooker ne la mentionnent
pas mais M. Glarke m’apprend que sa culture a pris une grande
extension dans le district de Khasia. Elle était nouvelle dans les
jardins d’Europe, au commencement du xix® siècle, lorsque
Andrews en publia une bonne figure dans le Botanist repository
D’après Loureiro fe cet arbre, d’une taille moyenne, habite en
Gochinchine, et aussi, ajoute-t-il, en Chine, bien qu’il.ne l ’ait
pas vu à Canton. Ce n’est pas une information précise sous le
rapport de la qualité spontanée, mais on ne peut pas su p p o s /
une autre origine. Selon Kurz l ’espèce est seulement cultivée
dans la Birmanie anglaise. Si cela se confirme, la patrie serait
bornée à la Gochinchine et à quelques provinces de la Chine.
Mangostan. — Garcinia Mangostana, Linné.
Le Botanical magazine a publié une bonne figure (pl. 4847)
1. Rumpbius, Amboin., 2, c. 42.
2. Forster, Plantæ esculentæ, p. 35. _
3. Rretscbneider, On the value of chinese bot. works, p. 11.
4. Rumpbius, Amboin., 2, pl. 34, 35, où cependant la forme du fruit n est
pas celle de notre Mandarine.
5. Loureiro, Fl. cochinch., p. 570.
6. Kurz, Forest flora of british Burma.
.’f
l T
11- 1
i;
M
r