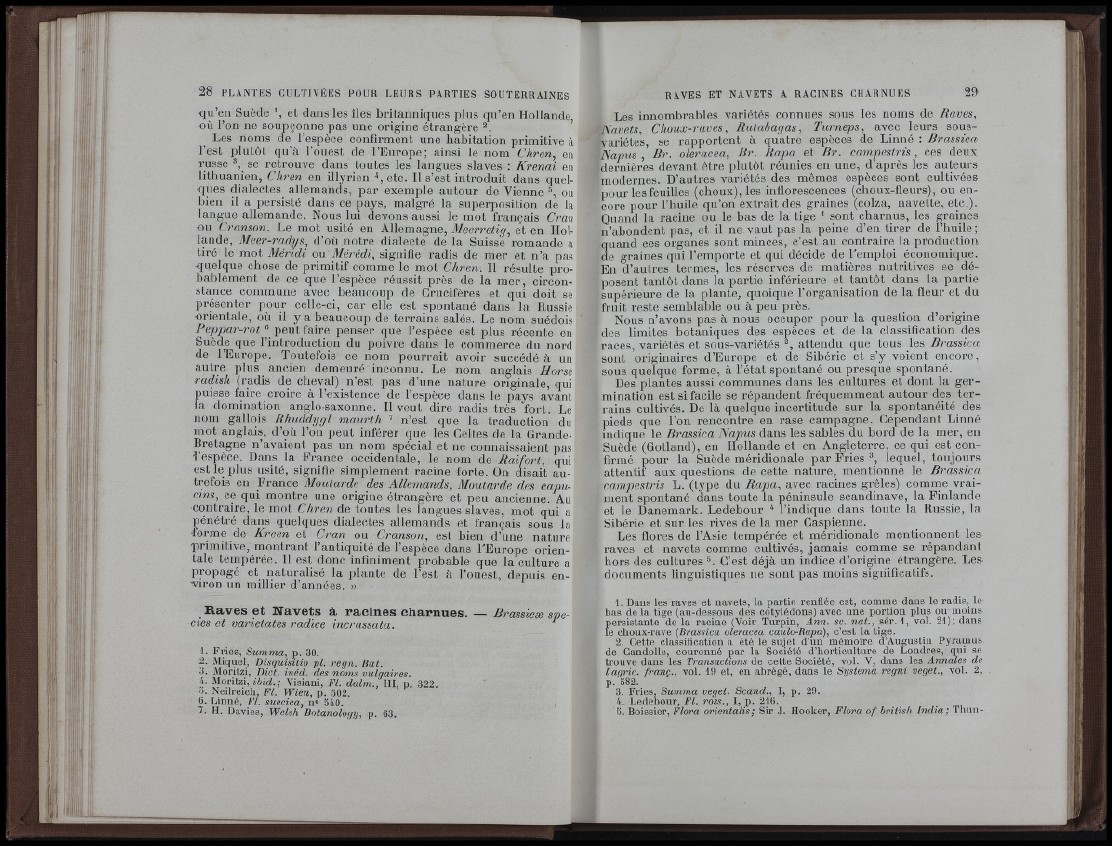
m
î ,!
I i
q u ’en Suède et dans les îles britanniques plus qu’en Hollande
•où l’on ne soupçonne pas nne origine étrangère ’
Les noms de l’espèce confirment une habitation primitive à
l ’est plutôt qu’à l’ouest de l ’Europe; ainsi le nom C h r e n , en
russe fe se retrouve dans toutes les langues slaves : K r e n a i en
lithuanien, C h r e n en illyrien fe etc. Il s’est introduit dans quelques
dialectes allemands, par exemple autour de Yienne ou
bien il a persisté dans ce pays, malgré la superposition de la
langue allemande. Nous lui devons aussi le mot français C r m
ou C r a n s o n . Le mot usité en Allemagne, M e e r r e t i g , et en Hollande,
M e e r - r a d y s , d’où notre dialecte de la Suisse romande a
tiré le mot M é r i d i ou M é r é d i , signifie radis de mer et n ’a pas
■quelque chose de primitif comme le mot C h r e n . Il résulte probablement
de ce que l ’espèce réussit près de la mer, circonstance
commune avec beaucoup de Crucifères et qui doit se
présenter pour celle-ci, car elle est spontané dans la Russie
orientale, où il y a beaucoup de terrains salés. Le nom suédois
P e p p a r - r o t '^yeuiÎBÎve penser que l’espèce est plus récente en
Suède^que l ’introduction du poivre dans le commerce du norc
de l ’Europe. Toutefois ce nom pourrait avoir succédé à un
autre plus ancien demeuré inconnu. Le nom anglais H o r s e
r a d i s h (radis de cheval) n’est pas d’une nature originale, qui
puisse faire croire à l ’existence de l’espèce dans le pays avant
la domination anglo-saxonne. Il veut dire radis très fort. Le
nom gallois R h u d d y g l m a u r t h ^ n’est que la traduction du
mot anglais, d ’où l ’on peut inférer que les Celtes de la Grande-
Bretagne n’avaient pas un nom spécial et ne connaissaient pas
Tespèce. Dans la France occidentale, le nom de R a i f o r t , qui
est le plus usité, signifie simplement racine forte. On disait autrefois
en France M o u t a r d e d e s A l l e m a n d s , M o u t a r d e d e s c a p u c
i n s , ce qui montre une origine étrangère et peu ancienne. Au
contraire, le mot C h r e n de toutes les langues slaves, mot qui a
pénétré dans quelques dialectes allemands et français sous la
forme de K r e e n et C r a n ou C r a n s o n , est bien d’une nature
primitive, montrant 1 antiquité de l’espèce dans FEurope orientale
tempérée. Il est donc infiniment probable que la culture a
propagé et naturalisé la plante de l’est à l’ouest, depuis environ
un millier d’années. »
R a v e s e t N a v e t s à r a c in e s c h a rn u e s . — B r a s s i c æ s p e -
c i e s e t v a r i e t a t e s r a d ï c e i n c r a s s a t a .
1. Fines, Summa, p. 3 0 .
2. Miquel, Disquisiiio pl. regn. Bat.
3. Moritzi, Dict. inéd. des noms vulgaires.
L Moritzi, ib id .; Visiaui, Fl. daim., 111, p. 322.
5 . Neilreich, Fl. Wien, p. 502.
6. Linné, Fl. suecica, n® 540.
7. H. Davies, Welsh Botanology, p. 63.
Les innombrables variétés connues sous les noms de R a v e s ,
N a v e t s , C h o u x - r a v e s , R u t a b a g a s , T u r n e p s , avec leurs sous-
variétes, se rapportent à quatre espèces de Linné : B r a s s i c a
N a p u s , B r . o l e r á c e a , B r . R a p a et B r . c a m p e s t r i s , ces deux
dernières devant être plutôt réunies en une, d’après les auteurs
modernes. D’autres variétés des mêmes espèces sont cultivées
pour les feuilles (choux): inflorescences (choux-fleurs), ou encore
pour l’huile qu’on extrait des graines (colza, navette, etc.).
Quand la racine ou le bas de la tige ‘ sont charnus, les graines
n ’abondent pas, et il ne vaut pas la peine d’en tirer de l ’huile;
quand ces organes sont minces, c’est au contraire la production,
de graines qui l’emporte et qui décide de l'emploi économique.
En d’autres termes, les réserves de matières nutritives se déposent
tantôt dans la partie inférieure et tantôt dans la partie
supérieure de la plante, quoique l’organisation de la fleur et du
fruit reste semblable ou à peu près.
Nous n’avons pas à nous occuper pour la question d’origine
des limites botaniques des espèces et de la classification des
races, variétés et sous-variétés fe attendu que tous les B r a s s i c a
sont originaires d’Europe et de Sibérie et s’y voient encore,
sous quelque forme, à l’état spontané ou presque spontané.
Des plantes aussi communes dans les cultures et dont la germination
est si facile se répandent fréquemment autour des te rrains
cultivés. De là quelque incertitude sur la spontanéité de&
pieds que l ’on rencontre en rase campagne. Gependant Linné
indique le B r a s s i c a N a p u s dans les sables du bord de la mer, en
Suède (Gotland), en Hollande et en Angleterre, ce qui e st/on -
firmé pour ia Suède méridionale par Fries lequel, toujours-
attentif aux questions de cette nature, mentionne le B r a s s i c a
c a m p e s t r i s L. (type du R a p a , avec racines grêles) comnie vraiment
spontané dans toute la péninsule Scandinave, la Finlande
et le Danemark. Ledebour ^ l’indique dans toute la Russie, la
Sibérie et sur les rives de la mer Caspienne.
Les flores de l’Asie tempérée et méridionale mentionnent les
raves et navets comme cultivés, jamais comme se répandant
hors des cultures fe C’est déjà un indice d’origine étrangère. Les-
documents linguistiques ne sont pas moins significatifs.
1. Dans les raves et navets, la partie renflée est, comme dans le radis, le
bas de la tige (au-dessous des cotylédons) avec une portion plus ou moins
persistante de la racine (Voir Turpin, Ann. sc. nat., _sér. 1, vol. 21); dans
le cboux-rave {Brassica olerácea caulo-Bapa), c’est la tige.
2. Cette classification a été le sujet d’un mémoire d’Augustin Pyramus
de Candolle, couronné par la Société d’horticulture de Londres, qui se
trouve dans les Transactions de cette Société, vol. V, dans les Annales de
Vagric. franç., vol. 19 et, en abrégé, dans le Systema regni veget., vol. 2,
p .'582.
3. Fries, Summa veget. Scand., I, p. 29.
4. Ledebour, F l. ross., I, p. 216.
5. Boissier, Flora orientalis; Sir J. Hooker, Flora o f britisli In d ia ; Tbunî
!
Ú