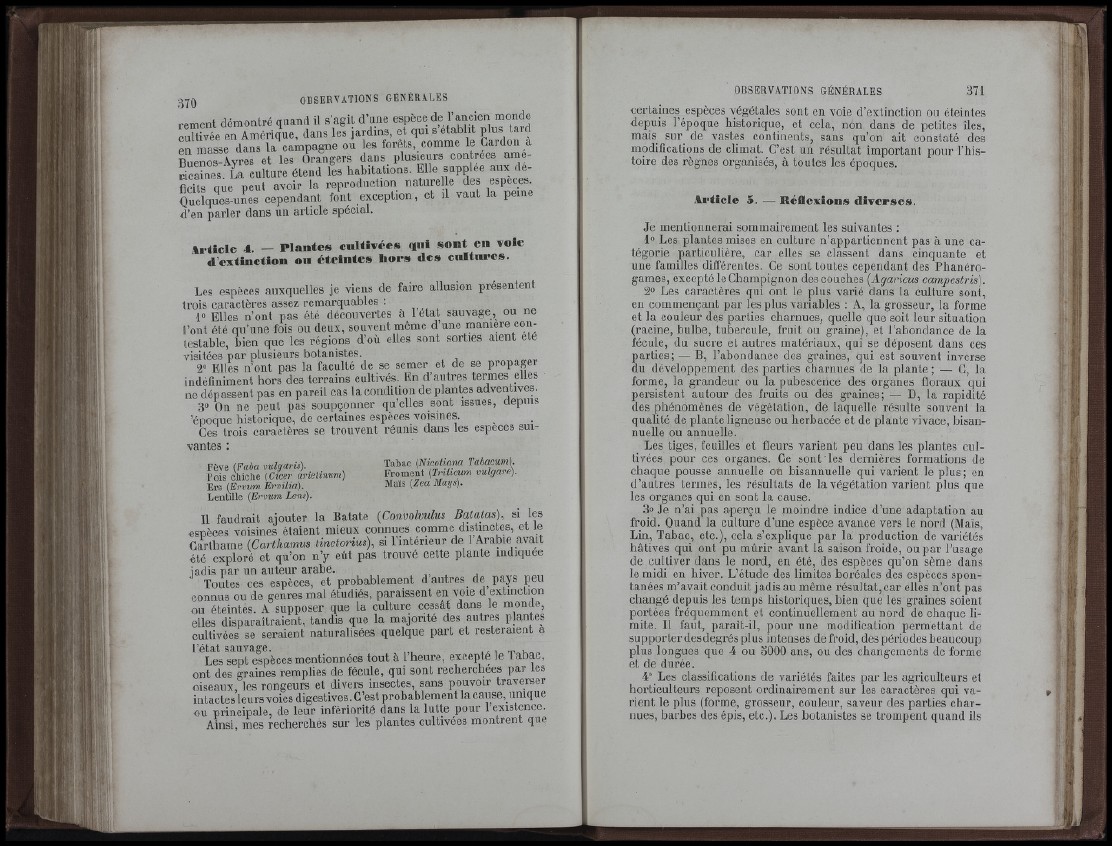
ill
remenl démontré quand il s'agit d ’une espèce de l ’ancien monde
cultivée en Amérique, dans les jardins, et qui s établit plus tai d
en masse dans la campagne ou les forets, comme le Gardon a
Buenos-Ayres et les Orangers dans plusieurs contrées anie-
rirabiës La culture étend les habitations. Elle supplée aux de-
fÎcUs que peut avoir la reproduction naturel e des especes.
Quelqëes-uLs cependant font exception, et il vaut la peine
d’en parler dans un article spécial.
A r t ic le 4. — P la n t e s c u l t iv é e s q u i s o n t c n v o ie
d ’e x t in c t io n o u é t e in t e s h o r s d e s c u l tu r e s .
Les espèces auxquelles je viens de faire allusion présentent
trois caractères assez remarquables
1® Elles n’ont pas été découvertes à 1 état sauvage, ou ne
l ’ont été qu’une fois ou deux, souvent même d’une manière contestable,
bien que les régions d’où elles sont sorties aient ete
visitées par plusieurs botanistes.
2® Elles n’ont pas la faculté de se semer et de se p r o p a / r
indéfiniment hors des terrains cultivés. En d’ autres termes elles
ne dépassent pas en pareil cas la condition de plantes adventive/
3® On ne peut pas soupçonner qu’elles sont issues, depuis
’époque historique, de certaines espèces voisine/
Ges trois caractères se trouvent réunis dans les especes suivantes
:
F ève {Faba vulgaris).
Pois chiche (Cicer arietinum)
Ers (Ervum Ervilia).
Lentille (Ervum Lens).
Tabac (Nicotiana Tabacum).
Froment (Triticum vulgare).
Maïs (Zea Mays).
Il faudrait ajouter la Batate {Convolvulus Batatas), si les
espèces voisines étaient mieux connues comme distinctes, et le
Carthame [Carthamus tinctorius), si l’intérieur de 1 Arabie avait
été exploré et qu’on n’y eût pas trouvé cette plante indiquée
iadis par un auteur arabe.
Toutes ces espèces, et probablement d autres de pays peu
connus ou de genres mal étudiés, paraissent en voie d extinction
ou éteintes. A supposer que la culture cessât dans le monde,
elles disparaîtraient, tandis que la majorité des autres plantes
cultivées se seraient naturalisées quelque part et resteraient a
l’état sauvage. • rr
Les sept espèces mentionnées tout à 1 heure, excepte le labac,
ont des graines remplies de fécule, qui sont recherchées par les
oiseaux, les rongeurs et divers insectes, sans pouvoir traverser
intactes leurs voies digestives. G’est probablement la cause, unique
ou principale, de leur infériorité dans la lutte pour 1 existence.
Ainsi, mes recherches sur les plantes cultivées montrent que
certaines espèces végétales sont en voie d’extinction ou éteintes
depuis l’époque historique, et cela, non dans de petites îles,
mais sur de vastes continents, sans qu’on ait constaté des
modifications de climat. G’est un résultat important pour l’histoire
des règnes organisés, à toutes les époques.
A r t i c l e 5 . — R c h e x i o n s d i x e r i s e s .
Je mentionnerai sommairement les suivantes :
1® Les plantes mises en culture n’appartiennent pas à une catégorie
particulière, car elles se classent dans cinquante et
une familles différentes. Ce sont toutes cependant des Phanérogames,
excepté le Champignon des couches [Agaricus campestris .
2° Les caractères qui ont le plus varié dans la culture sont,
en commençant par les plus variables : A, la grosseur, la forme
et la couleur des parties charnues, quelle que soit leur situation
(racine, bulbe, tubercule, fruit ou graine), et l ’abondance de la
fécule, du sucre et autres matériaux, qui se déposent dans ces
parties; — B, l ’abondance des graines, qui est souvent inverse
du développement des parties charnues de la plante ; — G, la
forme, la grandeur ou la pubescence des organes floraux qui
persistent autour des fruits ou des graines; — D, la rapidité
des phénomènes de végétation, de laquelle résulte souvent la
qualité de plante ligneuse ou herbacée et de plante vivace, bisannuelle
ou annuelle.
Les tiges, feuilles et fleurs varient peu dans les plantes cultivées
pour ces organes. Ce sont les dernières formations de
chaque pousse annuelle ou bisannuelle qui varient le plus; en
d ’autres termes, les résultats de la végétation varient plus que
les organes qui en sont la cause.
3° Je n’ai pas aperçu le moindre indice d’une adaptation au
froid. Quand la culture d’une espèce avance vers le nord (Maïs,
Lin, Tabac, etc.), cela s’explique par la production de variétés
hâtives qui ont pu mûrir avant la saison froide, ou par fusage
de cultiver dans le nord, en été, des espèces qu’on sème dans
le midi en hiver. L ’étude des limites boréales des espèces spontanées
m’avait conduit jadis au même résultat, car elles n ’ont pas
changé depuis les temps historiques, bien que les graines soient
portées fréquemment et continuellement au nord de chaque limite.
Il faut, paraît-il, pour une modification permettant de
supporter des degrés plus intenses de froid, des périodes beaucoup
plus longues que 4 ou oOOO ans, ou des changements de forme
et de durée.
4° Les classifications de variétés faites par les agriculteurs et
horticulteurs reposent ordinairement sur les caractères qui varient
le plus (forme, grosseur, couleur, saveur des parties charnues,
barbes des épis, etc.). Les botanistes se trompent quand ils
.i:'
H » ^
► ki
r é ,
Ui ■ »1
i
k y,
,, ".t.
J.'KJ
' fi
n '
^ 'i