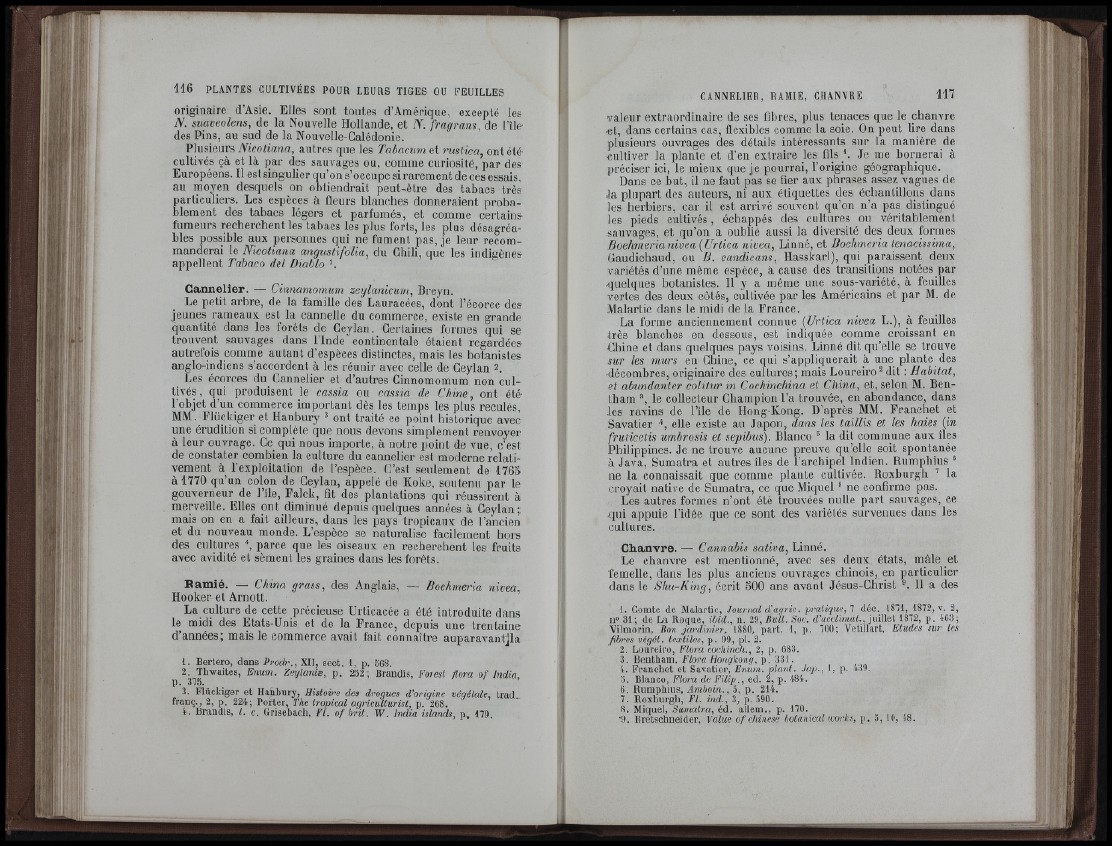
I ' i!i
iA-' if'i' '
: to
ti’ iito
fe
:i
originaire d’Asie. Elles sont toutes d’Amérique, excepté les
N. suaveolens, de la Nouvelle Hollande, et N. fragrans, de l ’île
des Pins, au sud de la Nouvelle-Calédonie.
Plusieurs Nicotiana, autres que les Tabacum et rustica, ont été
cultivés çà et là par des sauvages ou, comme curiosité, par des
Européens. Il estsingulier qu’on s’occupe si rarement de ces essais,
au moyen desquels on obtiendrait peut-être des tabacs très
particuliers. Les espèces à fleurs blanches donneraient probablement
des tabacs légers et parfumés, et comme certains-
fumeurs recherchent les tabacs les plus forts, les plus désagréables
possible aux personnes qui ne fument pas, je leur recommanderai
le Nicotiana angustifolia, du Chili, que les indigènes
appellent Tabaco del Diablo fe
Cannelier. — Cinnamomum zeylanicum, Breyn.
Le petit arbre, de la famille des Lauracées, dont l ’écorce des
jeunes rameaux est la cannelle du commerce, existe en grande
quantité dans les forêts de Geylan. Certaines formes qui se
trouvent sauvages dans l’Inde continentale étaient regardées
autrefois comme autant d’espèces distinctes, mais les botanistes
anglo-indiens s’accordent à les réunir avec celle de Geylan 2.
Les écorces du Cannelier et d’autres Ginnomomum non cult
iv é s , qui produisent le cassia ou cassia de Chine, ont été
l’objet d’un commerce important dès les temps les plus reculés,
MM. Flückiger et Hanbury ® ont traité ce point historique avec
une érudition si complète que nous devons simplement renvoyer
à leur ouvrage. Ce qui nous importe, à notre point de vue, c’est
de constater combien la culture du cannelier est moderne relativement
à l ’exploitation de l’espèce. G’est seulement de 1765>
à 1770 qu’un colon de Geylan, appelé de Koke, soutenu par le
gouverneur de l ’île, Falck, fit des plantations qui réussirent à
merveille. Elles ont diminué depuis quelques années à Geylan;;
mais on en a fait ailleurs, dans les pays tropicaux de l ’ancien
et du nouveau monde. L ’espèce se naturalise facilement hors
des cultures fe parce que les oiseaux en recherchent les fruits
avec avidité et sèment les graines dans les forêts.
B am ié . — China grass, des Anglais, — Bochmcria nivca,
Hooker et Arnott.
La culture de cette précieuse Urticacée a été introduite dans
le midi des Etats-Unis et de la France, depuis une trentaine
d’années ; mais le commerce avait fait connaître auparavantjla
1. Bertero, dans Prodr., XII, sect, l, p. 568.
2. Thwaites, Enum. Zeylaniæ, p . 252; Brandis, Forest flora of India,
p. 375.
3 . Flückiger et Haühury, Histome des drogues d’origine végétale, trad,.
franç., 2, p. 224; Porter, The tropical agriculturist, p. 268.
4. Brandis, l. c. Grisebach, Fl. of brit. W. India islands, p , 179.
valeur extraordinaire de ses fibres, plus tenaces que le chanvre
et, dans certains cas, flexibles comme la soie. On peut lire dans
plusieurs ouvrages des détails intéressants sur la manière de
niiltiver la plante et d’en extraire les fils fe Je me bornerai à
préciser ici, le mieux que je pourrai, l ’origine géographique.
Dans ce but, il ne faut pas se fier aux phrases assez vagues de
la plupart des auteurs, ni aux étiquettes des échantillons dans
les herbiers, car il est arrivé souvent qu’on n’a pas distingué
les pieds cultivés, échappés des cultures ou véritablement
sauvages, et qu’on a oublié aussi la diversité des deux formes
Bochmcria nivca [Urtica nivea, Linné, et Bochmcria tenacissima,
Gaudichaud, ou B. candicans, Hasskarl), qui paraissent deux
variétés d’une même espèce, à cause des transitions notées par
quelques botanistes. H y a même une sous-vpiété, à feuilles
vertes des deux côtés, cultivée par les Américains et par M. de
Malartic dans le midi de la France.
La forme anciennement connue {Urtica nivea L.), à feuilles
très blanches en dessous, est indiquée comme croissant en
Ghine et dans quelques pays voisins. Linné dit qu’elle se trouve
sur les murs en Chine, ce qui s’appliquerait à une plante des
décombres, originaire des cultures; mais Loureiro^ dit : Habitat,
et abundanter colitur in Cochinchina et China, et, selon M. Bentham
fe le collecteur Champion l ’a trouvée, en abondance, dans
les ravins de l ’île de Hong-Kong. D’après MM. Franchet et
Savatier fe elle existe au Japon, dans les taillis et les haies {in
fruticetis umbrosis et sepibus). Blanco ® la dit commune aux îles
Philippines. Je ne trouve aucune preuve qu’elle soit spontanée
à Java, Sumatra et autres îles de l’archipel Indien. Bumphius ®
ne la connaissait que comme plante cultivée. Boxburgh la
croyait native de Sumatra, ce que Miquel ® ne confirme pas.
Les autres formes n’ont été trouvées nulle part sauvages, ce
qui appuie fidée que ce sont des variétés survenues dans les
cultures.
C h a n v r e . — Cannabis sativa, Linné.
Le chanvre est mentionné, avec ses deux, états, mâle et
femelle, dans les plus anciens ouvrages chinois, en particulier
dans le Shu -K ing, écrit 500 ans avant Jésus-Ghrist H a des
1. Comte de Malartic, Journal d'agric. prcdique, 7 déc. 1871, 1872, v. 2,
u» 31; de La Roque, ibid., n. 29, Bull. Soc. d’acciimcd., juillet 1872, p. 463;
Vilmorin, Bon jardinier, 1880, part. 1, p. 700; Vetillart, Etudes sur les
fibres végét. textiles, p. 99, pl. 2.
2. Loureiro, Flora cochinch., 2, p. 683.
3. Bentham, Flora Hongkong, p. 331.
4., Fr rraannccüheett eett Sbaavvaattiieerr), tE,nnùumm.. ppliaanntt.. JJac p., 1, p. 439.
. Blanco, Flora de Füip., ed. 2, p. 484.
6. Rumphius, Amboin., 5, p. 214.
7. Roxburgh, Fl. ind., 3, p. 590.
8. Miquel, Sumatra, éd. a llem., p. 170.
‘9. Bretschneider, Value of Chinese botanical -works, p. 5, 10, 18.