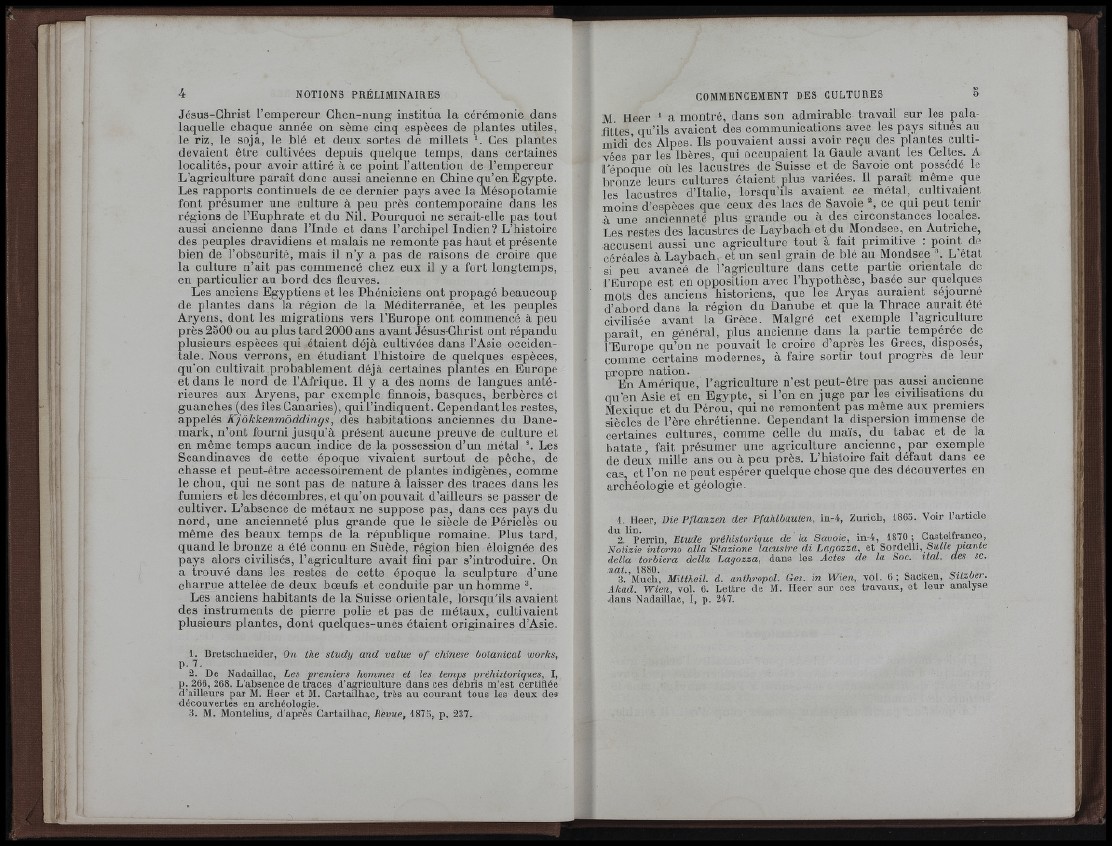
ij I !' ' :
Jésus-Ghrist l’empereur Ghen-nung institua la cérémonie dans
laquelle chaque année on sème cinq espèces de plantes utiles,
le riz, le soja, le blé et deux sortes de millets K Ges plantes
devaient être cultivées depuis quelque temps, dans certaines
localités, pour avoir attiré à ce point l ’attention de l ’empereur
L ’agriculture paraît donc aussi ancienne en Ghine qu’en Egypte.
Les rapports continuels de ce dernier pays avec la Mésopotamie
font présumer une culture à peu près contemporaine dans les
régions de FEuphrate et du Nil. Pourquoi ne serait-elle pas tout
aussi ancienne dans l’Inde et dans l’archipel Indien? L ’histoire
des peuples dravidiens et malais ne remonte pas haut et présente
bien de l ’obscurité, mais il n ’y a pas de raisons de croire que
la culture n’ait pas commencé chez eux il y a fort longtemps,
en particulier au bord des fleuves.
Les anciens Egyptiens et les Phéniciens ont propagé beaucoup
de plantes dans la région de la Méditerranée, et les peuples
Aryens, dont les migrations vers l ’Europe ont commencé à peu
près 2500 ou au plus tard 2000 ans avant Jésus-Ghrist ont répandu
plusieurs espèces qui étaient déjà cultivées dans l’Asie occidentale.
Nous verrons, en étudiant l’histoire de quelques espèces,
qu’on cultivait probablement déjà certaines plantes en Europe
et dans le nord de l’Afrique. Il y a des noms de langues antérieures
aux Aryens, par exemple finnois, basques, berbères et
guanches (des îles Ganaries), qui l ’indiquent. Gependant les restes«,
appelés Kjôkkenmôddings, des habitations anciennes du Danemark,
n’ont fourni jusqu’à présent aucune preuve de culture et
en même temps aucun indice de la possession d’un métal Les
Scandinaves de cette époque vivaient surtout de pêche, de
chasse et peut-être accessoirement de plantes indigènes, comme
le chou, qui ne sont pas de nature à laisser des traces dans les
fumiers et les décombres, et qu’on pouvait d ’ailleurs se passer de
cultiver. L ’absence de métaux ne suppose pas, dans ces pays du
nord, une ancienneté plus grande que le siècle de Périclès ou
même des beaux temps de la république romaine. Plus tard,
quand le bronze a été connu en Suède, région bien éloignée des
pays alors civilisés, l ’agriculture avait fini par s’introduire. On
a trouvé dans les restes de cette époque la sculpture d’une
charrue attelée de deux boeufs et conduite par un homme fe
Les anciens habitants de la Suisse orientale, lorsqu’ils avaient
des instruments de pierre polie et pas de métaux, cultivaient
plusieurs plantes, dont quelques-unes étaient originaires d’Asie.
M. Heer ^ a montré, dans son admirable travail sur les pala-
fittes, qu’ils avaient des communications avec les pays situés au
midi’des Alpes. Ils pouvaient aussi avoir reçu des plantes cultivées
par les Ibères, qui occupaient la Gaule avant les Geltes. A
l'époque où les lacustres de Suisse et de Savoie ont possédé le
bronze leurs cultures étaient plus variées. Il paraît même que
les lacustres d’Italie, lorsqu’ils avaient ce métal, cultivaient
moins d’espèces que ceux des lacs de Savoie fe ce qui peut tenir
à une ancienneté plus grande ou à des circonstances locales.
Les restes des lacustres de Laybach et du Mondsee, en Autriche,
accusent aussi une agriculture tout à fait primitive : point de
céréales à Laybach, et un seul grain de blé au Mondsee ^ L ’état
si peu avancé de l ’agriculture dans cette partie orientale de
l’Europe est en opposition avec l’hypothèse, basée sur quelques
mots des anciens historiens, que les Aryas auraient séjourné
d’abord dans la région du Danube et que la Thrace aurait été
civilisée avant la Grèce. Malgré cet exemple l ’agriculture
paraît, en général, plus ancienne dans la partie tempérée de
l’Europe qu’on ne pouvait le croire d’après les Grecs, disposés,
comme certains modernes, à faire sortir tout progrès de leur
propre nation.
En Amérique, l’agriculture n’est peut-être pas aussi ancienne
qu’en Asie et en Egypte, si l ’on en juge par les civilisations du
Mexique et du Pérou, qui ne remontent pas même aux premiers
siècles de l’ère chrétienne. Gependant la dispersion immense de
certaines cultures, comme celle du maïs, du tabac et de la
batate, fait présumer une agriculture ancienne, par exemple
de deux mille ans ou à peu près. L ’histoire fait défaut dans ce
cas, et l ’on ne peut espérer quelque chose que des découvertes en
archéologie et géologie.
1. Heer, Die Pflanzen der Pfahlbauten, in-4, Zurich, 1863. Voir l’article
2. Perriu, Etude préhistorique de la Savoie, in-4, 1 8 70 ; _ Castelfranco,
Notizie intorno alla Stazione Lacustre di Lagozza, et SordeWi, Sulle piante
délia torbiera délia Lagozza, dans les Actes de la Soc. itat. des sc.
nat., 1880. . , r. , ov
3. Much, Mittheil. d. anthropol. Ges. in Wien, vol. 6 ; Sacken, Sitzoei.
Akad. Wien, vol. 6. Lettre de M. Heer sur ces travaux, et leur analyse
-dans Nadaillac, I, p. 247.
I
1. Bretschneider, On the study and value o f chínese botanical works,
p. 7.
2. De Nadaillac, Les premiers hommes et les temps préhistoriques, I,
p. 266, 268. L’absence de traces d’agriculture dans ces débris m’est certifiée
d’ailleurs par M. Heer et M. Cartailhac, très au courant tous les deux des
découvertes en archéologie.
3. M. Montelius, d’après Cartailhac, Revue, 1875, p. 237.