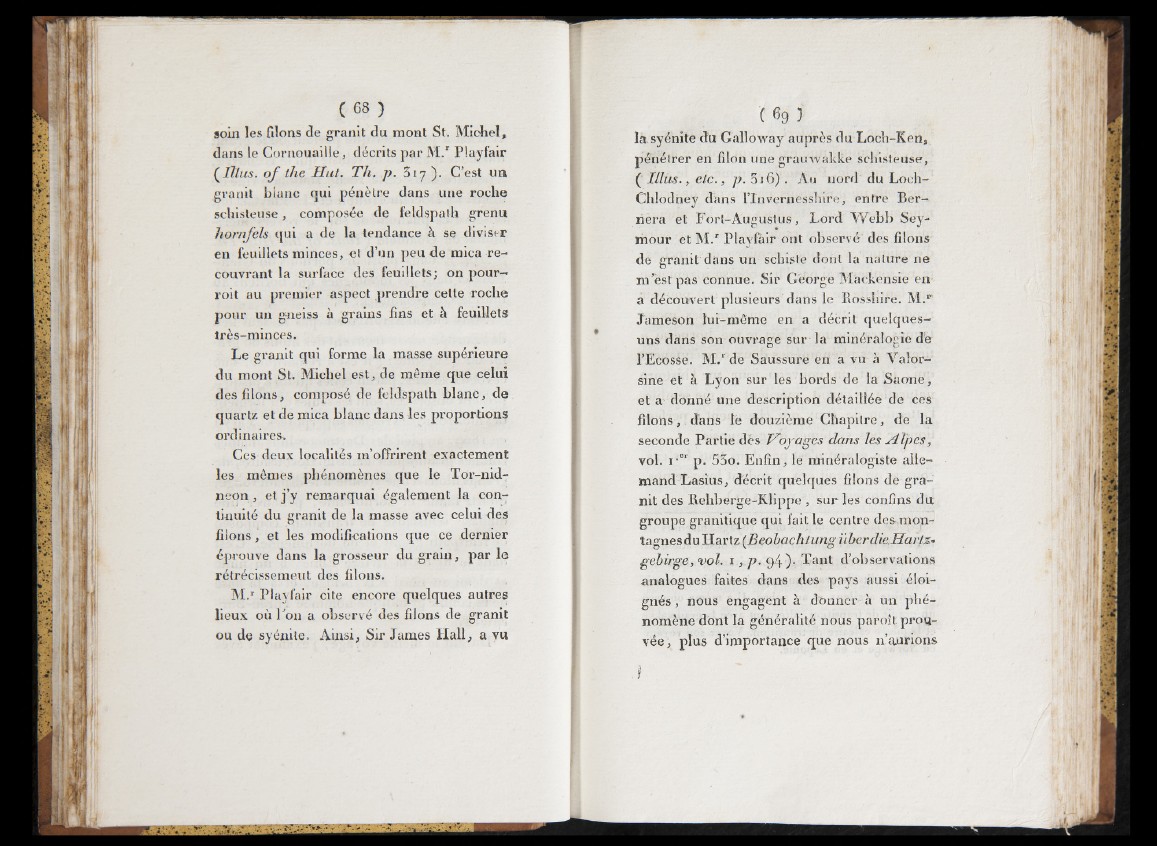
soin les filons de granit du mont St. Michel,
dans le Cornouaille, décrits par M.r Playfair
(lllu s . o f the Hat. Th. p. 317 ). C’est un
granit blanc qui pénètre dans une roche
schisteuse, composée de feldspath grenu
hornfels qui a de la tendance à se diviser
en feuillets minces, et d’un peu de mica recouvrant
la surface des feuillets; on pour-
roi t au premier aspect prendre cette roche
pour un gneiss à grains fins et à feuillets
très-minces.
Le granit qui forme la masse supérieure
du mont St. Michel est, de même que celui
des filons, composé de feldspath blanc, de
quartz et de mica blanc dans les proportions
ordinaires.
Ces deux localités m’offrirent exactement
les mêmes phénomènes que le Tor-nid-
neon , et j ’y remarquai également la cony
ti-nuité du granit de la masse avec celui des
filons, et les modifications que ce dernier
éprouve dans la grosseur du graiu, par le
rétrécissemeut des filons.
M.r Playfair cite encore quelques autres
lieux où l ’on a observé des filons de granit
ou de syénite. Ainsi, Sir James Hall, a yu
la. syénite du Galloway auprès du Loch-Ken,
pénétrer en filon une grauwakke schisteuse,
( I l lu s e t c . , p. 5i 6) . Au nord' du Loeh-
Chlodney dans l’Invernesshire, entre Bernera
et Fort-Augustus, Lord Webb Sey-
mour et M.r Playfair ont observé des filons
de granit dans un schiste dont la nature ne
m’est pas connue. Sir George Màckensie en
a découvert plusieurs dans le Rosshire. M.*1
Jameson lui-même en a décrit quelques-
uns dans son ouvrage sur la minéralogie de
l’Ecosse. M.r de Saussure en a vu à Valor-
sine et à Lyon sur les bords de la Saône,
et a donné une description détaillée de ces
filons, dans le douzième Chapitre, de la
seconde Partie dés Voyages dans les H lpes,
vol. i ,Br p. 55o. Enfin, le minéralogiste allemand
Lasius, décrit quelques filons de granit
des Rehberge-Klippe , sur les confins du
groupe granitique qui fait le centre des rnon-
tagnes du Hartz (JBeobachtung il berdielïarfz-
gebirge, vol. 1 , p. 94 ). Tant d’observations
analogues faites dans des pays aussi éloignés
, nous engagent à donner à un phénomène
dont la généralité nous paroit prouvée,
plus d’importance que nous n’aurions