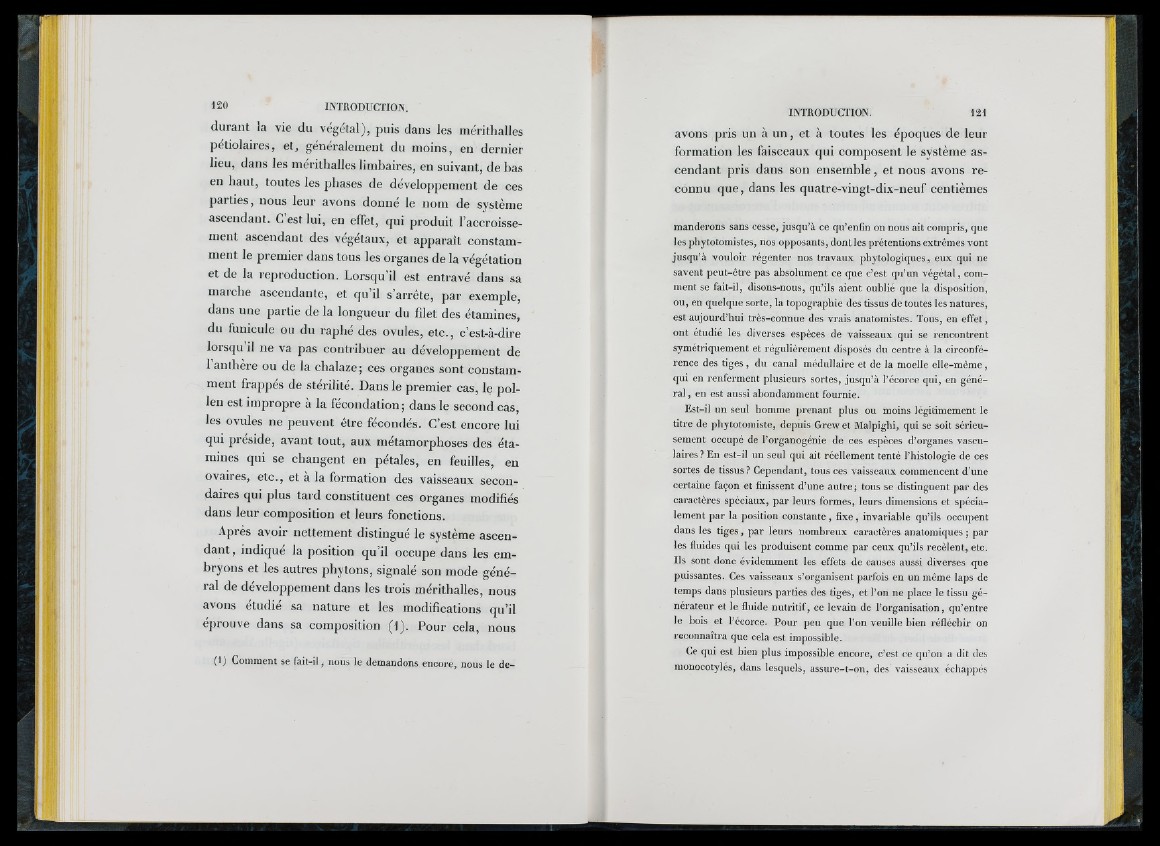
Ü, '
; I
durant la vie du végétal), puis dans les méritlialles
pétiolaires, et, généralement du moins, en dernier
lieu, dans les méritlialles limbaires, en suivant, de bas
en haut, toutes les phases de développement de ces
parties, nous leur avons donné le nom de système
ascendant. C’est lui, en effet, qui produit l’accroissement
ascendant des végétaux, et apparaît constamment
le premier dans tous les organes de la végétation
et de la reproduction. Lorsqu’il est entravé dans sa
marche ascendante, et qu’il s’arrête, par exemple,
dans une partie de la longueur du filet des étamines,
du funicule ou du raplié des ovules, etc., c’est-à-dire
lorsqu il ne va pas contribuer au développement de
1 anthère ou de la cbalaze; ces organes sont constamment
frappés de stérilité. Dans le premier cas, le pollen
est impropre à la fécondation; dans le second cas,
les ovules ne peuvent être fécondés. C’est encore lui
qui préside, avant tout, aux métamorphoses des étamines
qui se changent en pétales, en feuilles, en
ovaires, etc., et a la formation des vaisseaux secondaires
qui plus tard constituent ces organes modifiés
dans leur composition et leurs fonctions.
-Après avoir nettement distingué le système ascendant
, indiqué la position qu’il occupe dans les embryons
et les autres phytons, signalé son mode général
de développement dans les trois méritballes, nous
avons étudié sa nature et les modifications qu’il
éprouve dans sa composition (1). Pour cela, nous
(1) Comment se l'ait-il, nous le demandons encore, nous le deavons
pris un à u n , et à toutes les époques de leur
formation les faisceaux qui composent le système ascendant
pris dans son ensemble, et nous avons reconnu
que, dans les quatre-vingt-dix-neuf centièmes
manderons sans cesse, jusqu’à ce qu’enfin on nous ait compris, que
les phytotomistes, nos opposants, dont les prétentions extrêmes vont
jusqu’à vouloir régenter nos travaux phytologiques, eux qui ne
savent peut-être pas absolument ce que c’est qu’un végétal, comment
se fait-il, disons-nous, qu’ils aient oublié que la disposition,
ou, en quelque sorte, la topographie des tissus de toutes les natures,
est aujourd’hui très-connue des vrais anatomistes. Tous, en e ffe t,
ont étudié les diverses espèces de vaisseaux qui se rencontrent
symétriquement et régulièrement disposés du centre à la circonférence
des tiges , du canal médullaire et de la moelle e lle-même,
qui en renferment plusieurs sortes, jusqu’à l’ccorce qui, en général
, en est aussi abondamment fournie.
Est-il un seul homme prenant plus ou moins légitimement le
titre de phytotomiste, depuis Grew et Malpighi, qui se soit sérieusement
occupé de l’organogénie de ces espèces d’organes vasculaires
? En est-il un seul qui ait réellement tenté l’histologie de ces
sortes de tissus ? Cependant, tous ces vaisseaux commencent d ’une
certaine façon et finissent d ’une au tre ; tous se distinguent par des
caractères spéciaux, par leurs formes, leurs dimensions et spécialement
par la position constante , fix e , invariable qu’ils occupent
dans les tiges , par leurs nombreux caractères anatomiques ; par
les fluides qui les produisent comme par ceux qu’ils recèlent, etc.
Ils sont donc évidemment les effets de causes aussi diverses que
puissantes. Ces vaisseaux s’organisent parfois en un même laps de
temps dans plusieurs parties des tiges, et l’on ne place le tissu générateur
et le fluide n u tritif, ce levain de l’organisation, qu’entre
le hois et l’écoree. Pour peu que l’on veuille bien réfléchir on
reconnaîtra que cela est impossible.
Ce qui est bien plus impossible encore, c’est ce qu’on a dit des
monocotylés, dans lesquels, assure-t-on, des vaisseaux écliajipés