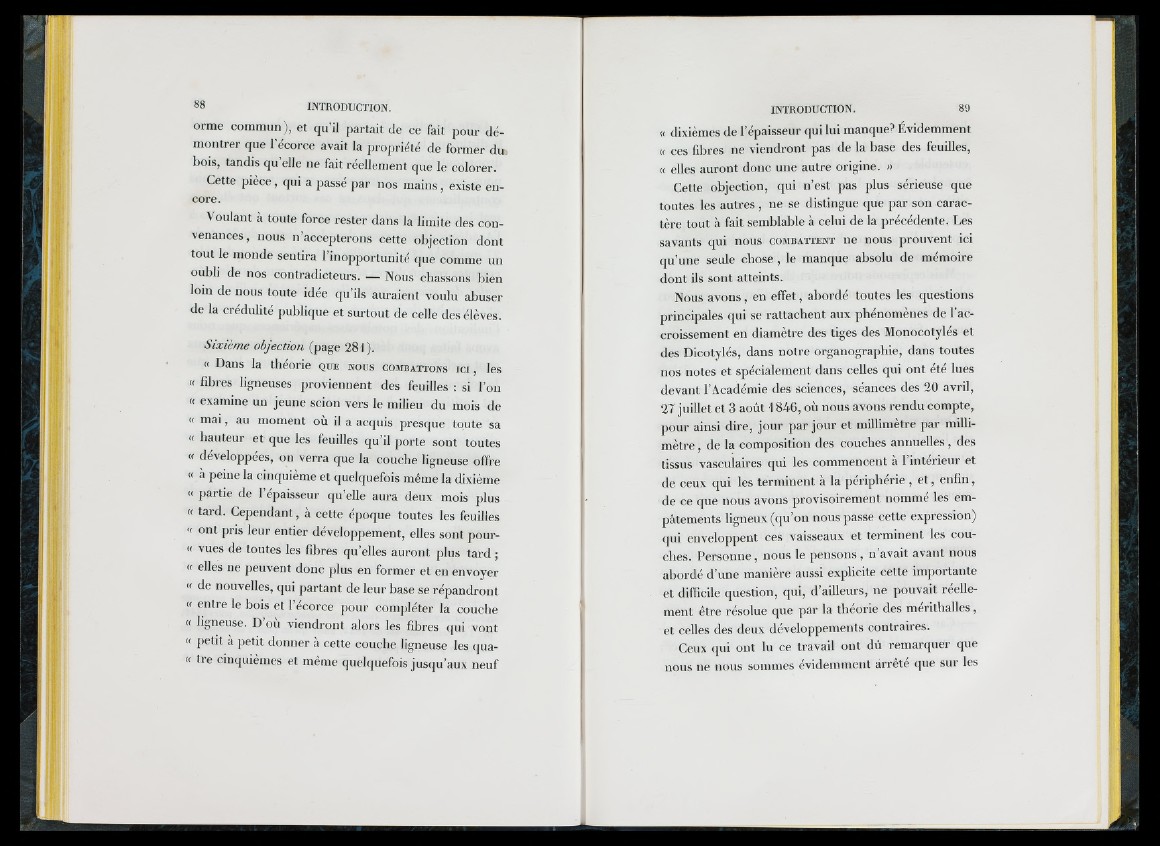
orme commun), et qu’il partait de ce fait pour démontrer
que l’écorce avait la jiropriété de former du
bois, tandis qu’elle ne fait réellement que le colorer.
Cette pièce, qui a passé par nos mains, existe eu-
core.
’Voulant à toute force rester dans la limite des convenances,
nous n ’accepterons cette objection dont
tout le monde sentira l’inopportunité que comme un
oubli de nos contradicteurs. — Nous chassons bien
loin de nous toute idée qu’ils auraient voulu abuser
de la crédulité publique et surtout de celle des élèves.
Sixième objection (page 281).
« Dans la théorie q u e n o u s c om b a t t o n s i c i , les
(( fibres ligneuses proviennent des feuilles : si l’on
« examine uu jeune scion vers le milieu du mois de
(( m a i, au moment où il a acquis presque toute sa
i< bauteur e t que les feuilles qu’il porte sont toutes
« développées, on verra que la couche ligneuse offre
« à peine la cinquième et quelquefois même la dixième
« partie de l’épaisseur qu’elle aura deux mois plus
<c tard. Cependant, à cette époque toutes les feuilles
'( ont pris leur entier développement, elles sont pour-
« vues de toutes les fibres qu’elles auront plus tard ;
« elles ne peuvent donc plus en former et en envoyer
« de nouvelles, qui partant de leur base se répandront
(( entre ie bois et l’écorce pour compléter la couche
« ligneuse. D ou viendront alors les fibres qui vont
« petit à petit donner à cette couche ligneuse les ijua-
(( tre cinquièmes et même quelquefois jusqu’aux neuf
« dixièmes de l’épaisseur qui lui manque;» Évidemment
« ces fibres ne viendront pas de la base des feuilles,
(( elles auront donc une autre origine. «
Cette objection, qui n ’est pas plus sérieuse que
toutes les autres , ne se distingue que par son caractère
tout à fait semblable à celui de la précédente. Les
savants qui nous c o m b a t t e n t ne nous prouvent ici
qu’une seule chose , le manque absolu de mémoire
dont ils sont atteints.
Nous avons, en effet, abordé toutes les questions
principales qui se rattachent aux phénomènes de l’accroissement
en diamètre des tiges des Monocotylés et
des Dicotylés, dans notre organograpbie, dans tontes
nos notes et spécialement dans celles qui ont été lues
devant l’Académie des sciences, séances des 20 avril,
27 juillet et 3 août 1846, oû nous avons rendu compte,
pour ainsi dire, jour par jour et millimètre par millimètre
, de la composition des couches annuelles, des
tissus vasculaires qui les commencent à l’intérieur et
de ceux qui les terminent à la périphérie , e t , enfin,
de ce que nous avons provisoirement nommé les empâtements
ligneux (qu’on nous passe cette expression)
qui enveloppent ces vaisseaux et terminent les couches.
Personne , nous le pensons , n ’avait avant nous
abordé d’une manière aussi explicite cette importante
et difficile question, qui, d’ailleurs, ne pouvait réellement
être résolue que par la théorie des méritballes,
et celles des deux développements contraires.
Ceux qui ont lu ce travail ont dû remarquer que
nous ne nous sommes évidemment arrêté que sur les