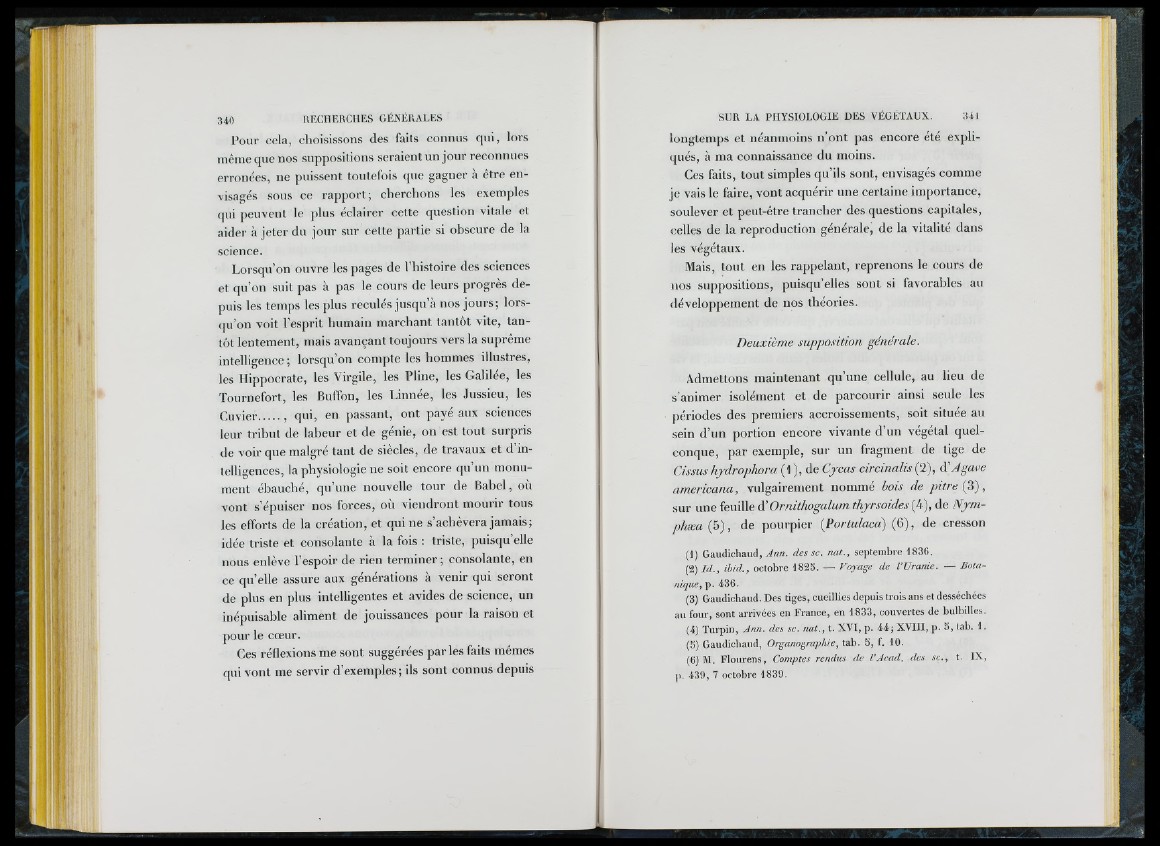
1 t j
Pour cela, choisissons des faits connus qni, lors
même que nos suppositions seraient un jour reconnues
erronées, ne puissent toutefois que gagner à être envisagés
sous ce rapport; cherchons les exemples
(pii peuvent le plus éclairer celte question vitale el
aider à jeter du jour sur celte partie si obscure de la
science.
Lorsqu’on ouvre les pages de l’histoire des sciences
et qu’on suit pas à pas le cours de leurs progrès depuis
les temps les plus reculés jusqu’à nos jours; lors-
(pi’on voit l’esprit humain marchant tantôt vite, tantôt
lentement, mais avançant toujours vers la suprême
intelligence ; lorsqu’on compte les hommes illustres,
les Hippocrate, les Virgile, les Pline, les Galilée, les
Tonrnefort, les Bnffon, les Linnée, les Jussieu, les
Cuvier , qui, en passant, ont payé aux sciences
leur tribut de labeur et de génie, on est tout surpris
de voir que malgré tant de siècles, de travaux et d intelligences,
la physiologie ne soit encore qu’un monument
ébauché, qu’une nouvelle tour de Babel, où
vont s’épuiser nos forces, on viendront mourir tous
les efforts de la création, et qui ne s’achèvera jamais;
idée triste et consolante à la fois : triste, puisqu’elle
nous enlève l’espoir de rien terminer ; consolante, en
ce qu’elle assure aux générations à venir qui seront
de plus en plus intelligentes et avides de science, un
inépuisable aliment de jouissances pour la raison et
pour le coeur.
Ces réflexions me sont suggérées parles faits mêmes
qui vont me servir d ’exemples; ils sont connus depuis
SUR LA PliySIOLOGlE DES VÉGÉTAUX. 311
longtemps et néanmoins n’ont pas encore été expli-
(jués, à ma connaissance du moins.
Ces faits, tout simples qu’ils sont, envisagés comme
je vais le faire, vont acquérir une certaine importance,
soulever et peut-être trancher des questions capitales,
celles de la reproduction générale, de la vitalité dans
les végétaux.
Mais, tout eu les rappelant, reprenons le cours de
nos suppositions, puisqu’elles sont si favorables au
développement de nos théories.
Deuxième supposition générale.
Admettons maintenant qu’une cellule, au lieu de
s’animer isolément et de parcourir ainsi seule les
périodes des premiers accroissements, soit située au
sein d’un portion encore vivante d ’un végétal quelconque,
par exemple, sur un fragment de tige de
Cissus hydrophora (1 ), de Cycas circinalis (2), N A gave
nmericana, vulgairement nommé bois de pitre (2,),
sur une feuille A’Ornitkogalum thyrsoides{k), de Njni-
phæa (5), de pourpier {Portulaca) (6), de cresson
(t) Gaudichaud, des sc. nat., septembre 1836.
(2) Id ., ihid., octobre 1823. — Voyage de Vüranie. — Botanique,
p. 436.
(3) Gaudichaud. Des tiges, cueiiiies depuis trois ans et dessécliées
au four, sont arrivées en France, en 1833, couvertes de buibiiles.
(4) Tnrpin, Ann. des sc. nat., t. XVI, p. 44 ; XVIII, p. 3, tah. I .
(5) Gaudicliaud, Organographie, tab. 3, f. 10.
(6) M. Flourens, Comptes rendus de l ’J ca d . des sc., t. IX,
)i. 430, 7 octobre 1839.