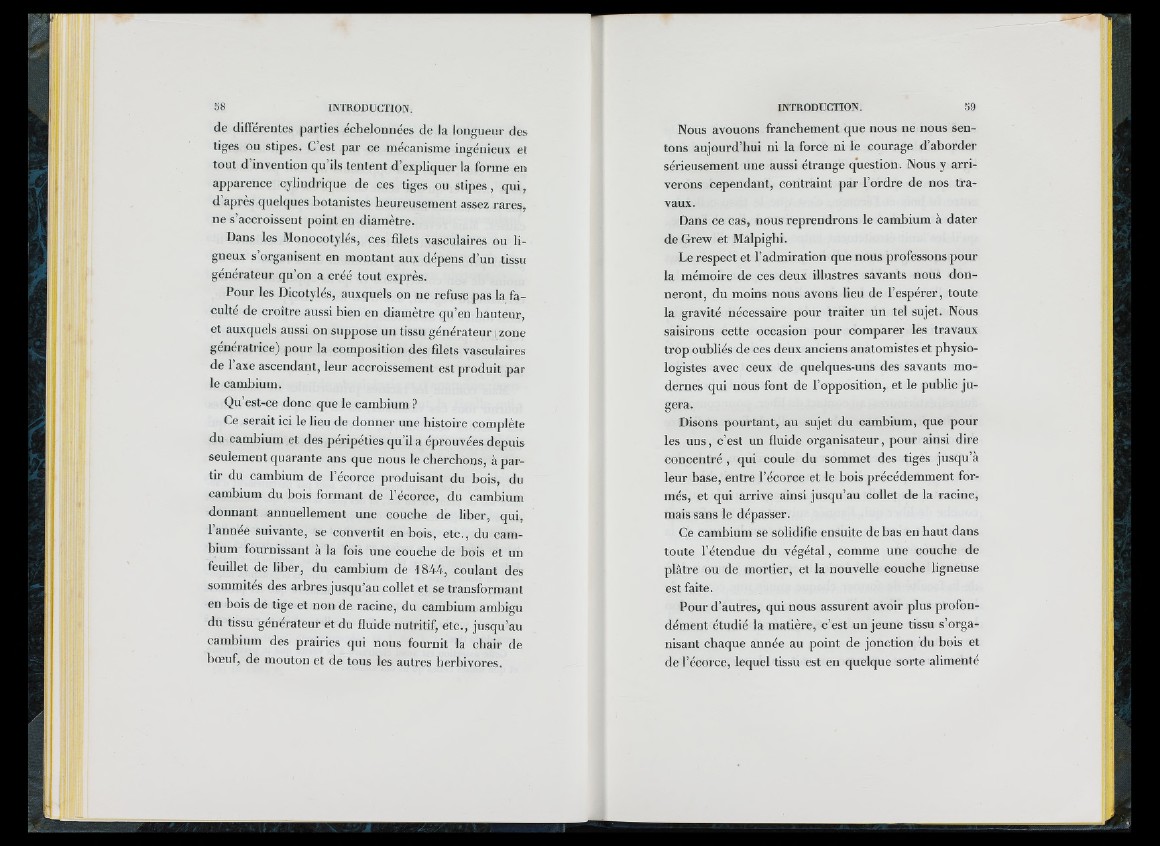
de différentes parties échelonnées de la longuenr des
tiges ou stipes. C’est par ce mécanisme ingénieux et
tout d ’invention qu’ils tentent d’expliquer la forme en
apparence cylindrique de ces tiges ou stipes, q u i,
d ’après quelques botanistes heureusement assez rares,
ne s’accroissent point en diamètre.
Dans les Monocotylés, ces filets vasculaires ou ligneux
s’organisent en montant aux dépens d’un tissu
générateur qu’on a créé tout exprès.
Pour les Dicotylés, auxquels on ne refuse pas la faculté
de croître aussi bien en diamètre qu’en bauteur,
et auxquels aussi on suppose un tissu générateur (zone
génératrice) pour la composition des filets vasculaires
de l’axe ascendant, leur accroissement est produit par
le cambium.
Qu’est-ce donc que le cambium ?
Ce serait ici le lieu de donner une histoire complète
du cambium et des péripéties qu’il a éprouvées depuis
seulement quarante ans que nous le cherchons, à partir
du cambium de l’écorce produisant du bois, du
cambium du bois formant de l’écorce, du cambium
donnant annuellement une couche de liber, qui,
l’année suivante, se convertit en bois, etc., du cambium
fournissant à la fois une couche de bois et un
feuillet de liber, du cambium de 1844, coulant des
sommités des arbres jusqu’au collet et se transformant
en bois de tige et non de racine, du cambium ambigu
du tissu générateur et du fluide nutritif, etc., jusqu’au
cambium des prairies qui nous fournit la chair de
boeuf, de mouton et de tous les autres herbivores.
Nous avouons franchement que nous ne nous sentons
aujourd’hui ni la force ni le courage d’aborder
sérieusement une aussi étrange question. Nous y arriverons
cependant, contraint par l’ordre de nos travaux.
Dans ce cas, nous reprendrons le cambium à dater
de Grew et Malpighi.
Le respect et l’admiration que nous professons pour
la mémoire de ces deux illustres savants nous donneront,
du moins nous avons lieu de l’espérer, toute
la gravité nécessaire pour traiter un tel sujet. Nous
saisirons cette occasion pour comparer les travaux
trop oubliés de ces deux anciens anatomistes et physiologistes
avec ceux de quelques-uns des savants modernes
qui nous font de l’opposition, et le public jugera.
Disons pourtant, au sujet du cambium, que pour
les uns, c’est un fluide organisateur, pour ainsi dire
concentré , qui coule du sommet des tiges jusqu’à
leur base, entre l’écorce et le bois précédemment formés,
et qui arrive ainsi jusqu’au collet de la racine,
mais sans le dépasser.
Ce cambium se solidifie ensuite de bas en haut dans
toute l’étendue du végétal, comme une couche de
plâtre ou de mortier, et la nouvelle couche ligneuse
est faite.
Pour d’autres, qui nous assurent avoir plus profondément
étudié la matière, c’est un jeune tissu s’organisant
chaque année au point de jonction du bois et
d e l’écorce, lequel tissu est en quelque sorte alimenté