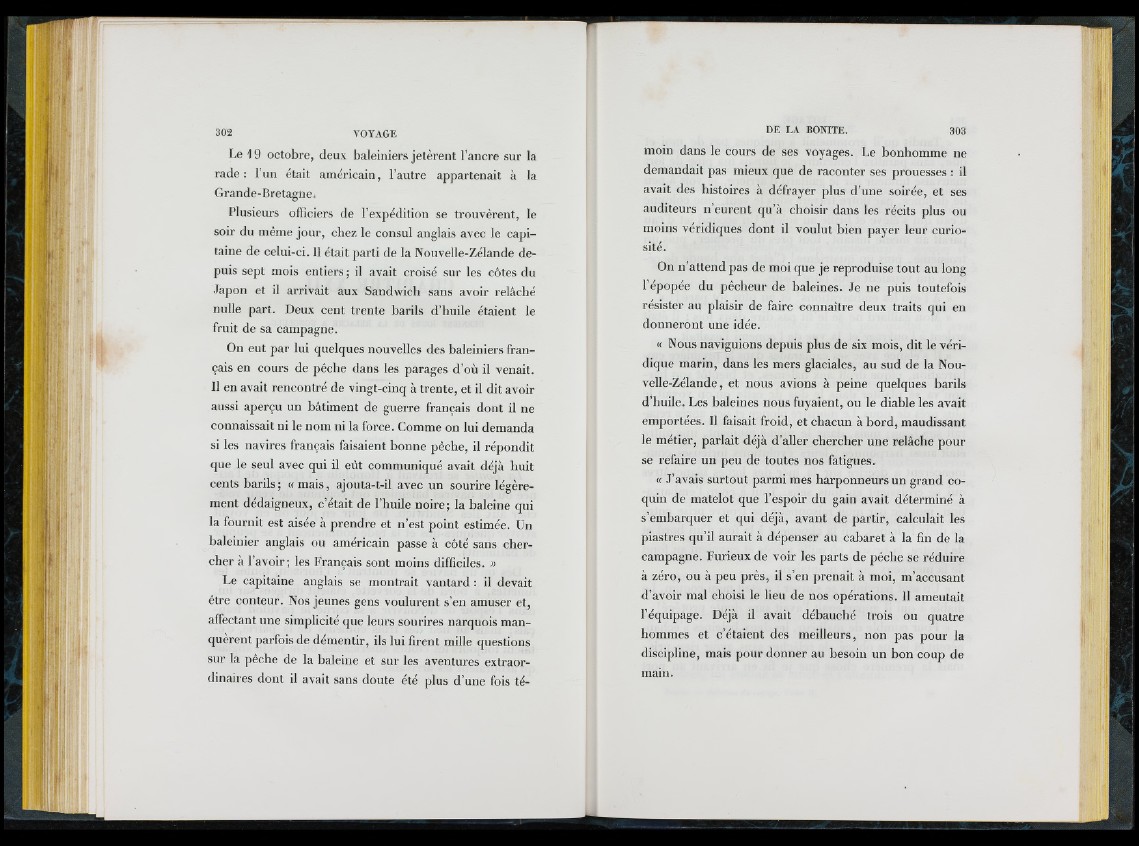
Le 19 octobre, deux baleiniers jetèrent l’ancre sur la
rade : l’un était américain, l’autre appartenait à la
Grande-Bretagne.
Plusieurs officiers de l’expédition se trouvèrent, le
soir du même jour, chez le consul anglais avec le capitaine
de celui-ci. 11 était parti de la Nouvelle-Zélande depuis
sept mois entiers ; il avait croisé sur les côtes du
Japon et il arrivait aux Sandwich sans avoir relâché
nulle part. Deux cent trente barils d’huile étaient le
fruit de sa campagne.
On eut par lui quelques nouvelles des baleiniers français
en cours de pêche dans les parages d’où il venait.
Il en avait rencontré de vingt-cinq à trente, et il dit avoir
aussi aperçu un bâtiment de guerre français dont il ne
connaissait ni le nom ni la force. Comme on lui demanda
si les navires français faisaient bonne pêche, il répondit
que le seul avec qui il eût communiqué avait déjà huit
cents barils; « mais, ajouta-t-il avec un sourire légèrement
dédaigneux, c’était de l’huile noire; la baleine qui
la fournit est aisée à prendre et n’est point estimée. Un
baleinier anglais ou américain passe à côté sans chercher
à l’avoir; les Français sont moins difficiles. »
Le capitaine anglais se montrait vantard : il devait
être conteur. Nos jeunes gens voulurent s’en amuser et,
affectant une simplicité que leurs sourires narquois manquèrent
parfois de démentir, ils lui firent mille questions
sur la pêche de la baleine et sur les aventures extraordinaires
dont il avait sans doute été plus d’une fois témoin
dans le cours de ses voyages. Le bonhomme ne
demandait pas mieux que de raconter ses prouesses : il
avait des histoires à défrayer plus d’une soirée, et ses
auditeurs n’eurent qu’à choisir dans les récits plus ou
moins véridiques dont il voulut bien payer leur curiosité
.O
n n’attend pas de moi que je reproduise tout au long
l’épopée du pêcheur de baleines. Je ne püis toutefois
résister au plaisir de faire connaître deux traits qui en
donneront une idée.
« Nous naviguions depuis plus de six mois, dit le véridique
marin, dans les mers glaciales, au sud de la Nouvelle
Zélande, et nous avions à peine quelques barils
d’huile. Les baleines nous fuyaient, ou le diable les avait
emportées. Il faisait froid, et chacun à bord, maudissant
le métier, parlait déjà d’aller chercher une relâche pour
se refaire un peu de toutes nos fatigues.
(( J’avais surtout parmi mes harponneurs un grand coquin
de matelot que l’espoir du gain avait déterminé à
s’embarquer et qui déjà, avant de partir, calculait les
piastres qu’il aurait à dépenser au cabaret à la fin de la
campagne. Furieux de voir les parts de pêche se réduire
à zéro, ou à peu près, il s’en prenait à moi, m’accusant
d’avoir mal choisi le lieu de nos opérations. Il ameutait
l’équipage. Déjà il avait débauché trois ou quatre
hommes et c’étaient des meilleurs, non pas pour la
discipline, mais pour donner au besoin un bon coup de
mam.
i, I