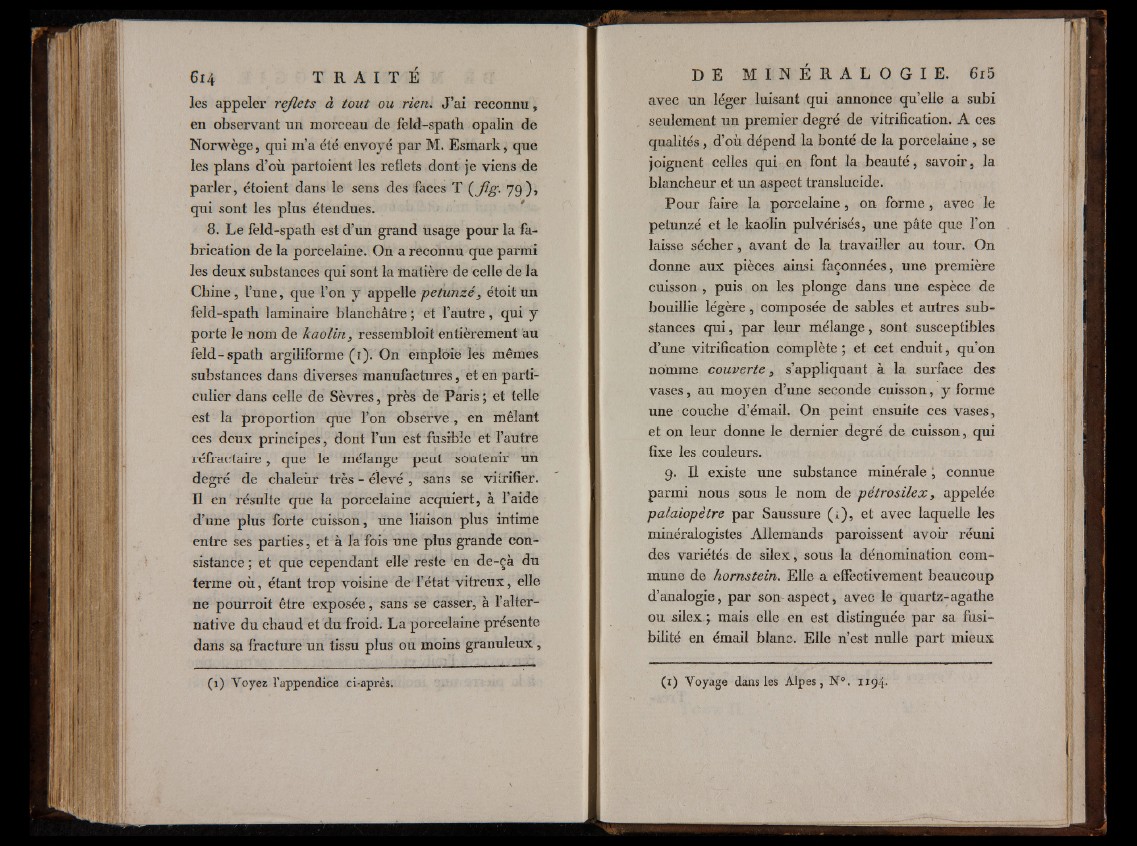
les appeler reflets à tout ou rien. J’ai reconnu,
en observant un morceau de feld-spath opalin de
Norwège, qui m’a été envoyé par M. Esmark, que
les plans d’où partoient les reflets dont je viens de
parler, étoient dans le sens des faces T (fîg- 79 ),
qui sont les plus étendues.
8. Le feld-spath est d’un grand usage pour la fabrication
de la porcelaine. On a reconnu que parmi
les deux substances qui sont la matière de celle de la
Chine, l’une, que l’on y appelle petunzé, étoit un
fèld-spath laminaire blanchâtre ; et l’autre, qui y
porte le nom de kaolin, ressembloit entièrement au
feld-spath argiliforme (1). On emploie les mêmes
substances dans diverses manufactures, et en particulier
dans celle de Sèvres, près de Paris ; et telle
est la proportion que l’on observe , en mêlant
ces deux principes, dont l’un est fusible et l’autre
réfractaire, que le mélange peut soutenir un
degré de chaleur très - élevé, sans se vitrifier.
Il en résulte que la porcelaine acquiert, à l’aide
d’une plus forte cuisson, une liaison plus intime
entre ses parties, et à la fois une plus grande consistance
; et que cependant elle reste en de-çà du
terme où, étant trop voisine de l’état vitreux, elle
ne pourroit être exposée, sans se casser, à l’alternative
du chaud et du froid. La porcelaine présente
dans sa fracture un tissu plus ou moins granuleux,
(1) Voyez l’appendice ci-après.
avec un léger luisant qui annonce qu’elle a subi
seulement un premier degré de vitrification. A ces
qualités, d’où dépend la bonté de la porcelaine, se
joignent celles qui en font la beauté, savoir, la
blancheur et un aspect translucide.
Pour faire la porcelaine, on forme, avec le
petunzé et le kaolin pulvérisés, une pâte que l’on
laisse sécher, avant de la travailler au tour. On
donne aux pièces ainsi façonnées, une première
cuisson , puis on les plonge dans une espèce de
bouillie légère, composée de sables et autres substances
qui, par leur mélange, sont susceptibles
d’une vitrification complète ; et cet enduit, qu’on
nomme couverte, s’appliquant à la surface des
vases, au moyen d’une seconde cuisson, y forme
une couche d’émail. On peint ensuite ces vases,
et on leur donne le dernier degré de cuisson, qui
fixe les couleurs.
9. Il existe une substance minérale ; connue
parmi nous sous le nom de pétrosilex 3 appelée
palaiopètre par Saussure (i), et avec laquelle les
minéralogistes Allemands paroissent avoir réuni
des variétés de silex, sous la dénomination commune
de hornstein. Elle a effectivement beaucoup
d’analogie, par son-aspect, avec le quartz-agathe
ou silex ; mais elle en est distinguée par sa fusibilité
en émail blanc. Elle n’est nulle part mieux
(1) Voyage dans les Alpes, N9. 1194*