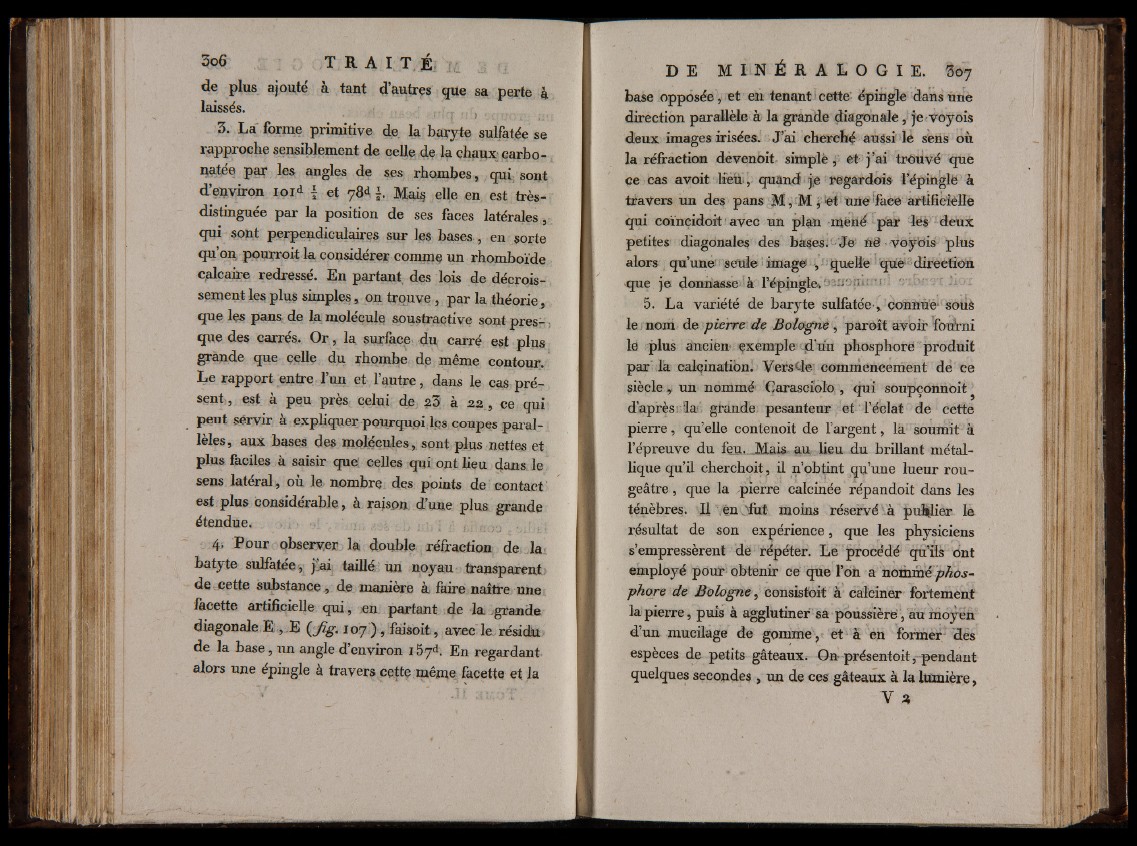
de plus ajouté à tant d’autrçs que sa parte 4
laissés.
3. La forme primitive de la baryte sulfatée se
rapproche sensiblement de celle de la chaux carbo-
nafoe par* les angles de ses; rhombes, qui, sont
d’environ iq id i et 7841. Mais elle en est très-
distinguée par la position de ses faces latérales,
qui sont perpendiculaires sur les bases , en sorte
qu’on pourroit la considérer comme un rhomboïde
c,alcaire redressé. En partant des lois de décroissement
les plus simples, on trouve , par la théorie ,
que les pans de la molécule soustractive sont près-,
que des carrés* Or, la surface du carré est plus
grande que celle du rhombe de même contour.
Le rapport entre l’un et l’autre, dans le cas présent,
est à peu près celui de 2.3 à 22 , ce qui
peut servir à expliquer pourquoi fos coupes parallèles
, aux bases des molécules, spnt plus nettes et
plus faciles à saisir que' celles qui ont lieu dans le
sens latéral;, où le nombre des points de contact
est plus considérable, a raison dune plus grande
étendue*
4- Pour Qbserver la double réfraction de la
batyte sulfatee, j.ai taillé'un noyau transparent;
de cette substance, de manière à faire naître une
facette artificielle qui , en partant de la .grande
diagonale E , .E (Jig. 107 ) , faisoit, avec le résidu
de la base, un angle d’environ 15yd. En regardant
alors une épingle à travers cette même facette et la
base opposée, et eii tenant I cette' épingle dans une
direction parallèle à la grande diagonale, jevoyois
deux images irisées. J’ai cherché aussi le s'eüs où
la réfraction dévenoit siïttplè p. et j’ai trouvé que
ce cas avoit liéù, quand j,e regârdois l’épingle à
travers un des pans M, *:M , et une >faeé artificielle
qui coïnçidoit ■ avec un plan mène par les deux
petites diagonales des bases* Je tiê - voyois plus
alors qu’uneJ seule * image y quelle que'direètion
que je donnasse à répIngle^ 'Jî - ' 11* r
5. La variété de baryte sulfatée• r connue sous
le nom de pierre de Bologne , parolt avoir fouVni
le plus ancien- exemple d'ùu phosphore produit
par la calcination] VersCle- commencement dé ce
siècle, un nommé fjarasciolo , qui soupçonnoit^
d après r la- grande pesanteur et l’éelat de cette
pierre, qu’elle contenoit de l’argent, là soumit a
l’épreuve du fou*. „Mais au lieu du brillant métallique
qu’il cherchoit, il n’obtint qu’une lueur rougeâtre
, que la pierre calcinée répandoit dans les
ténèbres. Il ènvdùt moins réservé publier le
résultat de son expérience, que les physiciens
s’empressèrent de répéter. Le procédé qu’ils ont
employé pour obtenir ce que l’on a nommé phosphore
de Bologne ^ consistoit à calciner fortement
la pierre, puis à agglutinersa poussière, au moyen
d’un mucilage de gomme , et à en former dés
espèces de petits gâteaux. On- présentoit, pendant
quelques secondes , un de ces gâteaux à la lumière,
V *