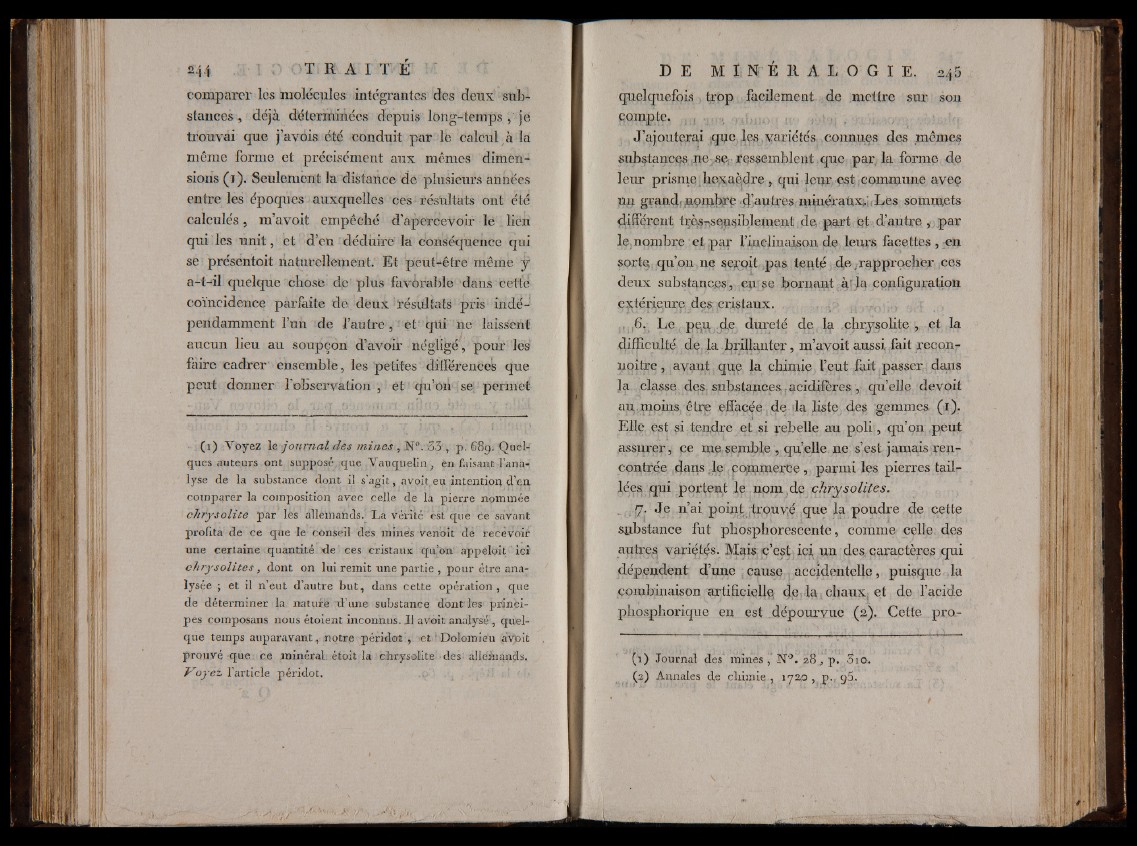
comparer les molécules intégrantes des deux substances
, déjà déterminées depuis long-temps , je
trouvai que j’avôis été conduit par le calcul à la
même forme et précisément aux mêmes dimensions
(i). Seulement la ’distance de plusieurs années
entre les époques auxquelles ces résultats ont été
calculés, m’avoit empêché d'apercevoir lè lien
qui les unit, et d’en déduire la conséquence qui
se présentoit naturellement. Et peut-être même ÿ
a-t-il quelque chose de plus favorable dans cette
coïncidence parfaite de deux résultats pris indépendamment
l’un de l’autre, et; qtii ne laissent
aucun lieu au soupçon d’avoir négligé , pour les
faire cadrer ensemble, les petites différences que
peut donner l'observation , et qu’on 'se; permet
(1) Voyez le jo u rn a l des mines , .N°. 33J, p. 689. Quelques
auteurs ont supposé, .que Vauquelin ; en faisant l’analyse
de la substance dont il s'agit, avoit, ey intention d’çn.
comparer la composition avec celle de là pierre npmmée
chrysolite par les allemands. La vérité 'est què Ce savant
profita de ce que le conseil des minés venoit dé recevoir
une certaine quantité d e ces cristaux qu’on appelait ici
ch ry so lite s, dont on lui remit une partie , pour être analysée
; et il n’eut d’autre b u t, dans cette opération, que
de déterminer la nature d’une substance dont les principes
composans nous étoient inconnus. Il avoit analysé , quelque
temps auparavant , notre pérklot ,: >et ' Dolomiéu ,aY)oit
prouvé que ce minéral: étoit la chrysolite des, alléiuands.
Voyez l’article péridot.
D E M I N É II A L O G I E. 245
quelquefois , trop facilement de mettre sur son
qompte. » ( aiimo «• • :
J’ajouterai ¡qqei varié tés .connuçs des mêmes
substances ne^spe ressemblent que par, la forme de
leur prisme : hejxa^dre, qui leur estcommune aveç
uij grand d ’aptçéSi minéraux. 1 Dès sommets
différent tçmj’sensibfétnent de pnrt et d’autre, par
le; nombre et par l’inclinaison de leurs facettes , en
sorte qu’on. ne serpil pas teqtpj 4e ¿rapprocher ces
deux substances, en; se bornant \ à’la configuration
extérieure des cristaux.
Le , pe(u 4e, dureté de lg chrysolite , ,et la
difficulté de, la brillanter, m’avoit aussi fait recon-
noître, ayant qqe la phimie l’eut lait passer 4ails
la classe des substances, .mcidiiêres , qu’elle devoit
cin,mpins, êtrp effacée; de la liste des gemmes (1).
Elle est si:tendre-,et .si rebelle au poli;, qu’on peut
assurer, pe me semble , qu’elle ne s’est jama-is rencontrée
4aits le < commerce , parmi les pierres taillées:
qui portent le nom.de chrysolites.
. .7. Je n’ai point;trpuv;é .que la poudre de cette
substance fut phosphorescente, comme cçlle des
autre^ variçtçs. Mais; c’est5 ici un des, caractères qui
dépendent d’une ; cause | accidentelle, puisque la
combinaison artificielle dp!la chaux- et de l’acide
phosphorique en est .dépourvue (2). Cette pro(
1) Journal des' minés , N°. 28, p. O10.
(a) Annales d,e chimie, 172,0 , p., g5.