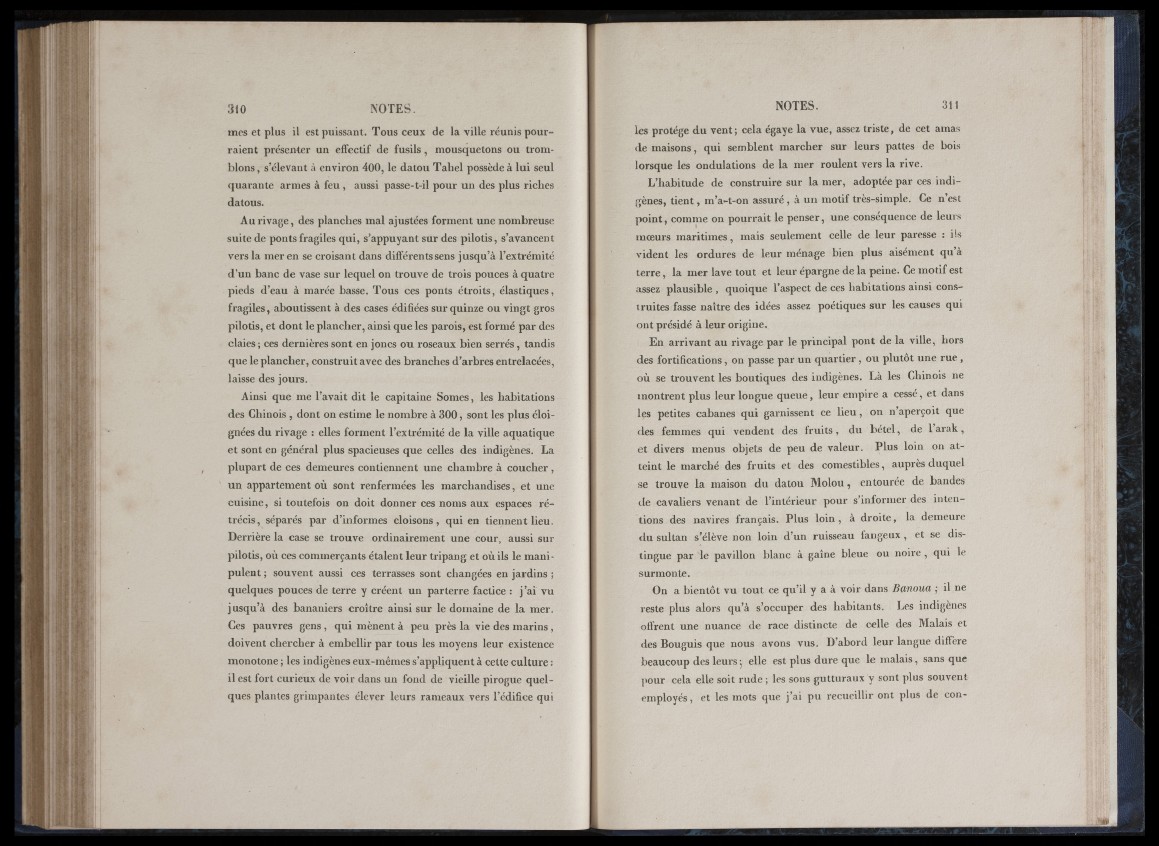
mes et plus il est puissant. Tous ceux de la ville réunis pourraient
présenter un effectif de fusils, mousquetons ou trom-
b lo n s s ’élevant à environ 400, le datou Tahel possède à lui seul
quarante armes à feu, aussi passe-t-il pour un des plus riches
datous.
Au rivage, des planches mal ajustées forment une nombreuse
suite de ponts fragiles qui, s’appuyant sur des pilotis, s’avancent
vers la mer en se croisant dans différents sens jusqu’à l’extrémité
d’un banc de vase sur lequel on trouve de trois pouces à quatre
pieds d’eau à marée basse. Tous ces ponts étroits, élastiques,
fragiles, aboutissent à des cases édifiées sur quinze ou vingt gros
pilotis, et dont le plancher, ainsi que les parois, est formé par des
claies ; ces dernières sont en joncs ou roseaux bien serrés, tandis
que le plancher, construit avec des branches d’arbres entrelacées,
laisse des jours.
Ainsi que me l’avait dit le capitaine Somes, les habitations
des Chinois, dont on estime le nombre à 300, sont les plus éloignées
du rivage s elles forment l’extrémité de la ville aquatique
et sont en général plus spacieuses que celles des indigènes. La
plupart de ces demeures contiennent une chambre à coucher,
un appartement où sont renfermées les marchandises, et une
cuisine, Si toutefois on doit donner ces noms aux espaces rétrécis,
séparés par d’informes cloisons, qui en tiennent lieu.
Derrière la case se trouve ordinairement une cour, aussi sur
pilotis, où ces commerçants étalent leur tripang et où ils le manipulent
; souvent aussi ces terrasses sont changées en jardins j
quelques pouces de terre y créent un parterre factice : j’ai' vu
jusqu’à des bananiers croître ainsi sur le domaine de la mer.
Ces pauvres gens, qui mènent à peu près la vie des marins,
doivent chercher à embellir par tous les moyens leur existence
monotone ; les indigènes eux-mêmes s’appliquent à cette culture :
il est fort curieux de voir dans un fond de vieille pirogue quelques
plantes grimpantes élever leurs rameaux vers l’édifice qui
les protège du vent; cela égaye la vue, assez triste, de cet amas
de maisons, qui semblent marcher sur leurs pattes de bois
lorsque les ondulations de la mer roulent vers la rive.
L’habitude de construire sur la mer, adoptée par ces indigènes,
tient, m’a-t-on assuré, à un motif très-simple. Ce n’est
point, comme on pourrait le penser, une conséquence de leurs
moeurs maritimes, mais seulement celle de leur paresse : iis
vident les ordures de leur ménage bien plus aisément qu à
terre, la mer lave tout et leur épargne de la peine. Ce motif est
assez plausible , quoique l’aspect de ces habitations ainsi construites
fasse naître des idées assez poétiques sur les causes qui
ont présidé à leur origine..
En arrivant au rivage, par le principal pont de la ville, hors
des fortifications, on passe par un quartier, ou plutôt une rue,
où se trouvent les boutiques des indigènes. Là les Chinois ne
montrent plus leur longue queue, leur empire a cessé, et dans
les petites cabanes qui garnissent ce lieu , on n’aperçoit que
des femmes qui vendent des fruits, du bétel, de larak,
et divers menus objets de peu de valeur. Plus loin on atteint
le marché des fruits et des comestibles, auprès duquel
se trouve la maison du datou Molou, entourée de bandes
de cavaliers venant de l’intérieur pour s’informer des intentions
des navires français. Plus loin, à droite, la demeure
du sultan s’élève non loin d’un ruisseau fangeux, et se distingue
par le pavillon blanc à gaine bleue ou noire , qui le
surmonte.
On a bientôt vu tout ce qu’il y a à voir dans Banoua ,* il ne
reste plus alors qu’à s’occuper des habitants. Les indigènes
offrent une nuancé de race distincte de celle des Malais et
des Bouguis que nous avons vus. D’abord leur langue différé
beaucoup des leurs; elle est plus dure que le malais, sans que
pour cela elle soit rude ; les sons gutturaux y sont plus souvent
employés, et les mots que j’ai pu recueillir ont pins de con