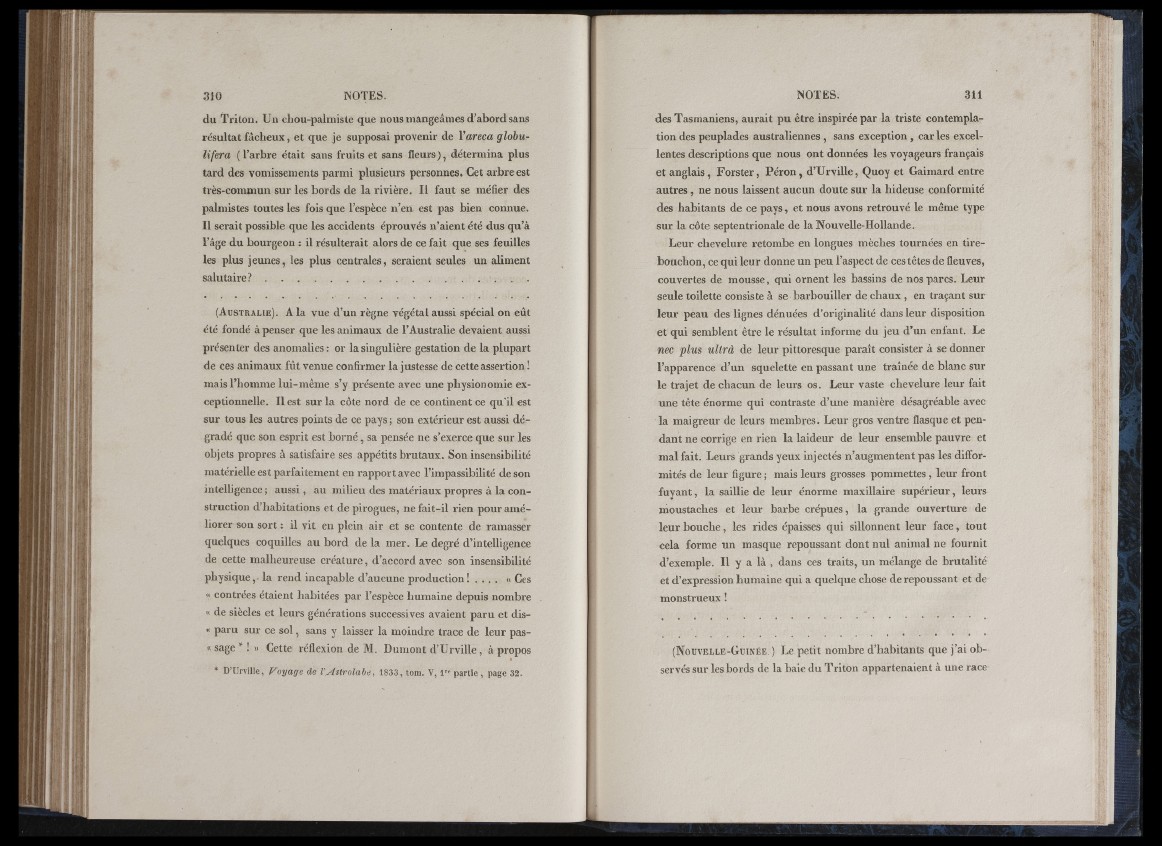
I . r . i
IB : 44f'Ii M 1;|
;i ’ii|
4 il
4 a
! . iii
du Triton. Uu cliou-palmiste que nous mangeâmes d’abord sans
résultat fâcheux, et que je supposai provenir de Vareca globu-
lifera ( l’arbre était sans fruits et sans fleurs ), détermina plus
tard des vomissements parmi plusieurs personnes. Cet arbre est
très-commun sur les bords de la rivière. Il faut se méfier des
palmistes toutes les fois que l’espèce n’en est pas bien connue.
Il serait possible que les accidents éprouvés n’aient été dus qu’à
l ’âge du bourgeon : il résulterait alors de ce fait que ses feuilles
les plus jeunes, les plus centrales, seraient seules un aliment
salutaiie ? ..................................................................................................
(Australie). A la vue d’un règne végétal aussi spécial on eût
été fondé à penser que les animaux de l’Australie devaient aussi
présenter des anomalies : or la singulière gestation de la plupart
de ces animaux fût venue confirmer la justesse de cette assertion !
mais l’homme lui-même s’y présente avec une physionomie exceptionnelle.
Il est sur la côte nord de ce continent ce qu'il est
sur tous les autres points de ce pays ; son extérieur est aussi dégradé
que son esprit est borné, sa pensée ne s’exerce que sur les
objets propres à satisfaire ses appétits brutaux. Son insensibilité
matérielle est parfaitement en rapport avec l ’impassibilité de son
intelligence ; aussi, au milieu des matériaux propres à la construction
d’habitations et de pirogues, ne fait-il rien pour améliorer
son sort : il vit en plein air et se contente de ramasser
quelques coquilles au bord de la mer. Le degré d’intelligence
de cette malheureuse créature, d’accord avec son insensibilité
physique, la rend incapable d’aucune production! . . . . « Ces
« contrées étaient habitées par l’espèce humaine depuis nombre
« de siècles et leurs générations successives avaient paru et dis-
« paru sur ce s o l, sans y laisser la moindre trace de leur pas-
« sage ! » Cette réflexion de M. Dumont d’Urville , à propos
* D’Urville, oyage de V A s t r o la b e , 1833, tom. V, l ’" partie , page 32.
des Tasmaniens, aurait pu être inspirée par la triste contemplation
des peuplades australiennes , sans exception , car les excellentes
descriptions que nous ont données les voyageurs français
et anglais, Förster, Péron, d’Urville, Quoy et Gaimard entre
autres, ne nous laissent aucun doute sur la hideuse conformité
des habitants de ce pays, et nous avons retrouvé le même type
sur la côte septentrionale de la Nouvelle-Hollande.
Leur chevelure retombe en longues mèches tournées en tire-
bouchon, ce qui leur donne un peu l’aspect de ces têtes de fleuves,
couvertes de mousse, qui ornent les bassins de nos parcs. Leur
seule toilette consiste à se barbouiller de chaux , en traçant sur
leur peau des lignes dénuées d’originalité dans leur disposition
et qui semblent être le résultat informe du jeu d’un enfant. Le
nec p lu s u ltra de leur pittoresque paraît consister à se donner
l’apparence d’un squelette en passant une traînée de blanc sur
le trajet de chacun de leurs os. Leur vaste chevelure leur fait
une tête énorme qui contraste d’une manière désagréable avec
la maigreur de leurs membres. Leur gros ventre flasque et pendant
ne corrige en rien la laideur de leur ensemble pauvre et
mal fait. Leurs grands yeux injectés n’augmentent pas les difformités
de leur figure ; mais leurs grosses pommettes, leur front
fuyant, la saillie de leur énorme maxillaire supérieur, leurs
moustaches et leur barbe crépues, la grande ouverture de
leur bouche, les rides épaisses qui sillonnent leur fa ce , tout
cela forme un masque repoussant dont nul animal ne fournit
d’exemple. Il y a là , dans ces traits, un mélange de brutalité
et d’expression humaine qui a quelque chose de repoussant et de
monstrueux ;
(N o u v e l l e -G u i n é e ) Le petit nombre d’habitants que j’ai observés
sur les bords de la baie du Triton appartenaient à une race