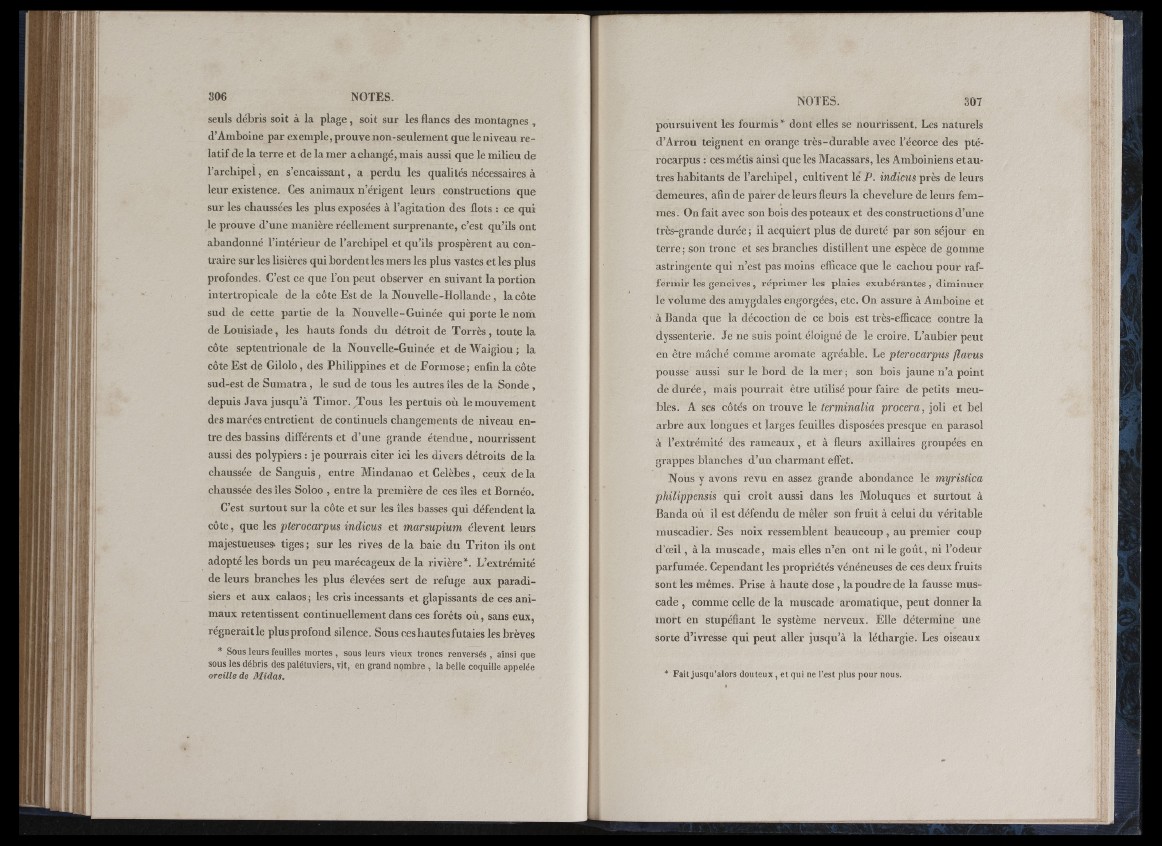
i : ''î
f .1
J - ' i l
seuls débris soit à la plage , soit sur les flancs des montagnes ,
d’Amboine par exemple, prouve non-seulement que le niveau relatif
de la terre et de la mer a changé, mais aussi que le milieu de
Tarcbipel, en s’encaissant, a perdu les qualités nécessaires à
leur existence. Ces animaux n’érigent leurs constructions que
sur les chaussées les plus exposées à l’agitation des flots : ce qui
le prouve d’une manière réellement surprenante, c’est qu’ils ont
abandonné l ’intérieur de l ’archipel et qu’ils prospèrent au contraire
sur les lisières qui bordent les mers les plus vastes et les plus
profondes. C’est ce que l’on peut observer en suivant la portion
intertropicale de la côte Est de la Nouvelle-Hollande, la côte
sud de cette partie de la Nouvelle-Guinée qui porte le nom
de Louisiade, les hauts fonds du détroit de Torrès, toute la
côte septentrionale de la Nouvelle-Guinée et de Waigiou ; la
côte Est de Gilolo, des Philippines et de Formose ; enfin la côte
sud-est de Sumatra, le sud de tous les autres îles de la Sonde ,
depuis Java jusqu’à Timor. Tous les pertuis où le mouvement
des marées entretient de continuels changements de niveau entre
des bassins différents et d’une grande étendue, nourrissent
aussi des polypiers : je pourrais citer ici les divers détroits de la
chaussée de Sanguis, entre Mindanao et Celèbes, ceux de la
chaussée des îles Soloo , entre la première de ces îles et Bornéo.
C’est surtout sur la côte et sur les îles basses qui défendent la
côte, que les ptérocarpus indicus et marsupium élevent leurs
majestueuses* tiges ; sur les rives de la baie du Triton ils ont
adoptóles bords un peu marécageux de la rivière’'. L’extrémité
de leurs branches les plus élevées sert de refuge aux paradisiers
et aux calaos ; les cris incessants et glapissants de ces animaux
retentissent continuellement dans ces forêts où, sans eux,
régnerait le plus profond silence. Sous ces hautes futaies les brèves
* Sous leurs feuilles mortes , sous leurs vieux troncs renversés , ainsi que
sous les débris des palétuviers, vit, en grand nombre , la belle coquille appelée
oreille de Midas.
poursuivent les fourmis * dont elles se nourrissent. Les naturels
d’Arrou teignent en orange très-durable avec l’écorce des ptérocarpus
; ces métis ainsi que les Macassars, les Amboiniens et autres
habitants de l’archipel, cultivent lé P. indicus près de leurs
demeures, afin de parer de leurs fleurs la chevelure de leurs femmes.
On fait avec sou bois des poteaux et des constructions d’une
très-grande durée; il acquiert plus de dureté par son séjour en
terre ; son tronc et ses branches distillent une espèce de gomme
astringente qui n’est pas moins efficace que le cachou pour raffermir
les gencives, réprimer les plaies exubérantes, diminuer
le volume des amygdales engorgées, etc. On assure à Amboine et
à Banda que la décoction de ce bois est très-efficace contre la
dyssenterie. Je ne suis point éloigné de le croire. L’aubier peut
en être mâché comme aromate agréable. Le ptérocarpus flavus
pousse aussi sur le bord de la mer ; son bois jaune n’a point
de durée, mais pourrait être utilisé pour faire de petits meubles.
A ses côtés on trouve le terminalia procera, joli et bel
arbre aux longues et larges feuilles disposées presque en parasol
à l’extrémité des rameaux, et à fleurs axillaires groupées en
grappes blanches d’un charmant effet.
Nous y avons revu en assez grande abondance le myristica
philippensis qui croît aussi dans les Moluques et surtout à
Banda où il est défendu de mêler son fruit à celui du véritable
muscadier. Ses noix ressemblent beaucoup , au premier coup
d ’oe i l , à la muscade, mais elles n’en ont ni le goût, ni l’odeur
parfumée. Cependant les propriétés vénéneuses de ces deux fruits
sont les mêmes. Prise à haute dose , la poudre de la fausse muscade
, comme celle de la muscade aromatique, peut donner la
mort en stupéfiant le système nei’veux. Elle détermine une
sorte d’ivresse qui peut aller jusqu’à la léthargie. Les oiseaux
* Fait ju sq u ’alors d o u te u x , et qui ne l’est plus pour nous.