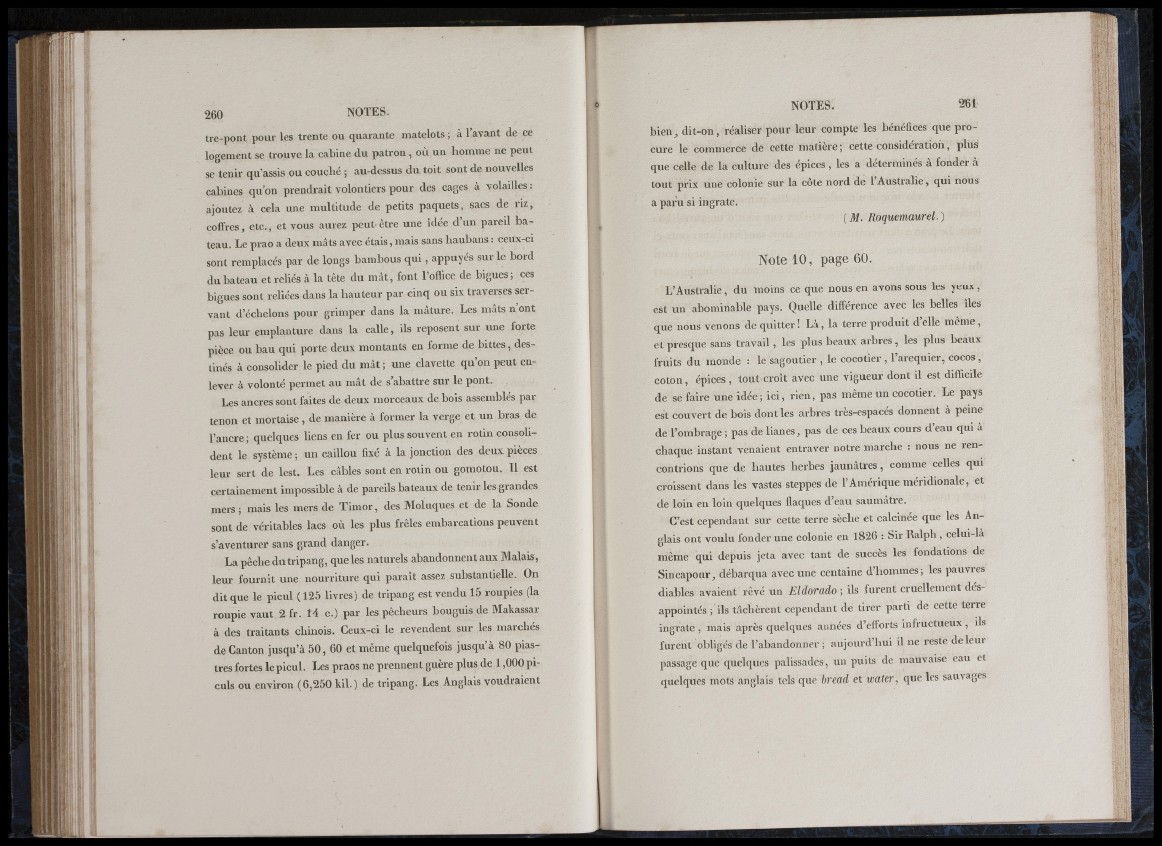
.L..1 i'
mHJ
! ’
260 NOTES.
tre-pont pour les trente ou quarante matelots ; à l ’avant de ce
logement se trouve la cabine du patron, où un homme ne peut
se tenir qu’assis ou couché ; au-dessus du toit sont de nouvelles
cabines qu’on prendrait volontiers pour des cages à volailles :
ajoutez à cela une multitude de petits paquets, sacs de riz,
coffres, etc., et vous aurez peut-être une idée d’un pareil bateau.
Le prao a deux mâts avec étais, mais sans haubans : ceux-ci
sont remplacés par de longs bambous q u i, appuyés sur le boid
du bateau et reliés à la tête du mât, font l ’oflice de bigues ; ces
bigues sont reliées dans la hauteur par cinq ou six traverses servant
d’échelons pour grimper dans la mâture. Les mâts n’ont
pas leur emplanture dans la calle, ils reposent sur une forte
pièce ou bau qui porte deux montants en forme de bittes, destinés
à consolider le pied du mât; une clavette qu’on peut enlever
à volonté permet au mât de s’abattre sur le pont.
Les ancres sont faites de deux morceaux de bois assemblés par
tenon et mortaise, de manière à former la verge et un bras de
Tancre ; quelques liens en fer ou plus souvent en rotin consolident
le système ; un caillou fixé à la jonction des deux pièces
leur sert de lest. Les câbles sont en roiin ou gomotou. T1 est
certainement impossible à de pareils bateaux de tenir les grandes
mers; mais les mers de Timor, des Moluques et de la Sonde
sont de véritables lacs où les plus frêles embarcations peuvent
s’aventurer sans grand danger.
La pêche du tripang, que les naturels abandonnent aux Malais,
leur fournit une nourriture qui paraît assez substantielle. On
dit que le picul (125 livres) de tripang est vendu 15 roupies (la
roupie vaut 2 fr. 14 c.) par les pêcheurs bouguis de Makassar
à des traitants chinois. Ceux-ci le revendent sur les marchés
de Canton jusqu’à 5 0 , 60 et même quelquefois jusqu’à 80 piastres
fortes le picul. Les praos ne prennent guère plus de 1,000 pi-
culs ou environ (6,250 kil.) de tripang. Les Anglais voudraient
NOTES. m i
bien, dit-on, réaliser pour leur compte les bénéfices que procure
le commerce de cette matière ; cette considération, plus
que celle de la culture des épices , les a déterminés à fonder à
tout prix une colonie sur la côte nord de l’Australie, qui nous
a paru si ingrate.
[M. Roquemaurel.)
Note 10, page 60.
L’Australie, du moins ce que nous en avons sous les yeux,
est un abominable pays. Quelle différence avec les belles îles
que nous venons de quitter! Là, la terre produit d’elle même,
et presque sans travail, les plus beaux arbres, les plus beaux
fruits du monde : le sagoutier , le cocotier , Tarequier, cocos ,
coton, épices , tout croît avec une vigueur dont il est difficile
de se faire une idée; ic i, rien, pas même un cocotier. Le pays
est couvert de bois dont les arbres très-espacés donnent à peine
de Tombrage; pas de lianes, pas de ces beaux cours d’eau qm à
chaque instant venaient entraver notre marche ; nous ne rencontrions
que de hautes herbes jaunâtres, comme celles qui
croissent dans les vastes steppes de l’Amérique méridionale, et
de loin en loin quelques flaques d’eau saumâtre.
C’est cependant sur cette terre sèche et calcinée que les Anglais
ont voulu fonder une colonie en 1826 : Sir Ralph , celui-là
même qui depuis jeta avec tant de succès les fondations de
Sincapour, débarqua avec une centaine d’hommes; les pauvres
diables avaient rêvé un Eldorado ; ils furent cruellement désappointés
; ils tâchèrent cependant de tirer parti de cette terre
ingrate , mais après quelques années d’efforts infructueux, ils
furent obligés de l’abandonner ; aujourd’hui il ne reste de leur
passage que quelques palissades, un puits de mauvaise eau et
quelques mots anglais tels que bread et water, que les sauvages
t !
r
I*
mm]
i' ,
.« t il