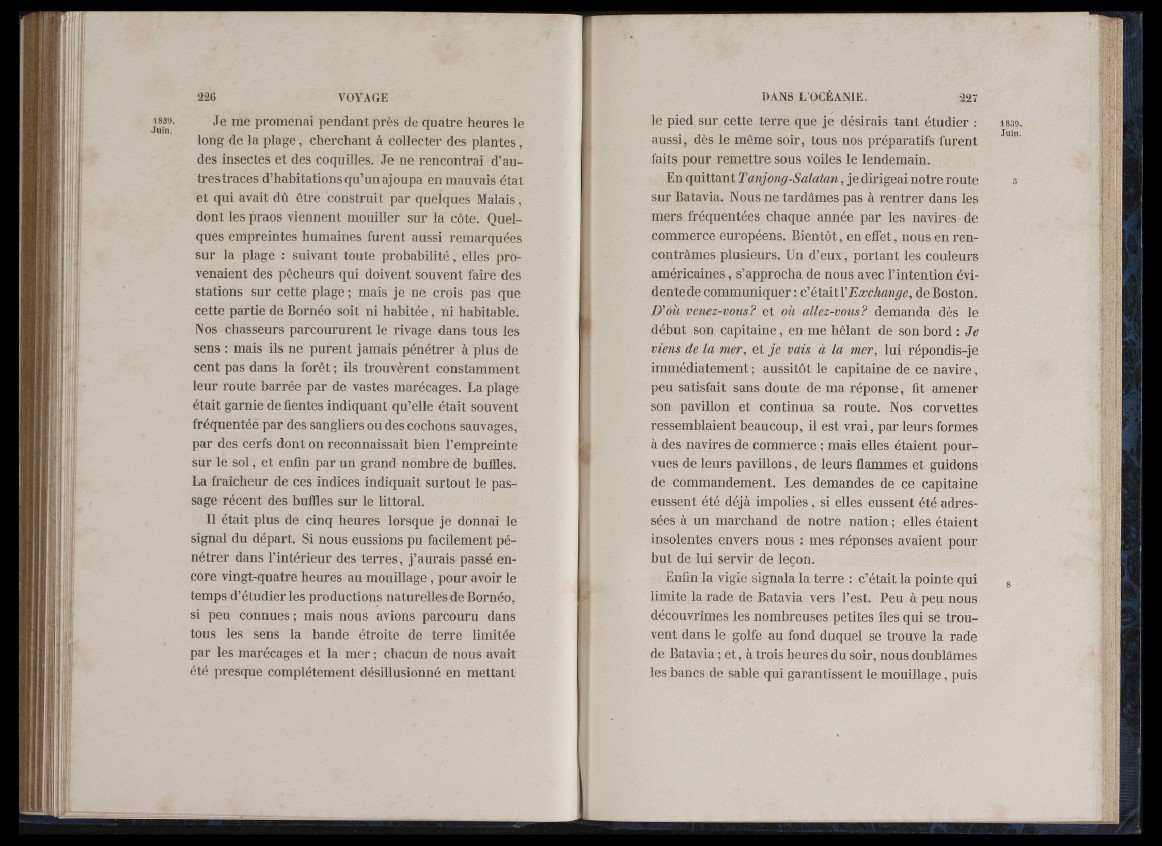
Je me promenai pendant près de quatre heures le
long de la plage, cherchant à collecter des plantes,
des insectes et des coquilles. Je ne rencontrai d’au-
trestraces d’habitations qu’un ajoupa en mauvais état
et qui avait dû être construit par quelques Malais,
dont les praos viennent mouiller sur la côte. Quelques
empreintes humaines furent aussi remarquées
sur la plage : suivant toute probabilité, elles provenaient
des pêcheurs qui doivent souvent faire des
stations sur cette plage ; mais je ne crois pas que
cette partie de Bornéo soit ni habitée , ni habitable.
Nos chasseurs parcoururent le rivage dans tous les
sens : mais ils ne purent jamais pénétrer à plus de
cent pas dans la forêt ; ils trouvèrent constamment
leur route barrée par de vastes marécages. La plage
était garnie de fientes indiquant qu’elle était souvent
fréquentée par des sangliers ou des cochons sauvages,
par des cerfs dont on reconnaissait bien l’empreinte
sur le so l, et enfin par un grand nombre de buffles.
La fraicheur de ces indices indiquait surtout le passage
récent des buffles sur le littoral.
Il était plus de cinq heures lorsque je donnai le
signal du départ. Si nous eussions pu facilement pénétrer
dans l’intérieur des terres, j’aurais passé encore
vingt-quatre heures au mouillage , pour avoir le
temps d’étudier les productions naturelles de Bornéo,
si peu connues ; mais nous avions parcouru dans
tous les sens la bande étroite de terre limitée
par les marécages et la mer ; chacun de nous avait
été presque complètement désillusionné en mettant
le pied sur cette terre que je désirais tant étudier :
aussi, dès le même soir, tous nos préparatifs furent
faits pour remettre sous voiles le lendemain.
En quittant Tanjong-Salatan, je dirigeai notre route
sur Batavia. Nous ne tardâmes pas à rentrer dans les
mers fréquentées chaque année par les navires de
commerce européens. Bientôt, en effet, nous en rencontrâmes
plusieurs. Un d’eux, portant les couleurs
américaines, s’approcha de nous avec l’intention évidente
de communiquer : FéiaitVExchange, de Boston.
D'oU venez-vous? et où allez-vous? demanda dès le
début son capitaine, en me hélant de son bord : Je
viens de la mer, et je vais à la mer, lui répondis-je
immédiatement ; aussitôt le capitaine de ce navire,
peu satisfait sans doute de ma réponse, fit amener
son pavillon et continua sa route. Nos corvettes
ressemblaient beaucoup, il est vrai, par leurs formes
à des navires de commerce ; mais elles étaient pourvues
de leurs pavillons, de leurs flammes et guidons
de commandement. Les demandes de ce capitaine
eussent été déjà impolies, si elles eussent été adressées
à un marchand de notre nation ; elles étaient
insolentes envers nous : mes réponses avaient pour
but de lui servir de leçon.
Enfin la vigie signala la terre : c’était la pointe qui
limite la rade de Batavia vers l’est. Peu à peu nous
découvrimes les nombreuses petites iles qui se trouvent
dans le golfe au fond duquel se trouve la rade
de Batavia ; et, à trois heures du soir, nous doublâmes
les bancs de sable qui garantissent le mouillage, puis
1839.
Juin.