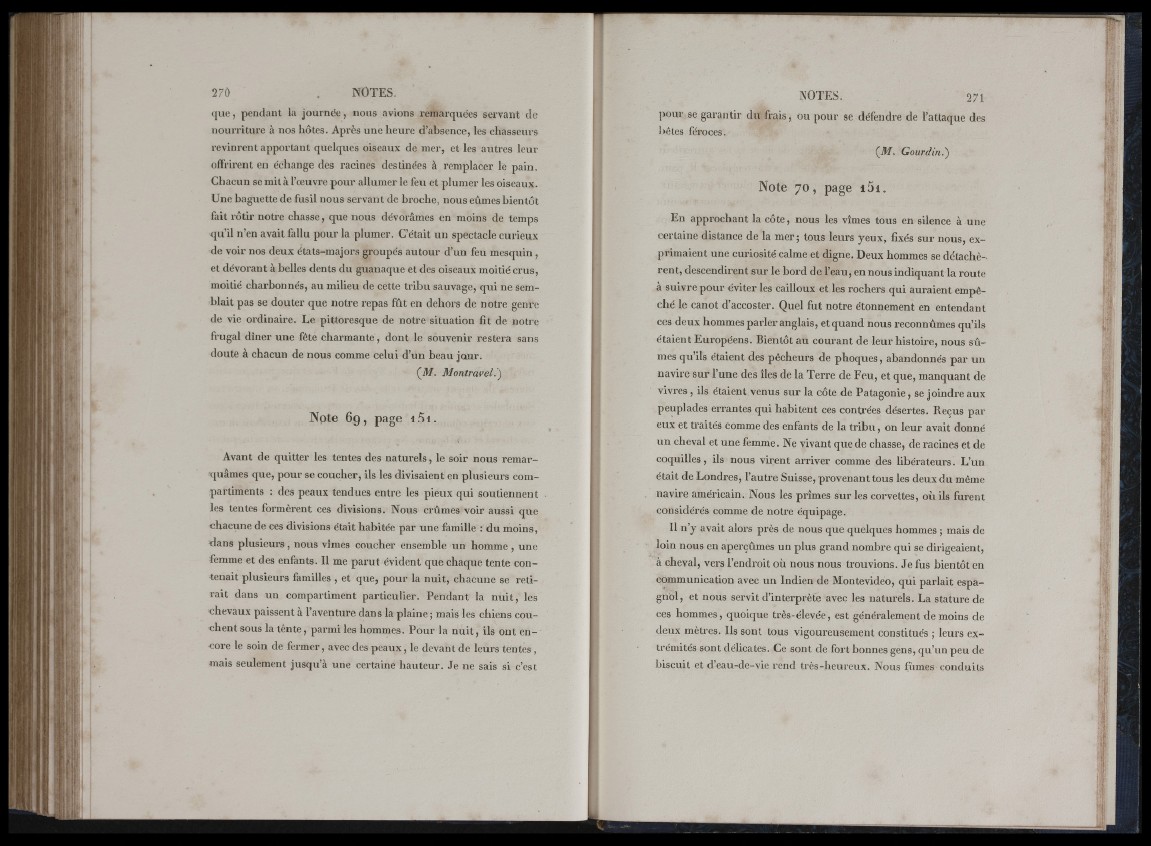
q u e , pendant la journée, nous avions remarquées servant de
nourriture à nos hôtes. Après une heure d’absence, les chasseurs
revinrent apportant quelques oiseaux de mer, et les autres leur
offrirent en échange des racines destinées à remplacer le pain.
Chacun se mit à l’oeuvre pour allumer le feu et plumer les oiseaux.
Une baguette de fusil nous servant de broche, nous eûmes bientôt
fait rôtir notre chasse, que nous dévorâmes en moins de temps
qu’il n’en avait fallu pour la plumer. C’était un spectacle curieux
de voir nos deux états-majors groupés autour d’un feu mesquin,
et dévorant à belles dents du guanaque et des oiseaux moitié crus,
moitié charbonnés, au milieu de cette tribu sauvage, qui ne semblait
pas se douter que notre repas fût en dehors de notre genre
de vie ordinaire. Le pittoresque de notre situation fit de notre
frugal dîner une fête charmante, dont le souvenir restera sans
doute à chacun de nous comme celui d’un beau jaur.
{M. Montravel.)
Note 69, page i5 i .
Avant de quitter les tentes des naturels, le soir nous remarquâmes
que, pour se coucher, ils les divisaient en plusieurs compartiments
: des peaux tendues entre les pieux qui soutiennent
les tentes formèrent ces divisions. Nous crûmes voir aussi que
chacune de ces divisions était habitée par une famille : du moins,
dans plusieurs, nous vîmes coucher ensemble un homme, une
femme et des enfants. Il me parut évident que chaque tente contenait
plusieurs familles , et que, pour la nuit, chacune se retirait
dans un compartiment particulier. Pendant la n u it, les
chevaux paissent à l’aventure dans la plaine ; mais les chiens couchent
sous la ténte, parmi les hommes. Pour la n u it, ils ont encore
le soin de fermer, avec des peaux, le devant de leurs tentes,
mais seulement jusqu’à une certaine hauteur. Je ne sais si c’est
pour se garantir du frais, ou pour se défendre de l’attaque des
bêtes féroces.
(M. Gourdin.')
Note 70, page i5 i .
En approchant la côte, nous les vîmes tous en silence à une
certaine distance de la mer; tous leurs yeux, fixés sur nous, exprimaient
une curiosité calme et digne. Deux hommes se détachèrent,
descendirent sur le bord de l’eau, en nous indiquant la route
a suivre pour éviter les cailloux et les rochers qui auraient empêché
le canot d’accoster. Quel fut notre étonnement en entendant
ces deux hommes parler anglais, et quand nous reconnûmes qu’ils
étaient Européens. Bientôt au courant de leur histoire, nous sûmes
qu’ils étaient des pêcheurs de phoques, abandonnés par un
navire sur l’une des îles de la Terre de Feu, et que, manquant de
vivres, ils étaient.venus sur la côte de Patagonie, se joindre aux
peuplades errantes qui habitent ces contrées désertes. Reçus par
eux et traités comme des enfants de la tribu, on leur avait donné
un cheval et une femme. Ne vivant que de chasse, de racines et de
coquilles, ils nous virent arriver comme des libérateurs. L’un
était de Londres, l’autre Suisse, provenant tous les deux du même
navire américain. Nous les prîmes sur les corvettes, où ils furent
considérés comme de notre équipage.
Il n’y avait alors près de nous que quelques hommes ; mais de
loin nous en aperçûmes un plus grand nombre qui se dirigeaient,
à cheval, vers l’endroit où nous nous trouvions. Je fus bientôt en
communication avec un Indien de Montevideo, qui parlait espagnol,
et nous servit d’interprète avec les naturels. La stature de
ces hommes, quoique très-élevée, est généralement de moins de
deux mètres. Ils sont tous vigoureusement constitués ; leurs extrémités
sont délicates. Ce sont de fort bonnes gens, qu’un peu de
biscuit et d’eau-de-vie rend très-heureux. Nous fûmes conduits