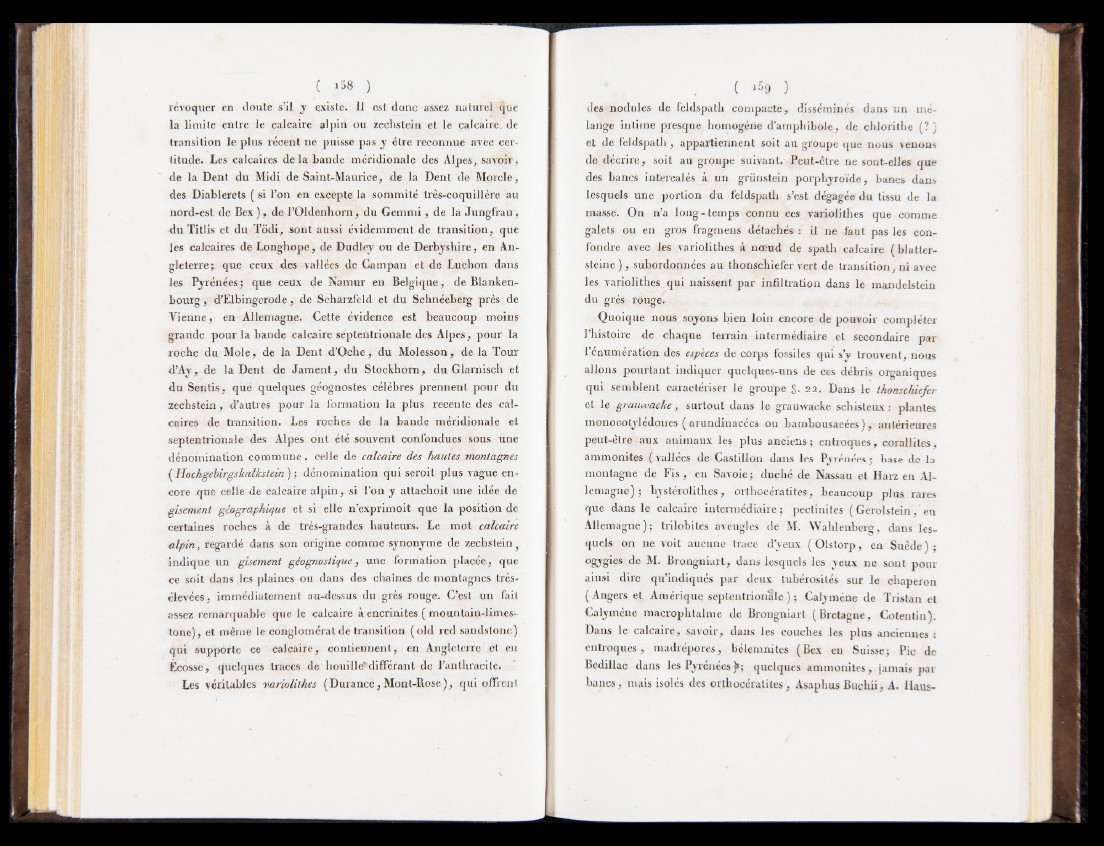
révoquer en cloute s’il y existe. II est donc assez naturel que
la limite entre le calcaire alpin ou zechstein et le calcaire, de
transition le plus récent ne puisse pas y être reconnue avec certitude.
Les calcaires delà bande méridionale des Alpes, savoir,
de la Dent du Midi de Saint-Maurice, de la Dent de Morde,
des Diablerets ( si l’on en excepte la sommité très-coquillère au
nord-est de Bex ) , de l’Oldenhorn, du Gemmi, de la Jungfrau ,
du Titlis et du Tôdi, sont aussi évidemment de transition, que
les calcaires de Longhope, de Dudley ou de Derbyshire, en Angleterre;
que ceux des vallées de Campan et de Lucbon dans
les Pyrénées ; que ceiix de Na mur en Belgique, de Blanken-
bourg, d’Elbingerode, de Scharzfeld et du Schnéeberg près de
Vienne, en Allemagne. Cette évidence est beaucoup moins
grande pour la bande calcaire septentrionale des Alpes, pour la
roche du Mole, de la Dent d’O che, du Molesson, de la Tour
d’A y, de la Dent de Jament, du Stockhorn, du Glarnisch et
du Sentis, que quelques géognostes célèbres prennent pour du
zechstein, d’autres pour la formation la plus recente des calcaires
de transition. Les roches de la bande méridionale et
septentrionale des Alpes ont été souvent confondues sous une
dénomination commune, celle de calcaire des hautes montagnes
( Hochgehirgskalkstein ) ; dénomination qui seroit plus vague encore
que celle de calcaire alpin , si l ’on y attachoit une idée de
gisement géographique et si elle n’exprimoit que la position de
certaines roches à de très-grandes hauteurs. Le mot calcaire
alpin, regardé dans son origine comme synonyme de zechstein}
indique un gisement géognosiique, une formation placée, que
ce soit dans les plaines ou dans des chaînes de montagnes très-
élevées, immédiatement au-dessus du grès rouge. C’est un fait
assez remarquable que le calcaire à encrinites ( mountain-limes-
tone), et même le conglomérat de transition (old red sandstone)
qui supporte ce calcaire, contiennent, en Angleterre et en
Écosse, quelques traces de h oui II ^différant de l’anthracite.
Les véritables variolithes (Durance, Mont-Rose), qui offrent
( l59 )
des nodules de feldspath compacte, dissémines dans un mélange
intime presque homogène d’amphibole, de chlorithe (? ;
et de feldspath , appartiennent soit au groupe que nous venons
de décrire, soit au groupe suivant. Peut-être ne sont-elles que
des bancs intercalés à un griinstein porphyroïde, bancs dans
lesquels une portion du feldspath s’est dégagée du tissu de la
masse. On n’a long-temps connu ces variolithes que comme
galets ou en gros fragmens détachés : il ne faut pas les confondre
avec les variolithes à noeud de spath calcaire ( blatter-
steine ) , subordonnées au thonschiefer vert de transition, ni avec
les variolithes qui naissent par infiltration dans le mandelstein
du grès rouge.
Quoique nous soyons bien loin encore de pouvoir compléter
l’histoire de chaque terrain intermédiaire et secondaire par
l’énumération des espèces de corps fossiles qui s’y trouvent, nous
allons pourtant indiquer quelques-uns de ces débris organiques
qui semblent caractériser le groupe S- 22. Dans le thonschiefer
et le grauwacke, surtout dans le grauwacke schisteux : plantes
monocotylédones ( arundinacées ou bambousacées), antérieures
peut-être aux animaux les plus anciens; entroques, coralliles,
ammonites ( vallees de Castillon dans les Pyrénées ; base de la
montagne de F is , en Savoie; duché de Nassau et Harz en Allemagne)
; hystérolithes, orthocératites, beaucoup plus rares
que dans le calcaire intermédiaire; pectinites ( Gerolstein, en
Allemagne); trilobites aveugles de M. Walilenberg, dans lesquels
on ne voit aucune trace d’yeux ( Olstorp, en Suède ) :
ogygies de M. Brongniart, dans lesquels les yeux ne sont pour
ainsi dire qu’indiqués par deux tubérosités sur le chaperon
( Angers et Amérique septentrionale ) ; Calymène de Tristan et
Calymène macrophtalme de Brongniart (Bretagne, Cotentin).
Dans le calcane, savoir, dans les couches les plus anciennes :
entroques, madrépores, bélemnites (Bex en Suisse; Pic de
Bedillac dans les P y r én é e sq u e lq u e s ammonites, jamais par
bancs, mais isolés des orthocératites, Asaphus Buchii, A. Haus