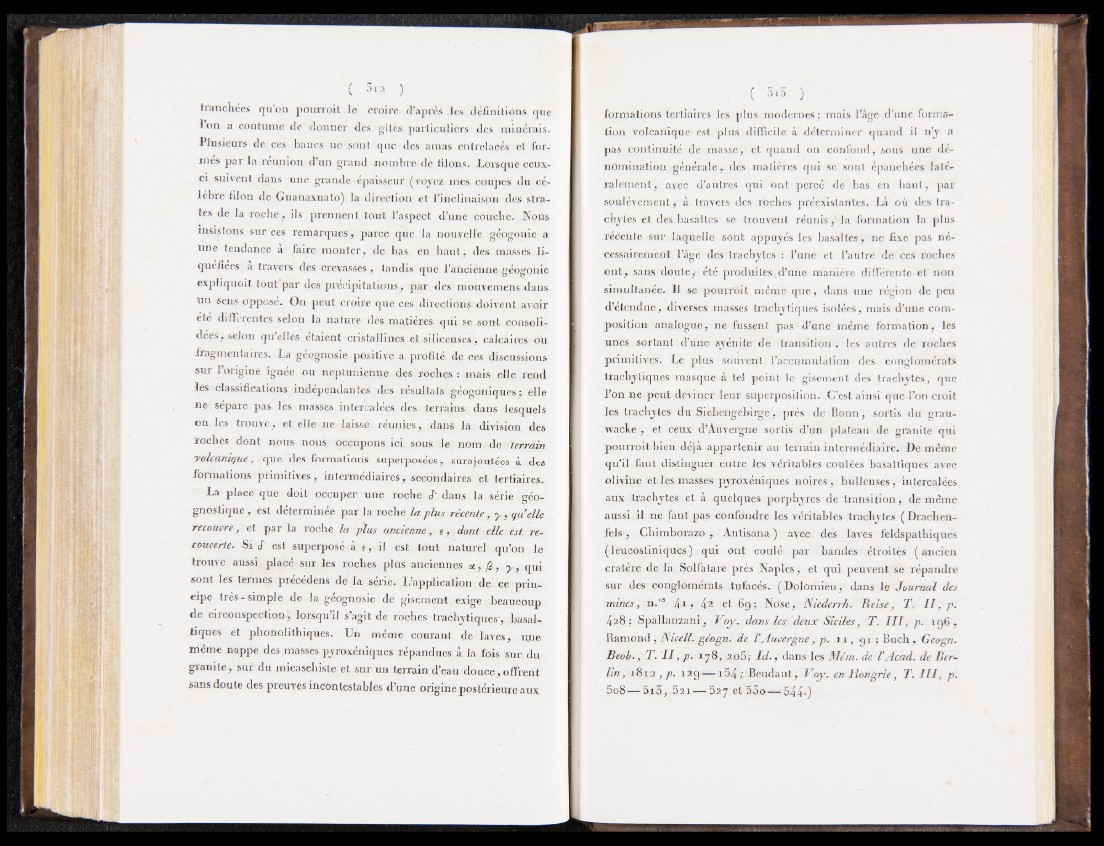
tranchées qu’on pourvoit le croire d’après les définitions que
1 on a coutume de donner des gitès particuliers des minerais.
Plusieurs de. ces bancs ne sont que des amas entrelacés et formes
par la reunion d’un grand nombre de filons. Lorsque ceux-
ci suivent dans une grande épaisseur (voyez mes coupes du célébré
filon de Guanaxuato) la direction et l’inelinais.on des strates
de la roche, ils prennent tout l ’aspect d’une couche. Nous
insistons sur ces remarques, parce que la nouvelle géogonie a
une tendance a faire monter, de bas en haut, des masses liquéfiées
à travers des crevasses, tandis que l’ancienne géogonie
expliquoit tout par des précipitations, par des mouvemens dans
un sens opposé. On peut croire que ces directions doivent avoir
ete differentes selon la nature des matières qui se sont consolidées,
selon qu’elles étaient cristallines et siliceuses, calcaires ou
fragmentaires. La geognosie positive a profilé de ces discussions
sur 1 origine ignee ou neptunienne des roches : mais elle rend
les classifications indépendantes des résultats géogoniques ; elle
ne sépare pas les masses intercalées des terrains dans lesquels
on les trouve, et elle ne laisse réunies, dans la division des
roches dont nous nous occupons ici sous le nom de terrain
volcanique, que des formations superposées, surajoutées à des
formations primitives, intermédiaires, secondaires et tertiaires.
La place que doit occuper une roche J dans la série géo-
gnostique, est déterminée par la roche la plus récente, y , qu’elle
recouvre, et par la roche la plus ancienne, g, dont elle est recouverte.
Si <f est superposé à g, il est tout naturel qu’on le
trouve aussi placé sur les roches plus anciennes ac, (i, y , qui
sont les termes precedens de la série. L’application de ce principe
très-simple de la géognosie de gisement exige beaucoup
de ciiconspection, lorsqu il s’agit de roches trachytiques', basaltiques
et phonolithiques. Un même courant de laves, une
même nappe des masses pyroxéniques répandues à la fois sur du
granité, sur du micaschiste et sur un terrain d’eau douce,offrent
sans doute des preuves incontestables d’une origine postérieure aux
formations tertiaires les plus modernes; mais l’àge d’une formation
volcanique est plus difficile à déterminer quand il rfy a
pas continuité de masse, et quand on confond, sous une dénomination
générale, des matières qui se sont épanchées latéralement,
avec d’autres qui ont percé - de bas en haut, par
soulèvement, à travers des roches préexistantes. Là où des tra-
chyles et des basaltes se trouvent réunis,: la formation la plus
récente sur laquelle sont appuyés les basaltes , ne fixe pas nécessairement
l’âge des trachytes : l’une et l’autre de ces roches
ont, sans doute,- été produites,d’une manière différente et non
simultanée. Il se pourroit même que, dans une région de peu
d’étendue, diverses masses trachytiques isolées, mais d’une composition
analogue, ne fussent pas d’une même formation, les
unes sortant d’une syénite de transition , les autres de roches
primitives. Le plus souvent l’accumulation des conglomérats
trachytiques masque à tel point le gisement des trachytes, que
l’on ne peut deviner leur superposition. C’est ainsi que l’on croit
les trachytes du Siebengebirge, près de Bonn, sortis du grau-
waeke , et ceux d’Auvergne sortis d’un plateau de granité qui
pourroit bien déjà appartenir au terrain intermédiaire. De même
qu’il faut distinguer entre les véritables coulées basaltiques avec
olivine et les masses pyroxéniques noires, bulleuses, intercalées
aux trachytes et à quelques porphyres de transition, de même
aussi il ne faut pas confondre les véritables trachytes ( Drachen-
fels, Chimborazo , Antisana ) avec des laves feldspathiques
(leucostiniques) qui ont coulé par bandes étroites (ancien
cratère de la Solfatare près Naples, et qui peuvent se répandre
sur des conglomérats tufacés. (Dolomieu, dans le Journal des
mines, n.os 41 , 42 et 69; Nose, ISiederrh. Reise, T . I l , p.
428; Spallanzani, Voy. dans les deux Siciles, T. I I I , p. 196,
Ramond, Nivell. géogn. de l’Auvergne, p. 1 1 , gi ; Buch , Geogn.
Beob., T. I I , p. 178, 2o 5; Id ., dans les Mé 772. de ï Acad, de Berlin,
1812 , p. 12g— i 54,- Beudant, Voy. en Hongrie, T. I I I , p.
5o8— 5i 3, 521 — 527 etA3o— 544-)