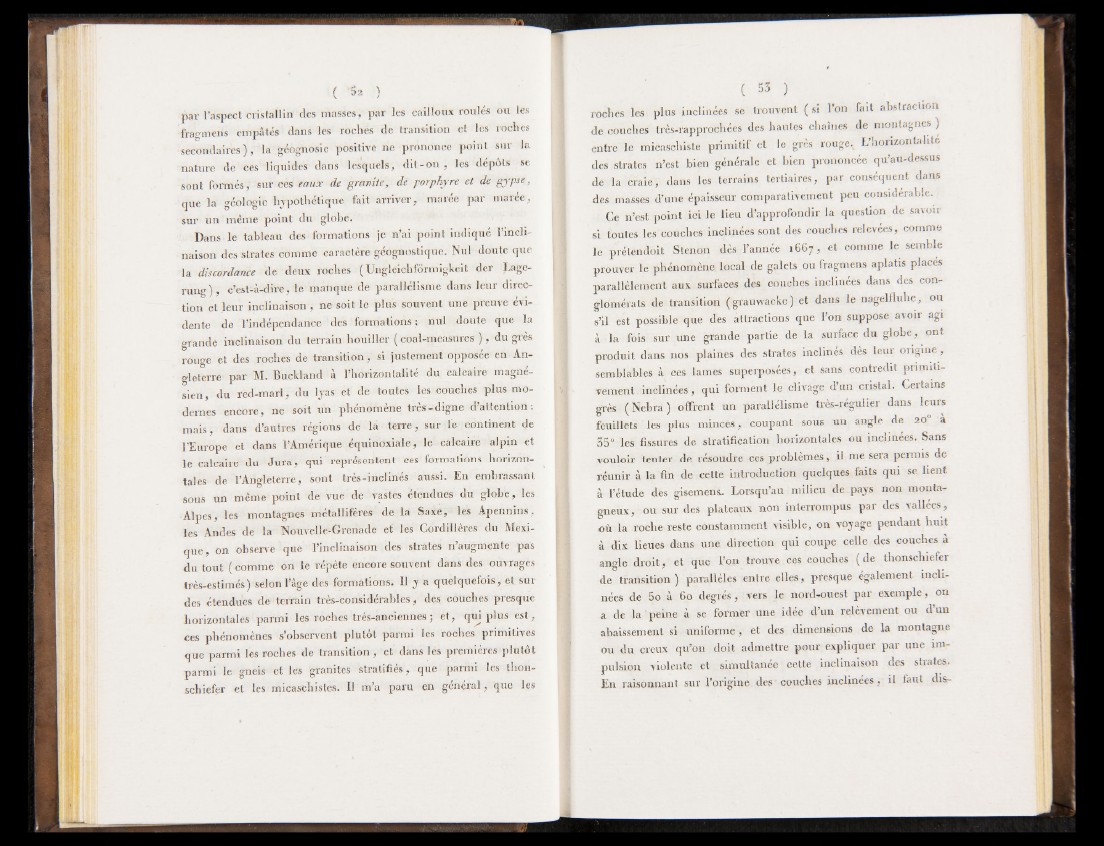
par l’aspect cristallin des masses, par les cailloux roulés ou les
fragmens empâtés dans les roches de transition et les roches
secondaires), la géognosie positive ne prononce point sur la
nature de ces liquides dans lesquels, d it-o n , les dépôts se
sont formés, sur cés eaux de granité, de porphyre et de gypse,
que la géologie hypothétique fait arriver, marée par marée,
sur un même point du globe.
Dans le tableau des formations je n’ai point indiqué l’inclinaison
des strates comme caractère géognostique. Nul doute que
la discordance de deux roches (Ungleichfôrmigkeit der Lage-
rung), c’est-à-dire, le manque de parallélisme dans leur direction
et leur inclinaison, ne soit le plus souvent une preuve évidente
de l’indépendance des formations ; nul doute que la
grande inclinaison du terrain houiller ( coal-measures ) , du grès
rouge et des roches de transition, si justement opposée en Angleterre
par M. Buckland à l’horizontalité du calcaire magnésien,
du red-marl, du lyas et de toutes les couches plus modernes
encore, ne soit un phénomène très-digne d’attention:
mais, dans d’autres régions de la terre, sur le continent de
l ’Europe et dans l’Amérique équinoxiale, le calcaire alpin et
le calcaire du Jura, qui représentent ces formations horizontales
de l’Angleterre, sont très-inclinés aussi. En embrassant
sous un même point de vue de vastes etendues du globe, les
Alpes, les montagnes métallifères de la Saxe, les Apennins,
les Andes de la Nouvelle-Grenade et les Cordillères du Mexique,
on observe que l’inclinaison des strates n’augmente pas
du tout ( comme on le répète encore souvent dans des ouvrages
très-estimés) selon l’âge des formations. Il y a quelquefois, et sur
des étendues de terrain très-considérables, des couches presque
horizontales parmi les roches très-anciennes; et, qui plus est,
ces phénomènes s’observent plutôt parmi les roches primitives
que parmi les roches de transition, et dans les premières plutôt
parmi le gneis et les granités stratifiés, que parmi les tlion-
schiefer et les micaschistes. Il m’a paru en general, que les
( 53 j
roches les plus inclinées se trouvent ( si l’on fait abstraction
de couches très-rapprochées des hautes chaînes de montagnes )
entre le micaschiste primitif et le grès rouge, L ’h o r iz o n ta lité
des strates n’est bien générale et bien prononcée qu’au-dessus
de la craie, dans les terrains tertiaires, par conséquent dans
des masses d’une épaisseur comparativement peu considérable.
Çe n’est point ici le lieu d’approfondir la question de savoir
si toutes les couches inclinées sont des couches relevées, comme
le prétendoit Stenon dès l’année 1667, et comme le semble
prouver le phénomène local de galets ou fragmens aplatis placés
parallèlement aux surfaces des couches inclinées dans des conglomérats
de transition (grauwacke) et dans le nagelfluhe, ou
s’il est possible que des attractions que l’on suppose avoir agi
à la fois sur une grande partie de la surface du globe, ont
produit dans nos plaines des strates inclinés dès leur origine,
semblables à ces lames superposées, et sans contredit primitivement
inclinées, qui forment le clivage d’un cristal. Certains
grès (Nebra) offrent un parallélisme très-régulier dans leurs
feuillets les plus minces, coupant sous un angle de 20 a
35° les fissures de stratification horizontales ou inclinées. Sans
vouloir tenter de résoudre ces problèmes, il me sera permis de
réunir à la fin de cette introduction quelques faits qui se lient
à l’étude des gisemens. Lorsqu’au milieu de pays non montagneux,
ou sur des plateaux non interrompus par des vallées,
où la roche reste constamment visible, on voyage pendant huit
à dix lieues dans une direction qui coupe celle des couches à
angle droit, et que l’on trouve ces couches ( de thonschiefer
de transition ) parallèles entre elles, presque egalement inclinées
de 5o à 60 degrés, vers le nord-ouest par exemple, on
a de la peine à se former une idee d’un relèvement ou dun
abaissement si uniforme, et des dimensions de la montagne
ou du creux qu’on doit admettre pour expliquer par une impulsion
violente et simultanée cette inclinaison des strates.
En raisonnant sur l’origine des couches inclinées, il faut dis