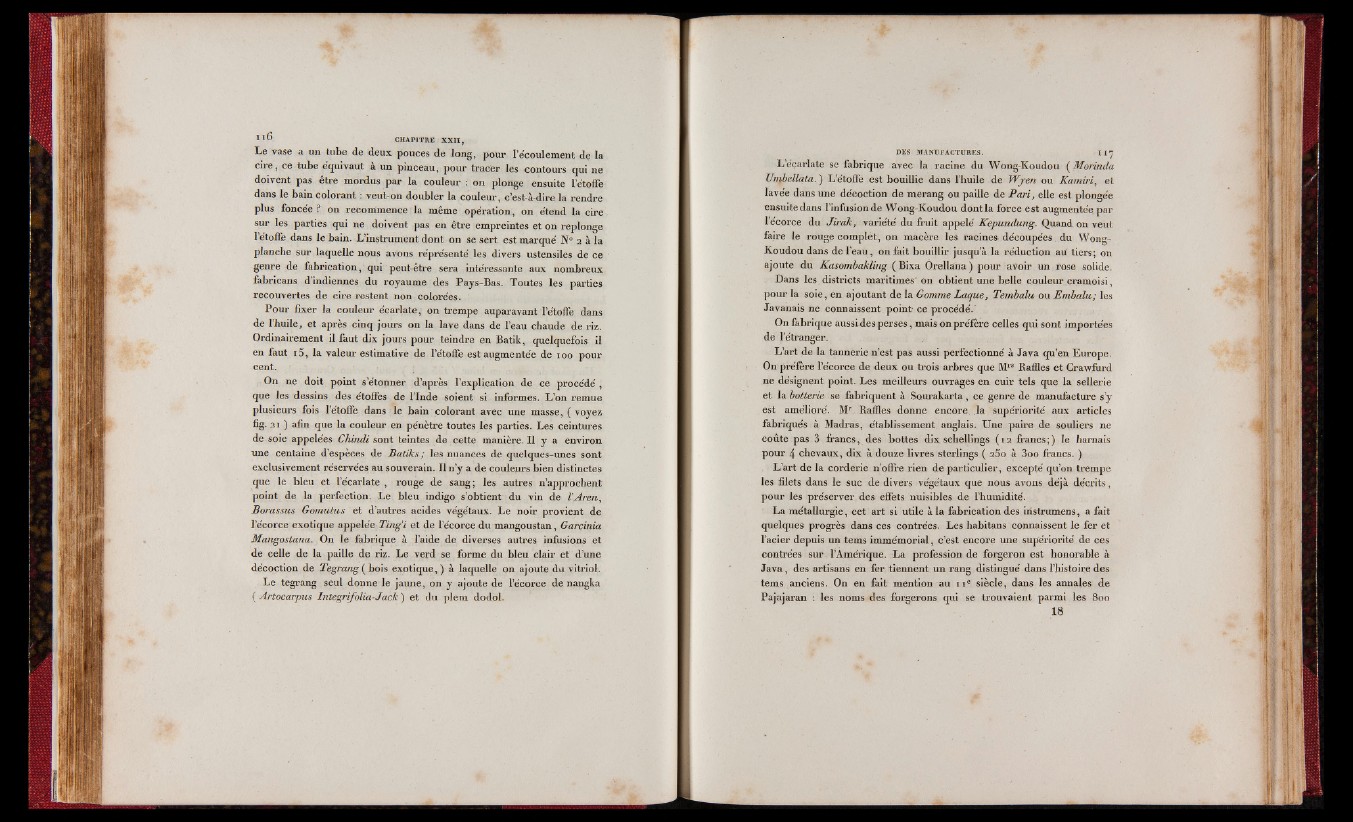
Le vase a un tube de deux pouces de long, pour l'écoulement dç la
cire, ce tube équivaut a un pinceau, pour tracer les contours qui ne
doivent pas être mordus par la couleur I on plonge ensuite letoffe
dans le bain colorant : veut-on doubler la couleur, c’est-à-dire la rendre
plus foncée ^ on recommence la même opération, on étend la cire
sur les parties qui ne doivent pas en être empreintes et on replonge
1 étoffe dans le bain. L’instrument dont on se sert est marqué N° 2 à la
planche sur laquelle nous avons réprésenté les divers ustensiles de ce
genre de fabrication, qui peut-être sera intéressante aux nombreux
fabricans d’indiennes du royaume des Pays-Bas. Toutes les parties
recouvertes de cire restent non colorées.
Pour fixer la couleur écarlate, on trempe auparavant l’étoffe dans
de l’huile, et après cinq jours on la lave dans de l’eau chaude de riz.
Ordinairement il faut dix jours pour teindre en Batik, quelquefois il
en faut i 5, la valeur estimative de l’étoffe est augmentée de 100 pour
cent.
On ne doit point s’étonner d’après l’explication de ce procédé ,
que les dessins des étoffes de l’Inde soient si informes. L’on remue
plusieurs fois l’étoffe dans le bain colorant avec une masse, (voyez
fig. 21 ) afin que la couleur en pénètre toutes les parties. Les ceintures
de soie appelées Chindi sont teintes de cette manière. Il y a environ
une centaine d’espèces de Batiks ; les nuances de quelques-unes sont
exclusivement réservées au souverain. Il n’y a de couleurs bien distinctes
que le bleu et l’écarlate , rouge de sang; les autres n’approchent
point de la perfection. Le bleu indigo s’obtient du vin de VAren,
Borassus Gomutus et d’autres acides végétaux. Le noir provient de
l’écorce exotique appelée Ting’i et de l’écorce du mangoustan, Garcinia
Mangostana. On le fabrique à l’aide de diverses autres infusions et
de celle de la paille de riz. Le verd se forme du bleu clair et d’une
décoction de Tegrang ( bois exotique,) à laquelle on ajoute du vitriol.
Le tegrang seul donne le jaune, on y ajoute de l’écorce de nangka
( Artocarpus Integrifolici-Jack ) et du plem dodol.
DES MANUFACTURES. 117
L’éçarlate se fabrique avec la racine du Wong-Koudou ( Morinda
Umbellata. ) L’étoffe est bouillie dans l’huile de Wjen ou Kamiri, et
lavée dans une décoction de merang ou paille de Pari, elle est plongée
ensuite dans l’infusion de Wong-Koudou dont la force est augmentée par
l’écorce du Jirak, variété du fruit appelé Kepundung. Quand on veut
faire le rouge complet, on macère les racines découpées du Wong-
Koudou dans de l’eau, on fait bouillir jusqu’à la réduction au tiers ; on
ajoute du Kasombakling ( Bixa Orellàna ) pour avoir un rose solide.
Dans les districts maritimes' on obtient une belle couleur cramoisi,
pour la soie, en ajoutant de. la Gomme Laque, Tembalu ou Embalu; les
Javanais ne connaissent point* ce procédé.'
On fabrique aussldes perses, mais on préfère celles qui sont importées
de l’étranger.
L’art de la tannerie n’est pas aussi perfectionné à Java qu’en Europe.
On préfère l’écorce de deux ou trois arbres que Mrs Rafiles et Crawfurd
ne désignent point. Les meilleurs ouvrages en cuir tels que la sellerie
et la botterie se fabriquent à Sourakarta, ce genre de manufacture s’y
est amélioré. Mr Rafiles donne encore la supériorité aux articles
fabriqués à Madras, établissement anglais. Une paire de souliers ne
coûte pas 3 francs, des bottes dix scheliings (12 francs ; ) le harnais
pour 4 chevaux, dix à douze livres sterlings ( 25o à 3oo francs. )
L’art de la corderie n’offre rien de particulier, excepté qu’on trempe
les filets dans le suc de divers végétaux que nous avons déjà décrits,
pour les préserver des effets nuisibles de l’humidité.
La métallurgie, cet art si utile à la fabrication des iristrumens, a fait
quelques progrès dans ces contrées. Les habitans connaissent le fer et
l’acier depuis un tems immémorial, c’est encore une supériorité de ces
contrées sur l’Amérique. La profession de forgeron est honorable à
Java, des artisans en fer tiennent un rang distingué dans l’histoire des
tems anciens. On en fait mention au 11e siècle, dans les annales de
Pajajaran : les noms des forgerons qui se trouvaient parmi les 800
18