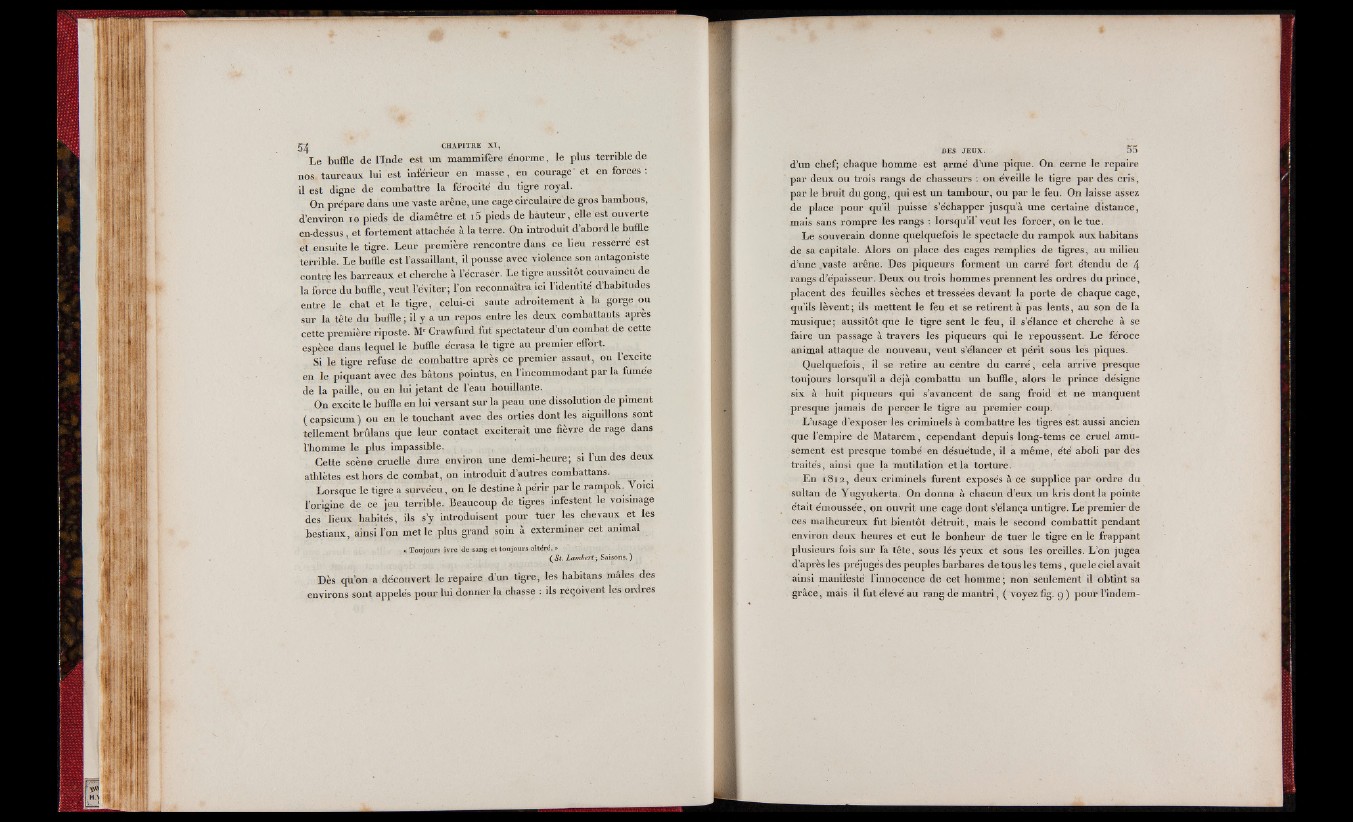
Le buffle de l’Inde est un mammifère énorme, le plus terrible de
nos, taureaux lui est inférieur en masse, en courage' et en forces :
il est digne de combattre la férocité' du tigre royal.
On prépare dans une vaste arène, une cage circulaire de gros bambous,
d’environ 10 pieds de diamètre et i 5 pieds de hauteur , elle est ouverte
en-dessus, et fortement attachée à la terre. On introduit d’abord le buffle
et ensuite le tigre. Leur première rencontre dans ce lieu resserré est
terrible. Le buffle est l’assaillant, il pousse avec violence son antagoniste
contre les barreaux et cherche à l’écraser. Le tigre aussitôt couvaincu de
la force du buffle, veut l’éviter; l’on reconnaîtra ici l’identité d’habitudes
entre le chat et lé tigre, celui-ci saute adroitement à la gorge ou
sur la tête du buffle ; il y a un repos entre les deux combattants après
cette première riposte. IVb Crawfurd hit spectateur d’un combat de cette
espèce dans lequel le buffle écrasa le tigre au premier effort.
Si le tigre refuse de combattre après ce premier assaut, on 1 excite
en le piquant avec des bâtons pointus, en l’incommodant par la fumée
de la paille, ou en lui jetant de l’eau bouillante.
On excite le buffle en lui versant sur la peau une dissolution de piment
( capsicum ) ou en le touchant avec des orties dont les aiguillons sont
tellement brûlans que leur contact exciterait une fièvre de rage dans
l’homme le plus impassible. ,
Cette scène cruelle dure environ une demi-heure; si l’un des deux
athlètes est hors de combat, on introduit d’autres combattans.
Lorsque le tigre a survécu, on lé destine à périr par le rampok. Voici
l’origine de ce jeu terrible. Beaucoup de tigres infestent le voisinage
des lieux habités, ils s’y introduisent pour tuer les chevaux et les
bestiaux, ainsi l’on met le plus grand soin à exterminer cet animal
« Toujours ivre de sang et toujours altéré. »
( St. Lambert ; Saisons. )
Dès qu’on a découvert le repaire d’un tigre, les habitans maies des
environs sont appelés pour lui donner la chasse : ils reçoivent les ordres
DES JEUX. 5 5
d’un chef; chaque homme est arme' d’une pique. On cerne le repaire
par deux ou trois rangs de chasseurs : on éveille le tigre par des cris,
par le bruit du gong, qui est un tambour, ou par le feu. On laisse assez
de place pour qu’il puisse s’échapper jusqu’à une certaine distance,
mais sans rompre les rangs : lorsqu’il* veut les forcer, on le tue.
Le souverain donne quelquefois le spectacle du rampok aux habitans
de sa capitale. Alors on place des cages remplies de tigres, au milieu
d’une .vaste arène. Des piqueurs forment un carré fort étendu de 4
rangs d’épaisseur. Deux ou trois hommes prennent les ordres du prince,
placent des feuilles sèches et tressées devant la porte de chaque cage,
qu’ils lèvent ; ils mettent le feu et se retirent à pas lents, au son de la
musique; aussitôt que le tigre sent le feu, il s’élance et cherche à se
faire un passage à travers les piqueurs qui le repoussent. Le féroce
animal attaque de nouveau, veut s’élancer et périt sous les piques.
Quelquefois, il se retire au centre du carré, cela arrive presque
toujours lorsqu’il a déjà combattu un buffle, alors le prince désigne
six à huit piqueurs qui s’avancent de sang froid et ne manquent
presque jamais de percer le tigre au premier coup.
L’usage d’exposer les criminels à combattre les tigres est aussi ancien
que l’empire de Matarem, cependant depuis long-tems ce cruel amusement
est presque tombé en désuétude, il a même, été aboli par des
traités, ainsi que la mutilation et la torture.
En 1812, deux criminels furent exposés à ce supplice par ordre du
sultan de Yugyukerta. On donna à chacun d’eux un kris dont la pointe
était émoussée, on ouvrit une cage dont s’élança un tigre. Le premier de
ces malheureux fut bientôt détruit, mais le second combattit pendant
environ deux heures et eut le bonheur de tuer le tigre en le frappant
plusieurs fois sur la tête, sous lés yeüx et sous les oreilles. L’on jugea
d’après les préjugés des peuples barbares de tous les tems, que le ciel avait
ainsi manifesté l’innocence de cet homme ; non seulement il obtint sa
grâce, mais il fut élevé au rang de mantri, ( voyez fig. 9 ) pour l’indem