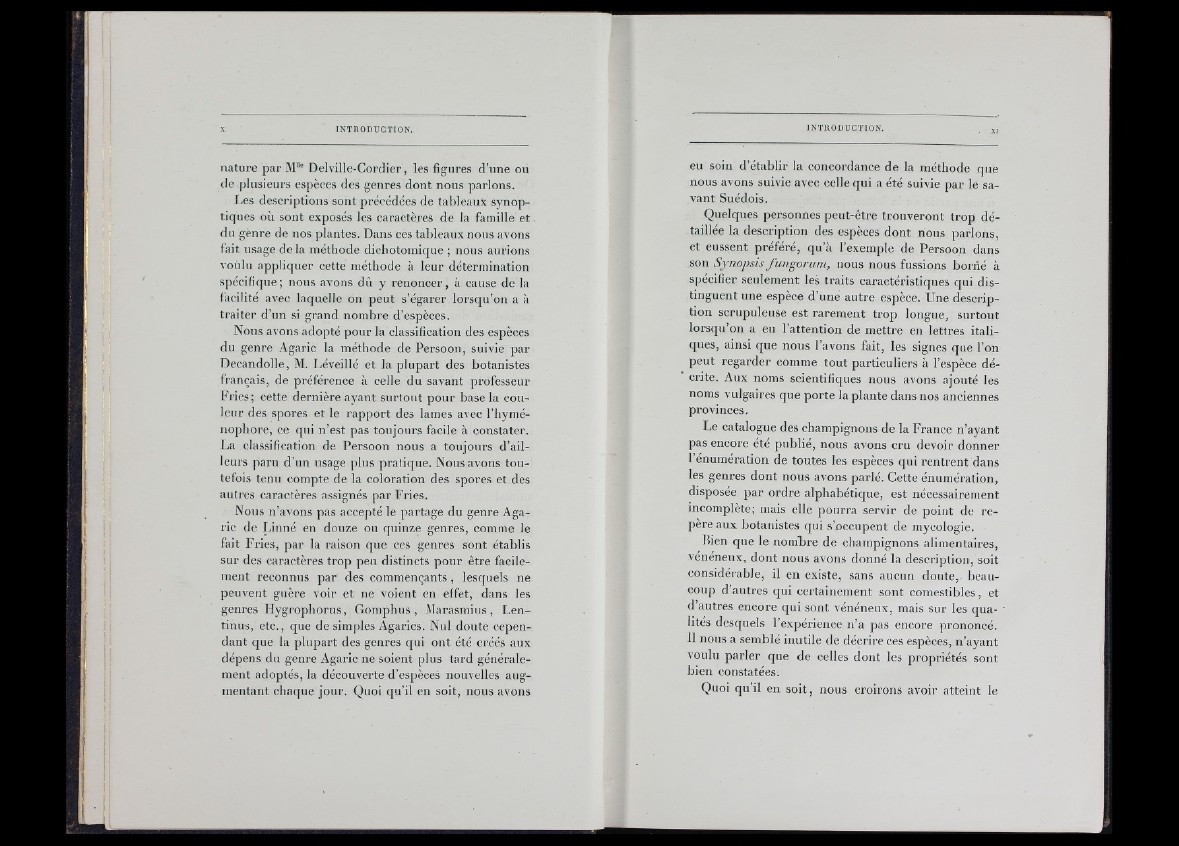
A L
nature p a r M““ Delville-Cordier, les figures d ’une on
de plusieurs espèces des genres dont nous parlons.
Les descriptions sont précédées de tableaux synoptiques
où sont exposés les caractères de la famille et
du gênre de nos plantes. Dans ces tableaux nous avons
fait usage d e là méthode dichotomique ; nous aurions
voulu appliquer cette méthode à leur détermination
spécifique; nous avons dû y ren o n c e r, à cause de la
facilité avec laquelle on peut s’égarer lo rsq u ’on a à
tra ite r d ’im si grand noinlire d ’espèces.
Nous avons adopté pour la classification des espèces
du genre Agaric la méthode de Persoon, suivie par
Decandolle, M. liéveillé et la p lu p a rt des botanistes
français, de préférence à celle du savant professeur
Fries; cette dernière ayant su rto u t p o u r base la couleur
des spores et le rap p o rt des lames avec l ’hymé-
nophore, ce qui n ’est pas toujours facile à constater.
La classification de Persoon nous a toujours d ’ailleurs
paru d ’un usage plus pratique. Nous avons to u tefois
tenu compte de la coloration des spores et des
autres caractères assignés par Fries.
Nous n ’avons pas accepté le partage du genre Agaric
de Linné en douze ou quinze genres, comme le
fait Fries, p a r la raison que ces genres sont établis
sur des caractères trop peu distincts p o u r être facilement
reconnus p a r des commençants, lesquels ne
peuvent guère voir et ne voient en effet, dans les
genres Hygrophorus, G om p h u s , Marasmiiis, Len-
tinus, etc., que de simples Agarics. Nul doute cepend
ant que la p lu p a rt des genres qui ont été créés aux
dépens du genre Agaric ne soient plus ta rd généralement
adoptés, la découverte d ’espèces nouvelles augmentant
chaque jo u r. Quoi q u ’il en soit, nous avons
eu soin d ’établir la concordance de la méthode que
nous avons suivie avec celle qui a été suivie par le savant
Suédois.
Quelques personnes peut-être tro u v ero n t tro p détaillée
la description des espèces dont nous parlons,
et eussent préféré, q u ’à l’exemple de Persoon dans
son Synopsis fu n g o rum , nous nous fussions borné à
spécifier seulement les traits caractéristiques qui distinguent
une espèce d ’une autre espèce. Une description
scrupuleuse est rarement tro p longue, surtout
lorsqu’on a eu l’attention de mettre en lettres italiques,
ainsi que nous l ’avons fait, les signes que l’on
peut regarder comme to u t particuliers à l’espèce dé-
' crite. Aux noms scientifiques nous avons ajouté les
noms vulgaires que p orte la p lante dans nos anciennes
provinces.
Le catalogue des champignons de la France n ’ayant
pas encore été publié, nous avons cru devoir donner
rén um é ra tio n de toutes les espèces q u i ren tren t dans
les genres d o n t nous avons parlé. Cette énumération,
disposée p a r ordre alphabétique, est nécessairement
incomplète; mais elle p o u rra servir de p oint de repère
aux botanistes qui s’occupent de mycologie.
bien que le nombre de champignons alimentaires,
vénéneux, do n t nous avons donné la description, soit
considérable, il en existe, sans aucun doute, beaucoup
d ’autres qui certainement sont comestibles, et
d ’autres encore qui sont vénéneux, mais sur les qua- •
lités desquels l ’expérience n ’a pas encore prononcé.
11 nous a semblé inutile de décrire ces espèces, n ’ayant
voulu p a rle r que de celles do n t les propriétés sont
bien constatées.
Quoi q u ’il en so it, nous croirons avoir atteint le